 |
|
 |
|
|
 | | Revue Le partenaire |  | | Créée en 1992, la revue le partenaire est devenue au Québec une voix importante pour les personnes utilisatrices de services en santé mentale et pour tous les acteurs concernés par la réadaptation psychosociale, le rétablissement et la problématique de la santé mentale. Ses éditoriaux, ses articles, ses dossiers proposent une information à la fine pointe des connaissances dans le champ de la réadaptation psychosociale. Ils contribuent à enrichir la pratique dans ce domaine et à stimuler le débat entre ses membres. | |
| Destination El Paradiso | 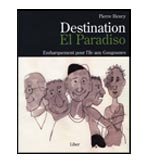 | | El Paradiso n’est pas une maison de retraite comme les autres. Située dans une île enchanteresse qui est réservée à son usage, elle accueille des pensionnaires bien particuliers. Ce sont, par un aspect ou l’autre de leur vie, par ailleurs tout à fait honorable, des originaux, des excentriques, habités par une douce folie, qui n’a sans doute d’égal que la simplicité de leur bonheur. C’est une galerie de personnages un peu fantasques que nous fait rencontrer cet ouvrage tout empreint de tendresse, d’humour et d’humanité. Voici donc les premiers douze membres de ce club très spécial:
Perry Bedbrook, Guy Joussemet, Édouard Lachapelle, Andrée Laliberté,
Céline Lamontagne, Guy Mercier, Avrum Morrow, Lorraine Palardy,
Antoine Poirier, Michel Pouliot, Charles Renaud, Peter Rochester.
| |
| Le Guérisseur blessé |  | | Le Guérisseur blessé de Jean Monbourquette est paru au moment où l’humanité entière, devant la catastrophe d’Haïti, s’est sentie blessée et a désiré contribuer de toutes sortes de façons à guérir les victimes de ce grand malheur. Bénéfique coïncidence, occasion pour l’ensemble des soignants du corps et de l’âme de s’alimenter à une source remarquable.
Dans ce livre qui fut précédé de plusieurs autres traitant des domaines de la psychologie et du développement personnel , l’auteur pose une question essentielle à tous ceux qui veulent soigner et guérir : « Que se cache-t-il derrière cette motivation intime à vouloir prendre soin d’autrui? Se pourrait-il que la majorité de ceux et celles qui sont naturellement attirés par la formation de soignants espèrent d’abord y trouver des solutions à leurs propres problèmes et guérir leurs propres blessures? » Une question qui ne s’adresse évidemment pas à ceux qui doivent pratiquer une médecine de guerre dans des situations d’urgence! | |
| Mémoire et cerveau |  | | Dans ce numéro de La Recherche, on se limite à étudier la mémoire dans la direction indiquée par le psychologue torontois Endel Tulving, reconnu en en ce moment comme l'un des grands maîtres dans ce domaine. Cela confère au numéro un très haut degré de cohérence qui en facilite la lecture. Culving est à l'origine de la distinction désormais universellement admise entre la « mémoire épisodique » portant sur des événements vécus et la « mémoire sémantique » portant sur des concepts, des connaissances abstraites. C'est la première mémoire que je mets en œuvre quand je m'efforce d'associer des mots à un événement passé, un voyage par exemple; je m'en remets à la seconde quand je m'efforce d'associer des mots automatiquement les uns aux autres, abstraction faite de tout événement vécu auquel ces mots pourraient se rapporter. Au cours de la décennie 1960, Tulving a constaté que les résultats obtenus grâce au premier exercice étaient beaucoup moins bons que ceux obtenus par le second exercice, ce qui l'a incité à faire l'hypothèse qu'il existe deux mémoires distinctes. | |
| Spécial Mémoire |  | | Dans ce numéro de La Recherche, on se limite à étudier la mémoire dans la direction indiquée par le psychologue torontois Endel Tulving, reconnu en en ce moment comme l'un des grands maîtres dans ce domaine. Cela confère au numéro un très haut degré de cohérence qui en facilite la lecture. Culving est à l'origine de la distinction désormais universellement admise entre la « mémoire épisodique » portant sur des événements vécus et la « mémoire sémantique » portant sur des concepts, des connaissances abstraites. C'est la première mémoire que je mets en œuvre quand je m'efforce d'associer des mots à un événement passé, un voyage par exemple; je m'en remets à la seconde quand je m'efforce d'associer des mots automatiquement les uns aux autres, abstraction faite de tout événement vécu auquel ces mots pourraient se rapporter. Au cours de la décennie 1960, Tulving a constaté que les résultats obtenus grâce au premier exercice étaient beaucoup moins bons que ceux obtenus par le second exercice, ce qui l'a incité à faire l'hypothèse qu'il existe deux mémoires distinctes.
| |
| L'itinérance au Québec |  | | La personne en situation d’itinérance est celle :
[…] qui n’a pas d’adresse fixe, de logement stable, sécuritaire et salubre, à très faible revenu, avec une accessibilité discriminatoire à son égard de la part des services, avec des problèmes de santé physique, de santé mentale, de toxicomanie, de violence familiale ou de désorganisation sociale et
dépourvue de groupe d’appartenance stable.
Cette définition met en évidence la complexité du phénomène et l’importance de l’aspect multifactoriel des éléments déclencheurs tels que la précarité résidentielle et financière, les ruptures sociales, l’accumulation de problèmes divers (santé mentale, santé physique, toxicomanie, etc.). L’itinérance n’est pas un phénomène dont les éléments forment un ensemble rigide et homogène et elle ne se limite pas exclusivement au passage à la rue.L’itinérance est un phénomène dynamique dont les processus d’exclusion, de marginalisation et de désaffiliation
en constituent le coeur. | |
| L’habitation comme vecteur de lien social |  | | Evelyne Baillergeau et Paul Morin (2008). L’habitation comme vecteur de lien social, Québec, Collection
Problèmes sociaux et intervention, PUQ, 301 p.
Quel est le rôle de l’habitation dans la constitution d’un vivre ensemble entre les habitants d’un immeuble, d’un ensemble d’habitations ou même d’un quartier ? Quelles sont les répercussions des conditions de logement sur l’organisation de la vie quotidienne des individus et des familles et sur leurs modes d’inscription dans la société ? En s’intéressant à certaines populations socialement disqualifi ées, soit les personnes ayant des problèmes de santé mentale et les résidents en habitation à loyer modique, les auteurs étudient le logement non seulement comme l’un des déterminants de la santé et du bien-être, mais également comme un lieu d’intervention majeur dans le domaine des services sociaux. De la désinstitutionnalisation à l’intégration, des maisons de chambres aux HLM, ils décrivent et analysent des expériences ayant pour objectif le développement
individuel et collectif des habitants et les comparent ensuite à d’autres réalisées au Canada, aux Pays-Bas et en Italie.
Pour en savoir plus : http://www.puq.ca | |
| Revue Développement social |  | | On a longtemps sous-estimé l'importance du lien entre les problèmes environnementaux et la vie sociale. Nous savons tous pourtant que lorsque le ciel est assombri par le smog, on hésite à sortir de chez soi pour causer avec un voisin. Pour tous les collaborateurs de ce numéro consacré au développement durable, le côté vert du social et le côté social du vert vont de soi. La vue d'ensemble du Québec qui s'en dégage est enthousiasmante. Les Québécois semblent avoir compris qu'on peut redonner vie à la société en assainissant l'environnement et que les défits à relever pour assurer le développement durable sont des occasions à saisir pour resserrer le tissu social.
| | La réforme des tutelles: ombres et lumières. |  | | En marge de la nouvelle loi française sur la protection des majeurs, qui doit entrer en vigueur en janvier 2009.
La France comptera un million de personnes " protégées " en 2010. Le dispositif actuel de protection juridique n'est plus adapté. Ce " livre blanc " est un plaidoyer pour une mise en œuvre urgente de sa réforme. Les enjeux sont clairs lutter contre les abus, placer la protection de la personne, non plus seulement son patrimoine, au cœur des préoccupations, associer les familles en les informant mieux, protéger tout en respectant la dignité et la liberté individuelle. Le but est pluriel. Tout d'abord, rendre compte des difficultés, des souffrances côtoyées, assumer les ombres, et faire la lumière sur la pratique judiciaire, familiale et sociale ; Ensuite, expliquer le régime juridique de la protection des majeurs, et décrire le fonctionnement, les bienfaits, et les insuffisances ; Enfin, poser les jalons d'une réforme annoncée comme inéluctable et imminente mais systématiquement renvoyée à plus tard.
Les auteurs: Michel Bauer, directeur général de l'Udaf du Finistère, l'une des plus grandes associations tutélaires de France, anime des groupes de réflexion sur le sujet et œuvre avec le laboratoire spécialisé de la faculté de droit de Brest. II est l'auteur d'ouvrages sur les tutelles et les curatelles. Thierry Fossier est président de chambre à la cour d'appel de Douai et professeur à l'Université d'Auvergne, où il codirige un master et l'IEJ. II est fondateur de l'Association nationale des juges d'instance, qui regroupe la grande majorité des juges des tutelles. II est l'auteur de nombreuses publications en droit de la famille et en droit des tutelles. Laurence Pécaut-Rivolier, docteur en droit, est magistrate à la Cour de cassation. Juge des tutelles pendant seize ans elle préside l'Association nationale des juges d'instance depuis plusieurs années. | |
| Puzzle, Journal d'une Alzheimer |  | | Ce livre, paru aux Éditions Josette de Lyon en 2004, a fait l'objet d'une émission d'une heure à Radio-France le 21 février 2008. Il est cité dans le préambule du rapport de la COMMISSION NATIONALE CHARGÉE DE L’ÉLABORATION DE PROPOSITIONS POUR UN PLAN NATIONAL CONCERNANT
LA MALADIE D’ALZHEIMER ET LES MALADIES APPARENTÉES. Ce rapport fut remis au Président de la République française le 8 novembre 2007.
«Je crois savoir où partent mes pensées perdues : elles s’évadent dans mon coeur…. Au fur et à mesure que mon cerveau se vide, mon coeur doit se remplir car j’éprouve des sensations et des sentiments extrêmement forts… Je voudrais pouvoir vivre le présent sans être un fardeau pour les autres et que l’on continue à me traiter avec amour et respect, comme toute personne humaine qui a des émotions et des pensées,même lorsque je semble «ailleurs »1à.
| | Les inattendus (Stock) |  | | Premier roman d'Eva Kristina Mindszenti, jeune artiste peintre née d’un père hongrois et d’une mère norvégienne, qui vit à Toulouse. Le cadre de l'oeuvre: un hôpital pour enfants, en Hongrie. «Là gisent les "inattendus", des enfants monstrueux, frappés de maladies neurologiques et de malformations héritées de Tchernobyl, que leurs parents ont abandonné. Ils gémissent, bavent, sourient, râlent, mordent parfois. Il y a des visages "toujours en souffrance" comme celui de Ferenc évoquant "le Christ à la descente de la croix". Tout est figé, tout semble mort. Pourtant, la vie palpite et la beauté s’est cachée aussi au tréfonds de ces corps suppliciés. » (Christian Authier, Eva Kristina Mindszenti : une voix inattendue, «L'Opinion indépendante», n° 2754, 12 janvier 2007) | |
| En toute sécurité |  | | Cet ouvrage est l'adaptation québécoise de Safe and secure, publié par les fondateurs du réseau PLAN (Planned Lifetime Advocacy Network) et diffusé au Québec par un groupe affilié à PLAN, Réseaux pour l'avenir. Il s'agit d'un guide pratique dont le but est d'aider à les familles à planifier l'avenir "en toute sécurité" des membres de leur famille aux prises avec un handicap. | |
| "Il faut rester dans la parade ! " - Comment vieillir sans devenir vieux |  | | Auteur : Catherine Bergman. Éditeur : Flammarion Québec, 2005. "Dominique Michel, Jacques Languirand, Jean Béliveau, Antonine Maillet, Jean Coutu, Gilles Vigneault, Hubert Reeves, ils sont une trentaine de personnalités qui, ayant dépassé l’âge de la retraite, sont restés actives et passionnées. Ils n’ont pas la prétention de donner des conseils ni de s’ériger en modèles, mais leur parcours exceptionnel donne à leur parole une valeur inestimable. Journaliste d’expérience, Catherine Bergman les interroge sur le plaisir qu’ils trouvent dans ce qu’ils font, leur militantisme et leur vision de la société ; sur leur corps, ses douleurs et la façon dont ils en prennent soin ; sur leur rapport aux autres générations, ce qu’ils ont encore à apprendre et l’héritage qu’ils souhaitent transmettre ; sur leur perception du temps et leur peur de la mort. Son livre est un petit bijou, une réflexion inspirante sur la vieillesse et l’art d’être vivant." (présentation de l'éditeur). | |
| Le temps des rites. Handicaps et handicapés |  | | Auteur : Jean-François Gomez.
Édition : Presses de l'Université Laval, 2005, 192 p.
"Il est temps aujourd’hui de modifier profondément notre regard sur les personnes handicapées et sur les « exclus » de toute catégorie, qu’ils soient ou non dans les institutions. Pour l’auteur du Temps des rites, l’occultation du symbolique, ou son déplacement en une société de « signes » qui perd peu à peu toutes formes de socialités repérable et transmissible produit des dégâts incalculables, que les travailleurs sociaux, plus que quiconque doivent intégrer dans leur réflexion.
Il faudrait s’intéresser aux rituels et aux « rites de passage » qui accompagnaient jusque là les parcours de toute vie humaine, débusquer l’existence d’une culture qui s’exprime et s’insinue dans toutes les étapes de vie. On découvrira avec étonnement que ces modèles anciens qui ont de plus en plus de la peine à se frayer une voie dans les méandres d’une société technicienne sont d’une terrible efficacité." | |
| Dépendances et protection (2006) |  | | Textes des conférences du colloque tenu le 27 janvier 2006 à l'Île Charron. Formation permanente du Barreau du Québec. Volume 238. 2006 | |  |
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
|
|
| Originaux et détraqués - Douze types québecquois 1 |
 |
| Louis Fréchette |
  |
| Présentation |
| "On qualifie aussi de fous ceux qui vivent à la marge ou en marge de leurs groupes d'appartenance, qui les dérangent, les contestent ou prétendent les transformer radicalement. Les 'originaux et détraqués' de Louis Fréchette appartiennent à cette catégorie..." (Camille Laurin, préface de l'ouvrage d'Hubert Wallot, La Danse autour du fou. Survol de l'histoire organisationnelle de la prise en charge de la folie au Québec depuis les origines jusqu'à nos jours, Beauport, Publications MNH, 1998) |
 |
| Texte |
Préface-dédicace
À mon très cher et très distingué compagnon d’enfance,
James D. Edgar,
député au Parlement fédéral.
Mon cher ami,
Pendant que j’écrivais ce petit livre, tout rempli et pour ainsi dire tout palpitant de souvenirs qui nous sont communs, ton nom est venu tant de fois se mêler joyeusement à ces réminiscences, que, au moment de rédiger une préface, je le retrouve tout naturellement sous ma plume.
Qu’il y reste, même sans ta permission !
En même temps que le livre te rappellera des lieux, des noms et des incidents sans doute plus ou moins frustes dans ta mémoire, la préface te parlera des chaudes et naïves amitiés du temps passé.
Il me semble que, par cela même, elle te fera mieux reconnaître les horizons décrits, elle te peindra plus frappantes et plus vraies les scènes évoquées, elle te donnera plus vive et plus sincère la vision rétrospective des choses envolées.
Ces évocations sont, du reste, mon cher Edgar, notre seule chance de revivre un peu nos premières années : car les lieux mêmes, autant dans leur aspect physique que dans leur physionomie morale, sont bien changés.
En jetant les yeux sur le plateau de Lévis, par exemple, en y embrassant du regard ces édifices considérables, ces rues bordées d’arbres et d’habitations élégantes, il te serait impossible de reconnaître le théâtre de nos ébats de gamins et de nos longues rêveries d’adolescents.
Tu ne retrouverais plus la Commune, avec ses tranchées historiques, ses monticules se succédant pêle-mêle comme les vagues de la mer, ses étroits sentiers se faufilant à travers les bouquets épars des coudriers, des cenelliers et des cerisiers à grappes.
Tu chercherais en vain les prairies frangées de broussailles épineuses, et plantées par-ci par-là de vieux ormes aux branches en ogive, où nous allions, pour nous amuser, aider à la fenaison.
C’est à peine si tu trouverais, au haut de la falaise qui domine le Saint-Laurent, un petit coin de roc où t’asseoir pour jouir encore une fois du spectacle, toujours grandiose et toujours beau, du soleil sombrant derrière la gigantesque arête du rocher de Québec, et pour écouter s’endormir le grand fleuve, avec ses bruits et ses rumeurs, dans le calme de la nuit tombante.
T’en souviens-tu ?...
Combien de fois, par les soirs limpides et parfumés, ne nous sommes-nous pas arrêtés là, le front moite et la pensée étrangement troublée par je ne sais quelle nostalgie du rêve !
Combien de fois ne sommes-nous pas venus là tous deux, poètes de l’avenir, dans le recueillement et la solitude, demander aux caresses rafraîchissantes des brises, aux murmures confus et berçants de la vesprée, aux mille et une splendeurs embrasées du couchant, le secret de ces émotions vagues dont l’envahissement étreignait si délicieusement nos coeurs de quinze ans !
Premiers cris de l’âme !
Premières vibrations intérieures !
Premiers tressaillements de la jeunesse qui va fleurir ! Vos ivresses inquiètes ne s’oublient jamais.
Toute la vie en garde une espèce d’ébranlement mystérieux et doux. Oui, bien des choses sont changées.
Les vastes champs que nous foulions à la raquette ; les estacades flottantes où notre canot de pêche reposait à l’abri du vent ; les anses sablonneuses où nous allions faire nos plongeons de jeunes canards, tout cela est disparu.
Les rails du Grand-Tronc et de l’Intercolonial ont bouleversé tout cela, et bien d’autres choses.
C’est sur l’ancien quai Lauzon, construit par sir John Caldwell, et restauré à neuf, que s’embarquent aujourd’hui les voyageurs pour New-York et San Francisco... quand il y en a.
Une vaste usine s’est élevée sur l’emplacement même de la maison dont la cave recéla les cadavres qu’y enfouissait le vieux meurtrier Lanigan, resté vivant dans les souvenirs populaires sous le nom du « docteur Linguienne »... et dans le carnet des savants, sous celui du « docteur l’Indienne ».
Le château Tweedle a été rasé par un incendie.
À bas aussi la vieille colonne qui rappelait l’endroit rendu célèbre par le gibet de la Corriveau.
Les canots d’hiver, ces vieux adversaires de la banquise, ont vu leurs avirons vaincus par les hélices de puissants bateaux à vapeur qui se rient aujourd’hui des débâcles du « Lac », comme des tempêtes de janvier.
Plus de wigwams montagnais éparpillés sur la grève d’Indian Cove : un gigantesque bassin de radoub – puissent les muses me le pardonner aussi volontiers que les électeurs de l’endroit ! – a pris leur place.
Le mai de Tempérance, la boutique à Gnace, la flûte à Gaudreault, la meute à Batoche, tout cela est allé rejoindre les neiges d’antan.
Et les vieux ? partis aussi les uns après les autres.
Je ne suis même pas bien sûr que la mare à Pompon soit encore à sa place.
Mais il n’y a pas que de ce côté du fleuve où la main du temps ait laissé des traces de son passage.
Québec aussi – oui, mon ami, Québec lui-même ! – se transforme petit à petit.
La basse ville a vu deux maisons se construire dans les dix dernières années ; Saint-Roch prend des allures commerciales sérieuses ; Saint-Sauveur s’allonge et se donne le luxe d’une église décorée par un vrai peintre.
Une gare de chemin de fer longe l’anse où ne débarquaient autrefois que les huîtres de Caraquette et les harengs du Labrador.
Les vieilles portes militaires sont démolies, et remplacées, pour la plupart, par des barrières à tournure féodale, avec mâchicoulis et échauguettes en poivrières, – un éloquent défi au statu quo traditionnel.
L’ancienne cathédrale, devenue basilique cardinalice, a refait sa toilette.
Il y a le bassin Louise, le nouveau parlement, un palais de justice neuf, deux clubs d’amis, où l’on se dévore encore mieux que dans les sociétés patriotiques ou de Secours mutuel.
L’historique château Saint-Louis est allé rejoindre les ruines du collège des Jésuites et du vieux poulailler législatif où s’est bâclée la constitution qui nous rend heureux depuis 1867.
Et – circonstances qui frapperont nos neveux d’admiration – la rue Saint-Jean a failli s’élargir, après quarante ans d’efforts ; et l’on commence, paraît-il, à construire un hôtel aux dépens de la Confédération, représentée par mon ami Van Horne !
Faut-il noter d’autres progrès et d’autres disparitions ?
Le cheval de pain d’épice, le bâton de crème, les bull’s eyes, la planchette de tire, le baril de bière d’épinette, sont des institutions du passé. Les paniers de bric-à-brac s’éloignent peu à peu des places publiques. Les commis de la basse ville et de la côte de la Montagne ne racolent
presque plus les chalands au coin des rues.
La « botte à Barbeau », qui fut longtemps un des plus importants points de repère de la capitale, a quitté ses crochets légendaires.
Et le cabriolet à soupente des anciens jours – la calèche, comme on l’appelle encore – s’il n’est pas classé un de ces quatre matins parmi les reliques de quelque amateur d’antiquités, sera bientôt remisé dans le compartiment réservé aux vieilles lunes.
Plus de garnison anglaise !
À peine quelques artilleurs indigènes arpentant les rues et portant des sabres – comme leurs casquettes, du reste, qui ne leur couvrent jamais que la moitié d’une oreille – pour le principe.
Plus de vieux notaires ou d’anciens greffiers en retraite, allant prendre le frais à cinq heures du matin, sur la Terrasse, en robe de chambre et en pantoufles !
Les maisons, lourdes et basses, sont bien encore assises sur le fin bord des trottoirs ; mais on voit percer ça et là, sous l’arcade des nouvelles barrières et dans le fouillis des cheminées monumentales, les toits à tourelles de constructions plus sveltes et plus modernes.
Les dieux s’en vont !
Bref, mon pauvre Edgar, le cadre de nos premières impressions n’est plus du tout le même.
Ce que nous avons appris à aimer ensemble nous quitte.
Ce qui a fait la gaieté ou la poésie de notre printemps s’efface.
Le passé non seulement n’est plus, mais encore les derniers vestiges qu’il avait laissés derrière lui, comme une traînée d’ombre ou de soleil, s’oblitèrent rapidement.
C’est pour cela que j’ai écrit ces pages.
C’est pour cela que j’ai écrit ces pages, où tu verras revivre quelques-unes de nos années de jeunesse, à côté des physionomies pittoresques qui en ont égayé certains côtés un peu ternes parfois, et dont j’ai voulu, par reconnaissance – je parle des physionomies – rappeler le souvenir.
Il ne faut pas trop mépriser ces types bizarres.
La société serait bien plate, et son aspect bien monotone, si elle n’était pas un peu accidentée et comme bigarrée par ces excentriques personnages à panache polychrome qui en accentuent la variété des teintes, en brisent la tonalité trop persistante.
Du reste, si l’histoire des nations forme, pour celles-ci, un patrimoine précieux, les annales anecdotiques des peuples ont aussi leur importance.
Mieux que la chronologie des grands événements, quelquefois, elles affirment le caractère d’une race, et donnent le secret de certains problèmes sur lesquels se heurte souvent la sagacité de ceux qui ont le plus consciencieusement étudié l’humanité, et médité sur ses inconséquences apparentes.
Loin de moi, cependant, l’ambition de poser à l’historien.
Au contraire – et je désire que le lecteur note bien ceci – on ne doit pas attendre de ces monographies une exactitude historique trop scrupuleuse.
J’ai dessiné mes personnages tels que je les ai vus, ou tels qu’on me les a racontés, sans m’inquiéter de l’absolue vérité des détails.
Pour moi, il est de peu d’importance que tel individu soit né ou mort dans une paroisse ou dans une autre, quelques années plus tôt ou quelques années plus tard.
Si les portraits sont ressemblants, les accessoires peuvent être plus ou moins fidèles, sans gâter le tableau.
Ne pas chercher la petite bête !
Quand l’anecdote est bien en couleur, quand elle est dans la note du personnage, et surtout quand elle est amusante, que désirer de plus ?
Lorsque je rapporte ce que j’ai vu, je le fais avec autant de fidélité que ma mémoire peut me le permettre ; et si ce qu’on m’a raconté me paraît vraisemblable, je le consigne de même, en y mettant le cachet probable, sans jamais me donner la peine – en matière de cette sorte ce serait du temps perdu – d’aller aux sources pour contrôler aucun détail.
Pourvu que la synthèse du modèle s’accuse bien en relief ; que le fond soit d’une nuance plus ou moins conforme à la vérité absolue, que nous importe, après tout ?
C’est là un point sur lequel il est bon de s’entendre avec le lecteur ; la précaution évitera peut-être une peine inutile à qui pourrait trouver, dans mes récits, matière à correction ou à contradiction.
Autre chose.
Si j’ai rangé mes Originaux et Détraqués sous l’étiquette générale de types québecquois, bien que plusieurs d’entre eux n’aient jamais réellement habité Québec, c’est que, à tort ou à raison, pour toute la partie haute du pays – d’Ottawa à Trois-Rivières, et de Montréal à Saint-Jean – un Québecquois n’est pas précisément un homme domicilié dans la ville même de Québec, mais un habitant des environs.
Il lui suffit même souvent d’être né dans le bas du fleuve.
J’ai entendu dire plus d’une fois à Montréal : « C’est un Québecquois, il est de Rimouski. »
J’ai donc pris mes types, mon cher Edgar, non seulement dans la ville de Québec, mais aussi dans le district, – surtout à Lévis, où je suis né, et où nous nous sommes connus.
Cela n’était pas nécessaire, cependant, pour remplir le cadre de mon ouvrage.
J’aurais pu me restreindre aux limites de la bonne vieille ville, et trouver là ample matière à plus d’un volume du même genre.
Car, en fait de types originaux, je ne crois pas qu’il soit un endroit sous la calotte du ciel qui puisse se vanter d’en avoir produit un aussi grand nombre.
Je pourrais citer, par exemple, tel avocat, célèbre par ses saillies, jurisconsulte éminent, inférieur à personne au parquet, et qui, sorti de là, devenait le plus exécrable bohème qui ait jamais traîné ses loques et son ivresse à travers la création.
Tel médecin, excentrique dans ses habitudes, excentrique dans sa mise, excentrique chez lui, excentrique au dehors, savant remarquable, discoureur subtil, qui passa soixante ans de son existence à mystifier ses contemporains par des fumisteries de carabins, quand il n’exposait pas ses jours, pour les soigner gratuitement, pendant les épidémies.
Tel autre citoyen riche et sérieux, instruit et distingué, qui resta fiancé plus de soixante ans, sans jamais manquer un soir la petite promenade à deux, pendant que les meubles achetés pour le ménage, soigneusement paquetés et ficelés, attendaient la noce au fond d’un grenier.
Tel opulent propriétaire-rentier, qui vivait de ce qu’il ramassait la nuit dans les seaux à détritus, et qui est mort dans une soupente où il se chauffait avec de vieux papiers recueillis aux abords des imprimeries.
Et ce marchand – intelligent sur tout le reste – qui n’entrait jamais dans une église, de peur que la voûte ne lui tombât sur la tête !
Et ce délicieux musicien, Français conduit chez nous par le hasard, qui dépensait en une nuit tout le produit d’un concert – les concerts étaient productifs à cette époque – et qui, le lendemain, empruntait un mouchoir pour aller le vendre, afin de se faire raser !
Et cet agent d’assurances qui croyait avoir perdu sa journée, et restait taciturne jusqu’au soir, quand il n’avait pas assisté à un enterrement le matin !
Et ce saint prêtre qui ne voulut jamais dire la messe, parce qu’il s’imaginait que l’évêque, en l’ordonnant, n’avait pas prononcé tous les mots sacramentels !
Et cet hôtelier qui – longtemps avant la légende de Sarah Bernhardt – a gardé, durant vingt ans au moins, dans sa chambre à coucher, le cercueil qui devait le porter au cimetière !
Et ce célèbre prêteur d’argent qui, comme accompagnement à quatre orgues de Barbarie engagés pour la circonstance, jouait lui-même de la grosse caisse au mariage de sa fille !
Et enfin – pardon de faire un pareil méli-mélo – l’inénarrable Honoré, le roi des joyeux vivants, le prototype des bons garçons, l’intarissable robinet à plaisanteries, qui parlait latin comme un archevêque, et qui n’a jamais eu de rival, le coude sur la nappe, pour cligner un œil gaulois devant le petit verre cosmopolite !
J’en passe et des meilleurs.
Sans compter que... j’omets les vivants.
En fait d’originaux surtout – car il ne faut pas confondre ceux-ci avec les détraqués – la nomenclature québecquoise n’a pas de bout. À quoi cela tient-il ?
Comment se fait-il qu’on ne rencontre pas ailleurs ces types étranges, ou, tout au moins, en semblable agglomération ?
Est-ce dans l’air ?
On le soupçonnerait.
Mais je crois plutôt à l’influence des milieux.
À la mode, un peu ; à la contagion, beaucoup.
Un centre restreint, toujours le même – par conséquent sujet à l’atavisme – reproduit souvent les mêmes figures physiques.
Pourquoi pas les mêmes figures morales ?
Et, quand la tendance morale est l’exagération dans les caractères, dans les vêtements, dans les accoutumances, dans les attitudes, dans les démarches, dans les propensions, pourquoi cette tendance ne se propagerait-elle pas et par l’hérédité et par le coudoiement – par l’atmosphère ambiante, si l’on veut ?
Quoi qu’il en soit, Québec n’est pas seulement une ville typique par sa position géographique, par sa situation topographique spéciale, par son site sans parallèle en Amérique, par son passé héroïque et légendaire, par son aspect physique et ses conditions morales exceptionnelles, c’est la patrie des originaux.
Qu’ils soient hommes d’esprit ou pauvres détraqués, c’est la patrie des originaux – c’est-à-dire de ceux qui sont quelqu’un, ce qui est plus rare qu’on ne le pense.
Plus que cela, quand elle ne leur donne pas naissance, on dirait qu’elle les attire par quelque influence mystérieuse.
Pour ne parler que des hommes d’esprit – dont quelques-uns planent déjà dans l’histoire – si Garneau naît à Saint-Augustin, Ferland et Fabre à Montréal, Routhier à Sainte-Thérèse, Legendre à Nicolet, et Buies on ne sait où ; Buies, Legendre, Routhier, Fabre, Ferland et Garneau sont morts ou mourront à Québec.
Et, plus que cela, si un homme de génie voit le jour à Saint-Lin, c’est pour aller briller au parlement comme député de Saint-Roch de Québec – une division électorale qu’on s’acharne (qu’est-ce que la politique ne peut pas faire ?) à nommer Québec-Est, bien qu’elle soit à l’ouest !
C’est incroyable, mais c’est cela.
Ce bon vieux Saint-Roch – un peu fou peut-être – mais où circulera et vibrera, toujours chaude et généreuse, la dernière goutte du sang chevaleresque que la France a légué à l’Amérique !
Mon cher Edgar, c’est parce que tu sais tout cela, que tu connais le décor, et que tu apprécies mes compatriotes avec plus de justice que ne le font un certain nombre des tiens, que j’ai pensé à te dédier mon petit ouvrage sans importance, je le sais, mais aussi sans prétention.
Puisses-tu ne pas avoir plus de répugnance à le feuilleter que je n’ai eu d’ennui à l’écrire.
Montréal, 15 août 1892.
L. F.
I. Oneille
I
Pourquoi, lorsqu’on parle de Québec, est-on toujours porté à dire « la bonne vieille ville » ?
Cela n’est certainement pas dû à ses traditions guerrières et chevaleresques, ni à l’aspect grandiose de son site presque sans rival au monde – pas plus qu’à la physionomie quelque peu rébarbative que lui prêtent sa menaçante citadelle et sa longue ceinture de canons accroupis comme des dogues.
Cela n’est pas dû non plus à ses ruelles étroites et tortueuses, où les trottoirs ont l’air de se tasser le long des murailles pour laisser passer les piétons sur la chaussée.
Non ; ce titre de « bonne vieille ville », qui réveille on ne sait quelle idée de bonhomie familière et douce, Québec le doit principalement aux moeurs patriarcales, pour ne pas dire à l’allure un peu surannée de sa population.
Nulle part ailleurs ne rencontre-t-on, si nombreux et si caractérisés, ces respectables citadins aux habitudes régulières comme un mécanisme de jaquemart, flottant dans ces longues redingotes aux basques pendantes, si fort en vogue il y a quarante ans, bons bourgeois cravatés à la polonaise, qu’on dirait descendus tout d’une pièce de ces moulures bronzées dont Plamondon encadrait ses toiles vigoureuses, et Théophile Hamel ses portraits aux fins coups de pinceau.
Nulle part, sur le continent, ne retrouve-t-on, relevées comme ici par une pointe de sans-gêne pleine de saveur, ces charmantes manières, quelque peu ancien régime, qui rappellent vaguement l’exquise odeur de vétusté enfermée au fond des tiroirs aux souvenirs.
Mais en réalité quelle différence entre le Québec d’aujourd’hui et le Québec d’il y a cinquante à soixante ans, par exemple !
Les vieux ne s’y reconnaissent plus.
C’est de leur temps, paraît-il, qu’on était patriarcal pour tout de bon dans la « vieille ville ».
Si vous le voulez bien, nous allons remonter ensemble jusqu’à cette époque lointaine, pour étudier le caractère d’un de ces bons types du Québec de jadis, type que la tradition a fait légendaire.
II
L’original s’appelait Jean-Baptiste Oneille.
Il cumulait les fonctions de bedeau de la cathédrale avec celles de barbier de l’évêché.
Ce double poste, il l’occupa successivement sous Mgr Plessis, sous Mgr Panet et sous Mgr Signaï, jusqu’à sa mort, – environ une cinquantaine d’années en tout.
Un peu à cause de son nom qui, pour la forme, ressemble à celui d’O’Neil, et peut-être aussi à cause de sa tournure d’esprit qui tenait beaucoup de ce qu’on appelle l’Irish wit, on a cru longtemps qu’Oneille était d’origine irlandaise.
Le Dictionnaire Généalogique de Mgr Tanguay est venu démontrer, depuis, qu’Oneille était français et bien français.
Son père, Pierre Onel, – c’est l’épellation que donnent les anciens registres – perruquier, de Talmès, en Bourgogne, était venu s’établir dans le pays en 1753.
Jean-Baptiste était né trois ans après, et avait embrassé la profession paternelle, qu’il exerça toute sa vie à Québec, où ses bons mots, ses reparties, ses spirituelles saillies, ses fumisteries inoffensives et son inénarrable gaieté lui ont fait une réputation qui dure toujours.
Doué d’une vivacité d’esprit extraordinaire, et d’une originalité de caractère qu’accentuait encore la plus drolatique figure qui se puisse imaginer, il fit les délices de plusieurs générations québecquoises, tant dans le clergé que dans le monde des laïques.
Partout où il se montrait, il était irrésistible.
Demandez à ceux qui l’ont connu, si Oneille a jamais été pris sans vert.
Ce Gaulois était en outre doublé d’un philosophe.
Nul n’a pris la vie plus allègrement que lui ; nul plus que lui n’a envisagé l’existence par son côté plaisant, dans la double acception du mot.
Jamais contrariété n’a su altérer sa bonne humeur ; jamais déconvenue, jamais malheur même – car l’infortune a quelquefois frappé à sa porte – n’a pu déconcerter la sérénité de son heureuse nature.
Le fait est qu’il ne fut jamais si amusant que sur son lit de mort.
On cite de lui je ne sais quelles centaines d’anecdotes plus ou moins désopilantes. Il y en aurait de quoi faire un volume.
Malheureusement la plupart sont trop lestes ou trop grasses pour pouvoir être rapportées ici.
C’est à peine si l’on peut signaler par-ci par-là quelques traits de cet esprit si prompt à la riposte, et si fécond en charges divertissantes.
Sa vie tout entière fut une plaisanterie perpétuelle.
En 1784, on le trouve marié à une excellente femme du nom de Thérèse Aide-Créquy, et habitant une maison située à l’extrémité supérieure de la petite rue Saint-François, aujourd’hui rue Ferlantd, ainsi nommée d’après l’éminent historien.
La noce – ce qui ne surprendra personne – n’avait été qu’une longue suite de drôleries.
Impossible, naturellement, de tout raconter.
À la lecture du contrat, le notaire lui-même dut renoncer à soutenir la réputation de gravité traditionnelle dans sa profession. Ce fut un éclat de rire d’un bout à l’autre.
– Comment ! objectait Oneille du ton le plus sérieux du monde ; comment, vous dites « dans le cas où il y aurait des enfants ! » Ce doute me fait injure. Il y aura des enfants, monsieur le notaire. Mettez qu’il y en aura !
Après avoir signé, il passa la plume à sa future avec un gros soupir ; et quand celle-ci eut à son tour apposé sa griffe, il s’écria d’un accent désespéré :
– Me voilà donc condamné à m’ennuyer toute ma vie !
– Comment cela, mon ami ? s’écria la jeune mariée toute surprise.
– Dame, écoute : l’Évangile dit que les époux ne forment plus qu’un. Or, quand on n’est qu’un, on est tout seul ; et quand je suis tout seul, moi, je m’ennuie !
Dès les premiers jours de son ménage, le fin matois trouva le moyen d’éviter une corvée qui l’aurait fait pester au moins deux fois par semaine pour tout le reste de son existence.
– C’est aujourd’hui jour de marché, lui dit sa femme, un bon matin ; nous manquons de beurre, il faut aller en chercher, n’est-ce pas ? – Volontiers, ma chère.
– As-tu de l’argent ?
– Jamais de la vie, c’est contre mes principes.
– Alors voici vingt-cinq francs en or (on comptait encore par francs à cette époque) ; tu feras changer.
– Parfait.
Et voilà le nouveau marié parti pour le marché, un panier au bras. Dix minutes après, il rentrait en disant :
– J’en ai pris trois livres ; tiens, nous en avons pour longtemps. – Très bien ; et la monnaie ?
– Quelle monnaie ?
– La monnaie des vingt-cinq francs donc !
– La monnaie des vingt-cinq francs ?
– Eh bien, oui, qu’en as-tu fait ?
– Ce que j’en ai fait ?
– Oui ; vas-tu parler !
– Je ne sais pas, moi... Je n’en ai rien fait... On ne m’en a pas remis...
– Comment ! tu n’as pas rapporté de monnaie ! Tu as donné un vingt-cinq francs tout rond pour trois livres de beurre ! Eh bien, c’est du propre. Plus que ça d’hommes d’affaires... Tu n’es pas près d’y retourner au marché, mon homme. C’est moi qui me charge de la besogne.
C’était tout ce que le farceur voulait.
Il baissa la tête d’un air confus, mais riant dans ses barbes, – fier d’avoir si bien réussi.
Sa femme – qui fit toujours le marché par la suite – répétait souvent
:
– C’est bien étrange; Jean-Baptiste est intelligent, tout le monde le dit. Eh bien, il ne sait pas compter l’argent; jamais il n’a pu faire le marché.
La bonne dame avait sans doute épousé le bedeau de Québec pour ses autres qualités, mais à coup sûr elle ne l’avait pas aimé pour les charmes de sa personne.
Il était d’une laideur épique.
Non pas, il est vrai, de cette laideur repoussante qui unit la bassesse de l’expression à la hideur des traits ; mais de cette laideur comique, burlesque, qui attire les regards et provoque l’hilarité.
Il avait de petits yeux gris, bridés, louchant ou biglant à volonté, et si bien maîtrisés que souvent l’un des deux riait à vous faire éclater, pendant que l’autre pleurait à chaudes larmes.
Ses yeux, du reste, n’étaient pas seuls à posséder cette étrange faculté de rire et pleurer simultanément ; il en était de même pour son visage tout entier.
Quand il le voulait, d’un côté, c’était Héraclite, et de l’autre, Démocrite, et vice versa.
Au milieu de cette bizarre combinaison, s’épatait un nez retroussé comme le pavillon d’un cor de chasse, au-dessus d’une lèvre supérieure qui semblait s’allonger avec effort pour maintenir une position normale.
Ajoutons une perruque rouge queue de vache, hirsute, mal peignée, qui ne sut jamais tenir en place ; et l’on aura une légère idée des attraits physionomiques de notre héros, au moins sur ses vieux jours.
J’ai dit que cette perruque était rousse ; entendons-nous, elle ne le fut pas toujours.
Dans cette circonstance, elle changea de couleur.
Oneille – comme perruquier la chose lui était facile – apparut un dimanche à l’église avec une perruque d’un beau noir de jais.
– Tiens, fit Mgr Panet, après l’office, vous avez bien rajeuni, maître Oneille ! Vous voilà avec des cheveux noirs ; j’ai eu peine à vous reconnaître.
– Hélas ! Monseigneur, répondit Oneille d’un air triste, je suis en deuil ! En effet, il avait perdu sa mère.
Les fermiers, qui à cette époque venaient vendre leurs denrées sur la place de la cathédrale, étaient surtout l’objet de ses mystifications.
Dieu sait quelles incommensurables couleuvres son aplomb sans pareil fit avaler à leur naïveté !
Un jour, l’un d’eux s’approche de lui :
– Connaissez-vous M. Oneille, le bedeau ? – Comment donc, c’est mon meilleur ami.
– Vrai ? Y paraît qu’il est ben drôle, c’pas ?
– Drôle ! Y a pas de singe pour le battre.
– Sac à papier ! que je voudrais t’y ben voir c’t’homme-là ! – C’est facile, je peux vous le montrer tout de suite. – Dites-vous ça pour tout de bon ?
– Beau dommage ! Vous avez votre voiture ? J’ai affaire au faubourg ; conduisez-moi, vous le verrez tant que vous voudrez.
Et les voilà partis parcourant la ville en tous sens, Oneille faisant arrêter la voiture à chaque instant pour entrer dans les magasins, hélant celui-ci, causant avec celui-là, – tuant le temps à petites étapes.
Il avait dit à son conducteur avant de partir :
– Tâchez de le reconnaître : je vous laisserai deviner. Mais le malheureux ne devinait pas, on sait pourquoi.
En revanche il guidait son cheval d’une main, et de l’autre se tenait les côtes.
Cependant le temps avançait.
– Sac à papier, dit-il en désespoir de cause, est-ce que nous le verrons pas ben vite, vot’ monsieur Oneille ?
– Mais sapristi, vous êtes bien exigeant ; voilà deux heures et demie que vous le regardez.
– Où ça ?
– Ici ! c’est moi. Vous ne feriez pas fortune à deviner, vous !
On n’a pas besoin de se demander si le bon habitant faisait une tête.
– C’est égal, disait-il, quelques instants après, à ceux qui lui demandaient ce qu’il était devenu pendant tout ce temps ; c’est égal, j’ai perdu une matinée, mais j’ai ben ri pour trois mois.
III
Autre anecdote.
– M’indiqueriez-vous où je pourrais acheter du son ? lui demande, dans une autre occasion, un paysan à l’air niais, qui avait une poche à la main.
– Du son ? fait Oneille avec empressement ; vous ne pouviez pas mieux tomber, j’en vends.
– Vous en vendez ?
– Vous l’avez dit.
– Du bon ?
– J’en ai de plusieurs qualités ; venez voir.
Et les voilà, l’un devant l’autre, à grimper les escaliers en spirale du clocher à lanternes de la vieille cathédrale.
– Diable ! geint le campagnard tout essoufflé, vous le mettez ben haut, vot’son !
– Je le tiens à l’air, ça l’empêche de moisir.
Et le pauvre naïf montait toujours en grommelant
:
– Aller remiser du son à c’te hauteur-là ! Ces gens de la ville ont des idées...
Enfin, l’on atteint la cage du carillon.
– Ouf !... fait le paysan à bout d’haleine.
– Tenez, mon ami, dit Oneille, en faisant tinter le battant d’une des cloches. Voici du son de différents prix, choisissez. J’en vends à tous les baptêmes et à tous les enterrements.
L’histoire ne nous dit pas lequel des deux dégringola plus vite les escaliers ; du blagué ou du blagueur.
Une autre fois, comme Oneille se promenait à l’entrée de la ruelle qui conduit au parloir du petit séminaire, un autre habitant, qui n’avait pas l’air d’avoir inventé la corde à tourner le vent, l’aborde en lui disant, le chapeau à la main
:
– Respect que j’vous dois, Monsieur, pourriez-vous pas me dire par éous, qu’on rentre au suminaire ?
– Vous avez envie de faire vos études ? lui demande Oneille.
– Non, Monsieur, pas directement ; je voudrais tant seulement voir mon neveu, un p’tit Bolduc de Beauport.
– Ah ! vous êtes l’oncle du petit Bolduc de Beauport !
– Oui, Monsieur ; vous le connaissez p’têt’e ben ?
– Si je le connais ! Je suis le bedeau de la cathédrale : j’ai aidé à le recevoir prêtre dimanche.
– Il est reçu prêtre ! C’est pas possible.
– Pourquoi pas ?
– Mais il vient d’entrer ; y commence.
– Ça ne fait rien, ça ; vous savez pas qu’ils font faire les études à la vapeur maintenant ?
– Tout de bon ?
– Eh ! oui... par la steam... C’est une nouvelle invention américaine. Il n’y a rien de plus drôle. On vous déniaise un petit habitant de Beauport en quelques tours de roues.
– Vous blaguez !
– Ma parole d’honneur ! Une machine rare, allez ! – Vous avez qu’à voir !
– Vous voudriez la voir ?
– Ma foi, c’est pas de refus. Y font-y payer pour ça ?
– Pour voir la machine, non ; mais pour passer dedans, ça coûte quelque chose.
– Ça me surprend point. Ils ont-y essayé ça sur les grandes personnes ? – Oui, mais il paraît que c’est pas fameux pour la santé. – Comment ça ?
– Eh bien, la semaine dernière, ils ont déniaisé un habitant de Saint-Gervais ; et le lendemain il a fallu aller chercher le docteur Painchaud. – Pourquoi donc ?
– Il avait attrapé le torticolis à lire dans les astres. – Tiens, tiens... pas accoutumé !
– Justement.
– Eh ben, mon cher Monsieur, fait le brave homme, vous me croirez p’têt’e pas, mais, à la peine d’être ben malade moi étout, je donnerais la moiquié de ma terre pour me faire... pour me faire... instruire de c’te façon-là, moi.
– Vous n’avez pas besoin de ça, vous ; vous me paraissez à votre aise... – C’est vrai que j’ai de quoi ; mais, je peux ben vous le dire, à vous, là : si j’étais tant seulement assez instruit pour lire dans le P’tit Albert, comme j’en connais, j’aurais de l’argent, tenez ! de l’argent... pour vous en donner, quoi !
– Vraiment ? c’est une idée, ça, fait Oneille sur le ton du plus haut intérêt : vous n’êtes pas plus bête que vous en avez l’air, vous... Eh bien, écoutez ; c’est pas de mes affaires, mais je ne veux pas que vous manquiez cette chance-là. Je vais vous conduire chez le directeur. Vous m’excuserez si j’entre pas : nous avons eu quelque chose ensemble dernièrement. Mais vous vous arrangerez bien avec lui : il ne jure que par les gens de Beauport.
On se figure l’ahurissement du brave directeur – M. l’abbé Gingras – en présence de cet homme qui, cinq minutes après, lui parlait du « p’tit Bolduc reçu prêtre dimanche, d’invention américaine, d’un habitant de Saint-Gervais malade du torticolis et des mouvements à steam du suminaire ».
Cette fois, l’on n’attendit pas jusqu’au lendemain pour faire venir le docteur Painchaud.
IV
La causticité d’Oneille n’épargnait guère plus les augustes personnages avec qui ses fonctions de figaro, de « barbier apostolique », comme il s’intitulait volontiers, le mettaient en rapports aussi intimes que journaliers.
Il les servait souvent à la jocrisse, et montait tout aussi bien une scie à un prince de l’Église qu’à un cocher de la place.
En premier lieu, il était maître partout.
– Mais je suis dans mon évêché, en somme ! lui disait un jour Mgr Panet impatienté.
– Et moi, s’écriait Oneille, est-ce que je n’y suis pas, dans votre évêché ?
– Je viendrai un peu plus tôt demain matin, n’est-ce pas ? demandait-il un jour à Mgr Plessis, qui venait d’éprouver un cruel désappointement, et qui, contre son habitude, le laissait un peu trop voir.
– Pourquoi donc ? fait l’évêque.
– Dame, Monseigneur, quand les visages sont plus longs, il faut un peu plus de temps pour les raser.
Un beau matin, pendant qu’il rendait ce service à Mgr Signaï, un domestique entre :
– Une dame désirerait voir Monseigneur.
– Je n’y suis pas !
– Dites que Monseigneur est dans ses absences, fait Oneille.
Le mot était piquant, car le bon archevêque passait alors pour connaître un peu les infirmités de l’âge.
Le fait est que les hardiesses du vieux bedeau, bien que sans méchanceté réelle, frisaient quelquefois terriblement l’impertinence.
Voici une de ses dernières malices à l’adresse du même Mgr Signaï, qui dut la subir sans se plaindre sous peine de coiffer le bonnet.
– Si vous ne voyez pas cela, lui avait dit le vieil évêque, c’est que l’âge vous affaiblit la vue.
– Hélas ! Monseigneur, répondit Oneille, il n’y a pas que ma vue, qui se détériore en vieillissant. Tenez, tout le monde ne se rend probablement pas compte de ça comme un bedeau, mais plus je vieillis, moi, plus je m’aperçois que je deviens bête.
Oneille avait si bon cœur, au fond, et il était en outre si bien passé à l’état de vieille institution, qu’on ne pouvait s’empêcher de lui manifester beaucoup d’indulgence.
On lui pardonnait tout.
Un jour, il faisait voir au directeur du séminaire, le même M. Gingras dont j’ai parlé plus haut, toute une famille de petits cochons qu’il élevait dans sa cour, en dépit des règlements municipaux.
– Mais, lui fit remarquer le bon prêtre, votre auge est trop petite, maître Oneille ; c’est à peine s’ils peuvent manger quatre là-dedans.
– Je le sais bien.
– Mais vous en avez cinq !
– Eh dame, ils feront comme au séminaire : pendant que les autres mangeront, il y en aura un qui fera la lecture spirituelle. Et le vieux prêtre de sourire à la malice.
Au surplus, si l’on se fâchait, vite un mot pour rire, et les mécontents désarmaient tout de suite.
Une fois, pourtant, la disgrâce faillit être sérieuse. Avouons qu’il y avait de quoi.
C’était un jour de Pâques.
Rien de solennel comme une cérémonie pontificale dans la cathédrale de Québec.
Cette nef élevée, où la voix des orgues roule si majestueusement ; ce vaste choeur où la pompe épiscopale se déploie avant tant d’éclat ; cet autel surmonté d’un baldaquin aux proportions et à l’aspect si magistralement imposants, tout contribue à produire un effet avec lequel on ne se familiarise pas.
Qu’on le demande aux habitués.
Ce jour-là, le coadjuteur, Mgr Turgeon, officiait, et l’archevêque, Mgr Signaï, occupait le trône archi-épiscopal.
Jean-Baptiste Oneille, en grand uniforme chevronné d’or et bordé de rouge, était assis dans le bas choeur, près du pain bénit, portant à la main, aussi gravement que possible, le traditionnel pedum à viroles d’argent.
Tout à coup – je ne sais plus à quel moment du service divin – voilà l’enfant de choeur le plus rapproché d’Oneille qui se met à bâiller.
Puis son voisin.
Puis un autre.
Puis un autre...
Enfin, voilà une longue rangée de petites bouches démesurément ouvertes sur toute la ligne.
Qui voit bâiller bâille.
L’épidémie traverse le choeur, gagne les rangs plus élevés, envahit les stalles.
Les séminaristes bâillent.
Les vieux prêtres bâillent.
L’archevêque lui-même – ô scandale ! – bâille sous son dais à se décrocher la mâchoire.
Ce n’est pas assez.
On se met à bâiller dans la nef ; et la maladie, se propageant d’un banc à l’autre, s’empare de tous les assistants.
Les chantres de l’orgue eux-mêmes ne peuvent plus ouvrir la bouche que pour bâiller.
C’était Oneille – il était si curieux à voir que tout le monde le regardait – qui avait donné le signal de ce bâillement général, et qui recommençait aussitôt que la contagion nerveuse faisait mine de décroître.
Quand on s’en aperçut, les uns rirent beaucoup ; mais Mgr Signaï ne le prit pas si gaiement.
L’archevêque indigné conclut sa verte semonce au coupable en lui défendant de jamais « remontrer sa face devant lui ».
Le lendemain, à l’heure de sa toilette, le prélat vit apparaître un être étrange, qu’il ne reconnut pas d’abord, et qui lui faisait des saluts grotesques.
Oneille avait tourné sa perruque, noué sa cravate, et passé son habit sens devant derrière, et, dans cet accoutrement saugrenu, se présentait à reculons, son rasoir et son pinceau à barbe à la main, se conformant à l’ordre qui lui avait été signifié de ne pas montrer sa face devant l’archevêque.
L’apparition était si cocasse, que celui-ci fut pris de fou rire, et rendit ses bonnes grâces au spirituel bedeau.
V
Comme on le pense bien, l’esprit d’Oneille n’était pas moins intarissable dans son atelier de coiffeur.
Un de ses clients arrive un matin, très pressé :
– Père Oneille, dit-il en entrant, pouvez-vous me raser en un temps et deux mouvements ?
– Ça dépend, répond le vieux ; pourvu que vous me laissiez prendre le temps pour faire les mouvements.
Le lendemain, c’est un jeune blanc-bec dont les joues s’estompent à peine d’un duvet de pêche, qui lui demande le prix d’une barbe...
Oneille le fait asseoir, lui enveloppe le cou d’une serviette, lui passe le blaireau plein de mousse blanche sous le nez, promène rapidement son rasoir sur le cuir, puis s’assied, prend une gazette et s’absorbe. – Eh bien, fait le jeune étourneau, que faites-vous là ? – Vous le voyez, je lis.
– Et ma barbe ?
– Parbleu, j’attends qu’elle pousse.
Il se faisait beaucoup d’inhumations, autrefois, dans le sous-sol des églises, et les fidèles qui fréquentaient la cathédrale de Québec se demandaient, depuis un certain temps, si cela ne pouvait pas avoir quelque effet anti-hygiénique.
On s’imaginait même sentir des émanations cadavériques, et les nombreuses plaintes qui arrivaient aux oreilles des autorités provoquèrent une enquête.
Naturellement le bedeau fut appelé à donner son témoignage, et on lui fit subir un interrogatoire pressant :
– Avez-vous jamais senti quelque odeur dans l’église ? lui demanda-t-on.
– Des odeurs dans l’église ? oh ! oui, Monsieur ! – Quelle espèce d’odeurs ?
– Ah ! Monsieur, pas toujours de l’encens, allez. – D’où cela semblait-il venir ?
– Cela semblait venir de par en-bas, Monsieur. – Avez-vous senti cela souvent ?
– Oh ! oui, Monsieur, surtout le dimanche et les jours de grand’messe. – Qu’en concluez-vous ?
– J’en conclu que ces odeurs-là viennent bien plus des vivants que des morts !
Comme c’étaient les élèves du petit séminaire qui servaient les messes à la cathédrale, quelques-uns d’entre eux, pour se donner des airs, s’aventuraient parfois à plaisanter le vieux bedeau.
Mal leur en prenait la plupart du temps.
Un de ces jeunes gens voulut un jour tenter la partie.
– Dites donc, père Oneille, hasarda-t-il, pourriez-vous bien me dire quelle est la différence entre des œufs au persil et un bedeau à perruque ?
– Ah ! ça, mon ami, fait le bonhomme en se grattant l’oreille, c’est bien embarrassant ce que tu me demandes là. Allons, explique-toi, je jette ma langue aux chiens.
– Eh bien, reprend le potache triomphant, des œufs au persil font une omelette, et un bedeau à perruque fait un homme laid.
– Tiens, tiens, ça n’est pas bête du tout, ça. Mais, à mon tour, petit. Sais-tu la différence qu’il y a entre un érable bien entaillé et un collégien mal appris ?
– Non !
– Je sais, moi, dit maître Oneille. Écoute : un érable bien entaillé dégoutte jusqu’à l’été; et un écolier polisson dégoûte... jusqu’au bedeau.
J’ai connu cet élève, qui fut plus tard homme politique éminent, et même lieutenant-gouverneur quelque part.
Il m’a affirmé n’avoir jamais eu l’envie de recommencer.
J’ai dit, au début, qu’Oneille était un Gaulois doublé d’un philosophe. Le trait suivant en donnera la preuve.
Un soir d’hiver, le tocsin – seul avertisseur à incendies du temps – appela les pompiers rue Saint-François.
La maison d’Oneille flambait.
– Le feu est chez Oneille ! criait-on, allons lui porter secours !
On le trouva à l’entrée de la rue, les bras croisés, et qui regardait en souriant les tourbillons de flamme et de fumée monter vers le ciel. – Mais ce n’est donc pas chez vous qu’est le feu, père Oneille ? – Si.
– Mais vous n’avez pas l’air de vous en occuper... – Moi, ça m’est bien égal ; il n’y a que ma femme... – Qui se désole ? Certes...
– Pas du tout, ça lui fait plaisir.
– Ah bah !
– Parole d’honneur ! les punaises l’embêtaient depuis longtemps, ça règle l’affaire.
Or celui qui prenait les choses avec ce stoïcisme bon enfant perdait, ce soir-là, à peu près tout son petit avoir.
Le brave homme a d’ailleurs, comme je l’ai dit plus haut, badiné jusqu’au seuil de l’éternité.
VI
L’année 1832 fut lugubre à Québec. On l’appelle encore, dans les souvenirs populaires, « l’année du grand choléra ».
Durant deux mois, la terrible épidémie décima la population et porta la panique à son comble.
Les victimes – des centaines par jour – s’affaissaient dans les rues, et succombaient après quelques heures de souffrances épouvantables. On charroyait les cadavres à pleins tombereaux.
Presque aucuns de ceux qui étaient frappés n’en réchappaient.
Or le pauvre bedeau eut beau narguer le sort et la malchance, le fléau l’atteignit et le réduisit bientôt à la dernière extrémité.
Son confesseur ordinaire se trouvant absent, on courut à l’évêché mander un autre prêtre pour lui administrer les sacrements.
Ce fut à qui n’irait pas – non point qu’on craignît la contagion – mais chacun avait peur de ne pouvoir garder son sérieux pour la circonstance.
Enfin, un jeune prêtre du nom de Carrier – qui fut plus tard curé de la Baie-du-Febvre et joua un certain rôle dans les événements de 1837 – accepta la tâche, et se rendit auprès du moribond, qui se tordait dans des crises atroces.
– Allons, mon pauvre frère, lui dit-il, vous allez probablement paraître devant Dieu ; êtes-vous bien résigné à mourir ?
– Oh ! oui, il y a assez de soixante et seize ans que je vois la lune du même côté.
– Eh bien, il faut vous préparer du mieux possible. Vous avez la foi, je suppose...
– Oh ! oui, mon père, soupira le mourant... et même vous pourriez mettre une syllabe de plus sans mentir.
– Bien ; alors je vais vous administrer le sacrement de pénitence et l’extrême-onction...
– L’ordre et le mariage, si vous voulez ; dépêchez-vous.
– Eh bien, reprit le prêtre, vous allez d’abord m’ouvrir votre âme... – Ça ne sera pas difficile, j’ai déjà le corps à l’envers.
Le pauvre abbé suait à grosses gouttes, et se tenait à quatre pour ne pas éclater.
Enfin, après avoir, tant bien que mal, entendu la confession du malade, il lui présenta la communion en lui disant :
– Maintenant, mon cher frère, vous allez recevoir le corps et le sang de Notre-Seigneur...
– N’oubliez pas la Sainte-Vierge ! fit le vieillard d’une voix faible comme un souffle.
Le jeune prêtre n’y put tenir plus longtemps.
Il se hâta d’administrer le patient, et s’enfuit.
L’infortuné bedeau avait pour intime, M. Faucher de Saint-Maurice, l’aïeul de l’éminent écrivain.
Quand l’excellent homme eut appris la maladie de son camarade, il accourut.
– Allons donc, mon pauvre vieux, dit-il en entrant ; il paraît que ça ne va pas ?
– Au contraire, mon ami, au contraire : ça va trop ! – Il faut prendre courage, dis donc.
– Oui, je fais des efforts.
– Toutes tes affaires sont arrangées ?
– Elles n’ont jamais été mieux liquidées, mon ami ! Impossible de le faire sortir de là.
Oneille se rétablit cependant.
Il ne mourut que quatre ans plus tard, en 1836, à l’âge de quatre-vingts ans et quelques jours.
Une heure ou deux avant sa mort, qu’on ne croyait pas si prochaine, sa fille s’offrit de lui faire la barbe : il aimait à se sentir la figure nette.
– Laisse donc, dit-il, chère enfant ; le bon Dieu sait bien que les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés.
Sa dernière parole fut un mot de profonde philosophie :
– Je ne vous dis pas adieu !
II. Grelot
I
L’arrivée du prince de Galles à Québec, en août 1860, fut l’occasion de grande liesse.
Les drapeaux flottaient à toutes les hampes.
Les rues étaient brillamment pavoisées.
Et, dans le port – de la pointe de Sillery à Indian Cove – du haut des mâts et le long des drisses, des milliers d’oriflammes et de banderoles de toutes couleurs se déployaient dans la brise et miroitaient au soleil, – qui était superbe.
Les campagnes environnantes avaient donné la main à la ville ; et, sur les quais, les parapets et les terrasses, de tous les points culminants à la fois, une foule énorme se pressait, impatiente de contempler le jeune et sympathique héritier de la couronne d’Angleterre.
De longues files d’uniformes rouges se rangeaient en haies le long des rues.
Des escouades de cavalerie galopaient de ci et de là, avec de grands cliquetis de ferrailles.
D’un bastion à l’autre, des appels de clairons s’entre-croisaient avec le roulement des tambours et les éclats joyeux des fanfares lointaines.
Tout à coup, les quarante canons de la citadelle et de la grande Batterie tonnèrent ensemble, en même temps qu’un immense hourrah, poussé par cinquante mille poitrines, saluait le pavillon de l’escadre royale, qui venait de doubler la pointe de l’île d’Orléans.
La scène fut grandiose.
Les cuivres retentissaient ; les cornets à vapeur faisaient rage de toutes parts ; les cloches sonnaient en branle ; tout ce qu’une ville en rumeur peut fournir de clameurs et de bruits divers éclatait en fracas strident, ou se prolongeait en grondements sourds, dominés de seconde en seconde par la voix mâle des canons.
Le gros de la foule s’était naturellement porté aux abords du débarcadère et dans la côte de la Montagne, par où le brillant cortège devait passer.
C’est dans ce dernier endroit surtout qu’ondulait le flot le plus bruyant et le plus bariolé.
Là surtout grouillait le populaire endimanché, – tous ceux qui n’ont peur ni des poussées ni de la cohue, la multitude rieuse et folle.
C’était un spectacle unique que cet entassement compact de têtes groupées en amphithéâtre, et que partageait en deux masses bien tranchées un espace maintenu libre par deux lignes de baïonnettes serpentant du haut en bas de la longue pente.
Au premier coup de canon, toute cette houle de têtes joyeuses s’était ébranlée dans une formidable acclamation ; mais au fur et à mesure que les gros cuirassés entraient majestueusement dans le port, le premier enthousiasme faisait place à une impression plus solennelle, et des murmures confus comme le bruit des vagues succédaient de temps en temps à la frénésie des vivats.
Pendant une des accalmies un étrange incident se produisit.
Un vieillard à cheveux blancs, hérissé, sale, déguenillé, avait réussi à rompre les lignes et descendait la côte entre les deux haies de soldats, l’œil féroce et la main armée d’un énorme gourdin qu’il brandissait d’un air farouche.
À cette vue, un éclat de rire colossal, inouï, se fit entendre.
Puis un cri plus délirant encore retentit d’un bout à l’autre de la montée :
– Grelot !...
Impossible de raconter ce qui suivit.
Ce fut un hourvari, un brouhaha indescriptible.
Le vieux vagabond, poursuivi par les cavaliers chargés de maintenir la consigne, zigzaguait d’un côté de la rue à l’autre, montrant le poing, battant l’air de son gourdin, tantôt poussant des hurlements de défi, tantôt courbant le dos sous la huée.
– Grelot ! Grelot ! Grelot ! criait-on.
Et le malheureux, étranglé de fureur, l’écume aux lèvres, descendait toujours, essoufflé, suant, clampinant, buttant, et lançant à droite et à gauche je ne sais quelles malédictions qui se perdaient dans les rires de la masse et les cris de :
– Grelot ! Grelot !
Enfin le misérable, épuisé et à bout d’haleine, trébucha sur un pavé, et tomba sur ses genoux...
Les cris redoublèrent :
– Grelot !...
J’étais sorti du collège quelques semaines auparavant.
Ce fut là ma première expérience sérieuse des choses de la vie.
La même population, au même moment, sans passion ni méchanceté, saluant par des acclamations enthousiastes un jeune étranger, beau, heureux, fêté, choyé, tout-puissant, et poursuivant de ses avanies un pauvre vieillard privé de raison, déshérité de tout, pliant sous le fardeau des tristesses de ce monde, – mourant de faim peut-être !
J’en ai gardé un souvenir ineffaçable.
II
L’individu qui venait d’interrompre la fête publique, en créant cette diversion, était un étrange original bien connu de tout Québec, dont il a fait la gaieté durant plus d’un demi-siècle.
Qui de ma génération ne s’en souvient pas ?
Qui ne l’a pas un peu taquiné ?
Il s’appelait Langlois – Michel Langlois – de son vrai nom ; mais nombre de Québecquois, de ses voisins même, l’ont toujours ignoré. Tout le monde l’appelait Grelot, simplement Grelot. Et cela suffisait : il était connu.
Comment ce burlesque sobriquet lui avait-il été appliqué ? Cela se perdait dans la nuit des temps et dans l’incertitude des suppositions.
Probablement comme tous les autres sobriquets. Un hasard vous l’attire ; vous vous en fâchez, et vous en voilà affublé pour le reste de vos jours.
On raconte qu’un dimanche, en sortant de l’église du faubourg Saint-Roch, sa paroisse, Michel Langlois, qui était alors un jeune homme de bonne mine et de moyens, paraît-il, fit la remarque, sur un ton de mécontentement assez naturel, qu’un maladroit venait de lui froisser son haute-forme, – un castor tout neuf.
Que diable ! tout le monde n’a pas la patience d’un ange. – Satané grelot ! dit-il, il a bossué mon chapeau ! Pourquoi grelot ? on n’en sait rien.
Cette expression lui était peut-être venue sur les lèvres, à son insu, sans avoir dans son esprit aucune signification spéciale.
Il l’avait sans doute laissé échapper d’une manière inconsciente, sans y attacher aucune portée injurieuse.
Il avait dit grelot, comme il aurait dit toute autre chose. Mais il avait dit grelot.
Et ce mot-là devait peser d’un poids terrible sur sa destinée.
Grâce à lui, le jeune homme respectable et bien mis, plein de force et d’espérance, qui l’avait prononcé, vit tout s’écrouler autour de lui.
Il manqua sa carrière, perdit sa fortune et même son nom, traîna durant soixante ans une existence de paria, et mourut fou. Voici ce qui était arrivé.
Un gamin – il y en a toujours dans ces circonstances-là – qui avait entendu l’exclamation malencontreuse, frappé de la consonance des mots grelot et chapeau, se mit à fredonner, sans malice, mais sur un ton quelque peu gouailleur :
Satané grelot !
Qu’a bossué mon chapeau !
Satané grelot !
Qu’a bossué mon chapeau !
Michel, qui n’était pas d’humeur à goûter la plaisanterie, se fâcha, interpella le gamin, voulut lui imposer silence.
Ce fut bien pire.
L’incident tourna en charivari.
Les gamins – d’autres étaient venus à la rescousse – chantaient à tue-tête :
Grelot ! Grelot !
T’a bossué mon chapeau !...
Après les enfants, d’autres vinrent.
Les loustics de tous les âges s’en mêlèrent.
On ne chantait plus : « T’a bossué mon chapeau ! » on criait Grelot tout court :
– Grelot ! Grelot ! Grelot ! sur tous les tons et dans toutes les clefs, avec des accents suraigus de soprano et des ronflements de basse-taille, soutenus par un concert de glapissements, de miaulements et de hurlements sans nom.
Michel fut ramené chez lui par des personnes charitables, les vêtements en désordre, le chapeau fatal sur les yeux, et dans un état d’exaspération qui le retint trois jours au lit.
C’est là l’histoire qu’on racontait.
III
Après un pareil esclandre, le jeune homme fut longtemps sans se montrer en public.
Sa fierté humiliée, unie à une timidité naturelle, lui fit éviter même ses connaissances les plus intimes.
Il ne sortit que le soir, choisissant de préférence les rues désertes, glissant le long des murs, évitant les passants.
Ces allures insolites achevèrent ce que la scène de l’église avait commencé.
Des gavroches le suivirent en l’appelant : Grelot.
Il eut la mauvaise inspiration de s’emporter de nouveau. Cela fit rire, et les cris redoublèrent.
Le pauvre diable rentrait chez lui dans des colères folles, ne sachant où donner de la tête :
– J’en tuerai quelqu’un ! grondait-il entre ses dents.
Québec n’a jamais été une ville affairée ; elle l’était encore moins dans ce temps-là qu’aujourd’hui.
Bientôt le malheureux Langlois fit les frais de l’amusement général, et devint le souffre-douleur de tous les désoeuvrés.
Les cochers de place, les flâneurs qui baguenaudaient au coin des bornes, les commis debout aux portes des magasins, les soldats de la garnison, les élèves du petit séminaire, les enfants des écoles, ne pouvaient le voir passer sans crier, ou tout au moins murmurer l’ironique sobriquet, qui se répétait de bouche en bouche, parcourant la rue comme une traînée de poudre.
Alors c’étaient des accès de rage, des fous rires épileptiques, les femmes aux fenêtres, le diable dans le quartier.
À un moment donné, on entendait tout à coup des cris lointains, des tempêtes d’invectives, mêlés à des éclats de gaieté extraordinaire. – Voilà Grelot ! s’écriait-on.
Et petits garçons et petites filles, badauds et curieux, de se précipiter sur les trottoirs, gravissant les côtes ou dégringolant les escaliers pour aller prendre part à la fête.
Et le tohu-bohu grossissait, grossissait toujours, plus tumulteux et plus hostile, autour du malheureux énergumène, qui s’épuisait en efforts d’un comique inouï pour se venger au moins sur ceux qui pouvaient se trouver à sa portée.
La masse des criailleurs se tenait généralement à distance suffisante pour éviter les coups ; mais quelquefois – le hasard a de ces justices – la poussée de la foule jetait les plus agressifs sous la main de l’homme aux abois, dont la force et la colère devenaient alors réellement dangereuses.
Souvent aussi, il rusait.
Il faisait semblant de ne rien entendre, marchait droit devant lui sans retourner la tête ; puis, quand il jugeait le moment venu, il exécutait une brusque volte-face, et fondait sur les plus rapprochés.
Alors – comme la badine de l’élégant avait fait place à une terrible canne de quatre pieds de long armée à l’extrémité inférieure d’un clou en fer forgé capable d’étriper un bœuf – malheur aux imprudents qui s’étaient avancés trop loin !
Plus d’un eut à s’en repentir.
On cite même un nommé Vaillancourt qui en fut quitte pour un œil crevé ; et – disons-le au crédit de l’humanité québecquoise – personne ne perdit grand temps à le plaindre.
Grelot – nous pouvons bien le désigner par le seul nom sous lequel il fut connu – possédait un vocabulaire d’interjections absolument renversant.
Il avait à son service une série de blasphèmes à faire dresser les cheveux.
Ses imprécations étaient homériques.
On aurait dit qu’il s’en faisait des provisions avant de sortir de chez lui.
Tout le répertoire injurieux de la zoologie et de la démonologie, tous les monstres de la création et tous les diables de l’enfer étaient mis à contribution.
Il dévidait cela comme un chapelet, à flot, à torrent, d’une voix de stentor, sans prendre haleine, jusqu’à épuisement de poumons et déchirement de larynx...
IV
Des années passèrent ainsi.
Pas besoin de se demander si le pauvre diable vieillissait vite. À quarante ans, il avait la tête d’un octogénaire.
Ses accès de fureur s’étaient compliqués d’une étrange manie.
À force d’être persécuté de cette façon, il arriva un temps où l’on aurait dit que le misérable ne pouvait plus se passer de ses persécuteurs.
Il semblait les rechercher pour mettre leur méchanceté de fumistes au défi.
Il affectait de fréquenter les places publiques, ne manquait jamais de se montrer surtout les jours de marché.
Dès le matin, on l’apercevait arpentant le trottoir en face des halles, devant le portail des églises, l’œil au guet et l’arme au bras comme une sentinelle à sa guérite, la démarche provocatrice.
Les étrangers même, qui n’avaient jamais vu l’original, ne pouvaient s’empêcher de retourner la tête.
C’en était assez.
– T’as envie de le dire, toi, mon pendard ! s’écriait le fou en levant sa terrible canne. Oui, tu ris, t’as envie de le dire, je le sais !... Eh ben, dis-le donc, visage de réprouvé !... Toi aussi, mon Ponce-Pilate ! criait-il à quelqu’autre passant, attiré par le bruit ; toi aussi, t’as envie de le dire... Eh ben, dites-le donc, tas de crasses !... Contentez-vous, vermine d’enfer !...
Tout naturellement il était bien rare qu’il ne se rencontrât là quelque farceur prêt à lui donner satisfaction.
– Grelot ! criait-on.
Alors le chambardement commençait.
Parfois, deux ou trois citoyens paisibles – qui n’auraient pas voulu pour tout au monde soulever le moindre scandale – causaient tout tranquillement au coin d’une rue, sur un quai, sur le pont d’un bateau à vapeur.
Grelot survenait, s’approchait tout doucement, s’arrêtait devant eux, tournait alentour, les regardait de travers, en un mot se livrait à tout un manège pour attirer leur attention, et n’était satisfait que lorsqu’il avait réussi.
Alors un simple sourire était suffisant.
Il se campait devant le groupe, la canne en arrêt, les yeux injectés de sang :
– Vous avez envie de le dire, c’pas ?... Oui, vous avez envie de le dire ; vous êtes de la rogne comme les autres !...
Et la litanie commençait :
Paquets de cordes ! pouilleux ! rapace ! œufs de serpents ! piliers de coins flambants ! crapules du fanal rouge ! etc.
Il fallait se disperser, prendre la fuite, ou la fameuse canne vous tombait sur les épaules, et d’aplomb, je vous prie de le croire.
Grelot n’avait pas la main molle, et n’y allait jamais pour rire.
On racontait une aventure fort cocasse arrivée à l’un des citoyens les plus sérieux de la ville.
Oh ! sérieux, et peu enclin aux plaisanteries, je vous en donne ma parole.
Il était même un peu marguillier quelque part.
Un jour – vers trois heures de l’après-midi – cet excellent monsieur entre dans la bonne vieille basilique, qui s’appelait alors modestement l’église de la haute ville.
À peine a-t-il fermé la porte derrière lui, qu’il aperçoit, debout dans la tribune des suisses, au port d’arme, raide et dans une gravité de pontife... Grelot avec sa canne.
Que faisait-il là ? Dieu le sait.
En tout cas, le spectacle était si comique, que notre brave paroissien, malgré son respect pour la sainteté du lieu, ne put réprimer entièrement un involontaire sourire, en trempant son doigt dans le bénitier.
Il portait la main à son front, et murmurait : Au nom du Père ! lorsque, tout effrayé, il se retourne.
Une voix menaçante lui grinçait à l’oreille :
– T’as envie de le dire, toi, mon vice ! Si c’était pas dans l’église, vieille potence, tu le dirais ! Eh ben, tu vas le dire tout de suite, mon cierge bleu ! ou bien tu vas avoir affaire à moi...
C’était Grelot, qui avait surpris le sourire, et s’était approché en tapinois, l’air décidé à tout.
On s’imagine facilement que notre citadin ne fut pas long à prendre le large.
Mais Grelot n’était pas homme à tenir les gens quittes à si bon marché.
Et les voilà tous deux parcourant les allées presque au pas de course, passant d’un banc à l’autre, enjambant les obstacles, bousculant les chaises, exécutant le plus bizarre chassé-croisé qu’il soit possible de rêver, le brave marguillier plus mort que vif, la figure effarée, la canne meurtrière dans les reins, faisant des efforts inouïs pour dépister l’énergumène, qui ne cessait de grommeler entre ses dents :
– Dis-le donc, crime !... Dis-le donc, vieille teigne !... Dis-le donc, feignant de la haute ville ! poison de sacristie !...
La scène ne prit fin que lorsque le pauvre monsieur eut franchi la balustrade du choeur, et se fut réfugié derrière le maître-autel, blanc de peur, hors de lui et tout en nage.
V
Lors de mes débuts dans le journalisme, étant reporter au Journal de Québec, je reçus de l’éditeur une verte semonce au sujet du pauvre Grelot.
À chaque instant, celui-ci – rien de surpenant – était arrêté et traduit devant le recorder ou les magistrats de police, accusé de voies de faits, ou simplement prévenu d’avoir troublé la paix publique.
Moi qui n’y entendais pas malice – je me suis un peu amendé depuis – j’avais, un matin, rapporté une de ses frasques et son résultat judiciaire dans un entrefilet commençant par ces mots : Michel Langlois surnommé Grelot.
Une heure après la publication du Journal, les fenêtres de la boutique sautaient en éclats.
Un autre jour, c’était une dame, descendant de voiture en face d’un magasin de la rue de la Fabrique, qui s’évanouissait de peur devant la canne levée du terrible détraqué, qui avait cru la voir sourire.
Tous les jours on signalait quelque nouvel exploit du maniaque. Bref, Grelot était devenu une véritable plaie publique. Les autorités durent intervenir.
Le conseil de ville vota un règlement de police imposant une pénalité contre quiconque prononcerait le mot de Grelot dans le but de vexer le pauvre fou.
Eh bien, oui ! quelques vauriens furent condamnés à cinq chelins d’amende ; mais, comme cela ne faisait que rendre l’individu plus hardi et plus provocateur, les charivaris recommencèrent de plus belle, le désir d’éluder le règlement encourageant encore les tapageurs.
Voici comment ils l’éludaient, le règlement.
Les cochers avaient inventé celle-là.
Quand ils voyaient venir le pauvre homme, ils se rangeaient de chaque côté de la rue, et divisaient en deux le mot défendu
:
Sur un trottoir, on criait : – Gre !
Sur l’autre, on répondait : – Lot !
– Gre !
– Lot !
– Gre ! gre ! gre !
– Lot ! lot ! lot !
Et en avant le chahut ! pendant que, seul sur la chaussée, pris entre deux feux, le pauvre diable se débattait comme trente-six démons dans l’eau bénite, ne sachant où donner de la tête et de la canne.
D’autres s’étaient avisés de l’interpeller tout simplement par son nom de baptême : Michel.
– Michel ! Michel ! criaient-ils.
– Ah ! Michel !
– Oh ! Michel !...
Comme l’intention était évidemment identique, l’effet produit était le même.
Rassemblement, bagarre, tempête, émeute, la police, le poste ; et le lendemain, le tribunal et la geôle.
Le malheureux ne comptait plus ses semaines de prison, – ses mois même.
Il s’y résignait facilement, du reste ; c’étaient les seuls moments de paix et de tranquillité dont il pût jouir.
Qu’y faire, après tout ?
D’autres fois, en hiver, les farceurs prenaient tout simplement les grelots de leurs harnais, et les secouaient tous ensemble au bout du bras, dans un gling glang glong infernal et sans répit.
Comment les en empêcher ? Ces concerts de grelots me rappellent une scène du plus haut burlesque, et dont Sabatier, le fameux pianiste, auteur du Drapeau de Carillon, fut l’acteur principal et Grelot, comme toujours, la victime.
On sait qu’en hiver la promenade à la mode, à Québec, c’est la rue Saint-Jean.
À cette époque du moins, vers quatre heures de l’après-midi, l’étroit boyau regorgeait de joyeux piétons et de riches équipages.
C’était le rendez-vous de toute la jeunesse élégante.
Or, par une belle journée de février – il me semble voir encore la neige rutiler au soleil – Sabatier, un peu plus guilleret que d’habitude, en doublant l’encoignure de la cathédrale, se trouva tout à coup nez à nez avec Grelot, que suivaient une trentaine de gamins en rigolade.
Le musicien ne fait ni une ni deux ; il lui saute au cou, hèle un cocher de place, et roule le bonhomme comme un colis dans le traîneau, où il le retient d’une main, en criant :
– Vite, Montreuil, tes grelots ! Ce fut l’affaire d’un clin d’œil.
À peine le vieux avait-il eu le temps de cracher cinq ou six de ses plus beaux jurons, que la voiture dévalait à toute bride vers la rue Saint-Jean, Grelot à moitié étranglé par Sabatier, qui, le tenant à la cravate d’une main, de l’autre agitait en l’air un long chapelet de sonnettes criardes, tandis qu’une nuée de polissons, s’accrochant par derrière à toutes les arêtes du véhicule, mêlaient leurs cris de singes au tintamarre enragé des grelots.
Et fouette, cocher !
Ce fut un spectacle comme il ne s’en voit plus.
Sabatier était populaire ; Grelot aussi, dans son genre.
En les voyant passer tous les deux comme un ouragan, l’un se débattant sur le dos, bleu de rage, et l’autre debout, sonnant ses grelots à tour de bras, en s’esclaffant jusqu’aux oreilles, il était impossible de ne pas rire aux larmes.
La voiture parcourut trois fois la longueur de la rue Saint-Jean, du haut en bas et du bas en haut.
Ce fut le docteur Hubert La Rue qui mit fin à la scène : il craignait une attaque d’apoplexie.
VI
Un des incidents les plus sérieux de la vie de Grelot fut son voyage à Montréal.
À quelle époque eut-il lieu ? Les renseignements recueillis sur ce point sont contradictoires.
Ce dut être vers 1850.
Mais l’époque est de peu d’importance.
Qu’il suffise de dire que, ne pouvant plus sortir de chez lui sans ameuter la population, et dégoûté d’une pareille vie, Grelot eut une inspiration bien naturelle.
Un beau matin, il se dit que la situation n’était plus tenable, qu’il valait mieux fuir devant la tempête, et il se décida à émigrer.
Le temps seulement de mettre ordre à ses petites affaires, et, le samedi suivant, après avoir secoué la poussière de ses sandales, et sans doute murmuré, sur un ton un peu moins poétique probablement, le fameux « Ingrate patrie, tu n’auras pas mes os ! » il se dissimulait, arme et bagages, dans un recoin de l’entrepont du John-Munn, qui était alors le roi du Saint-Laurent.
Le lendemain matin, notre homme mettait le pied sur le débarcadère de Montréal.
Quelle différence ! quel changement !
Il n’en revenait pas.
Tout ravi de pouvoir circuler dans la foule sans être en butte aux attaques malveillantes, il logea ses effets chez un hôtelier de la rue Saint-Paul, déjeuna avec un appétit qu’il n’avait pas ressenti depuis vingt ans, risqua un bout de toilette – ce qui ne lui était pas arrivé depuis nombre d’années non plus – et, comme c’était un dimanche, il se fit indiquer l’église de Notre-Dame, et partit pour la messe.
Le pauvre homme se pâmait dans une jubilation extatique.
Il avait donc trouvé ce après quoi il soupirait depuis si longtemps : la paix !
La paix, avec le droit de vivre au soleil comme tout le monde, sans entendre le mot méchant, la sanglante ironie, le maudit sobriquet, retentir à ses oreilles !
Une nouvelle existence lui souriait.
Il trouvait les rues belles, la vie bonne.
Il lui prenait des envies de sauter au cou des passants.
Il aurait voulu remercier les petits enfants de ce qu’ils ne l’assaillaient pas de leurs huées.
Il pardonnait tout le passé, en considération de la joie sereine et douce du présent.
Hélas ! cette joie n’était qu’une trouée lumineuse dans l’existence du paria.
Elle devait s’effacer vite, et le joug allait retomber plus lourds et plus accablant que jamais sur les épaules du misérable.
Il avait assisté et prié à l’office : une atroce déconvenue l’attendait à la sortie de la messe.
Ce fut l’exubérance même de sa joie qui le perdit.
Je l’ai dit plus haut, ses cheveux, qu’il portait longs, avaient blanchi avant l’âge.
La vie qu’il menait depuis si longtemps lui avait donné un regard rébarbatif et louche, un œil chassieux et rougi, une démarche inquiète.
Il se retournait à chaque instant, comme mû par un ressort à brusque détente.
Tout cela lui composait une allure hétéroclite que les étrangers ne pouvaient s’empêcher de remarquer.
Mais ce qui devait le compromettre plus que tout le reste, c’était son air de satisfaction débordante.
Il s’attarda sur le parvis, le parcourant de long en large, allant de groupe en groupe, la mine éveillée, saluant respectueusement à droite et à gauche avec une expression d’épanouissement béat, qui faisait le plus singulier effet sur cette physionomie depuis si longtemps désaccoutumée à sourire.
Par moment, il se rengorgeait dans une attitude qui semblait dire :
– Eh bien, vous autres là-bas, vous pouvez me lorgner à votre aise ; je vous défie bien de le dire!
Et, à la pensée de son cauchemar habituel, un éclair passait dans ses sourcils en broussailles, et une imprécation énergiquement mâchonnée venait expirer sur sa lèvre, dans une grimace moitié colère, moitié réjouie. On l’observait du coin de l’œil.
La curiosité s’éveilla.
– Quel est ce type ? se demandait-on.
– Sais pas.
– Drôle de pistolet !
– D’où sort-il ?
– Ce doit être un étranger.
– Un original tout de même.
On se mit à l’examiner de plus près ; et – tout en chuchotant – petit à petit, le cercle des curieux se resserra autour de lui.
Si bien que le pauvre Grelot, qui commençait à craindre pour son incognito, songea qu’il était temps de s’éclipser.
Les rangs s’ouvrirent devant lui ; mais il était trop tard.
Un jeune commis voyageur, qui avait sans doute été témoin de quelqu’une de ses équipées dans la capitale, venait de le reconnaître. – Tiens, tiens, tiens, fit-il à demi-voix, c’est Grelot ! – Qui ça, Grelot !
En entendant le mot fatal, Grelot bondit comme un jaguar piqué par une tarentule.
– Satan ! cria-t-il, la canne levée ; scélérat ! Tu dois venir de Québec, toi, vipère maudite !
Le reste se perdit dans un immense éclat de rire. – Grelot ! Grelot ! cria-t-on.
– Embrouille ! embrouille !
– T’as qu’à voir !
– Veux-tu bien te taire !
– Tu dis ça pour rire !
– Répète donc !
– Grelot ! Grelot ! Grelot !
Une tempête, quoi.
La scène était nouvelle ; le succès devait être énorme.
Les vitrines de la rue Notre-Dame – rue bien étroite alors – ainsi que les fenêtres de la place Jacques-Cartier tintèrent longtemps aux exclamations bruyantes de la procession d’un nouveau genre qui reconduisit, jusqu’à son hôtel, le pauvre Grelot, vociférant comme un damné, et marchant à reculons, pour faire face, avec son arme, à la turbulente et impitoyable cohue.
Le lendemain soir, quand la cloche du John-Munn – à cette époque les cornets à vapeur étaient encore inconnus – sonna le départ pour Québec, dans un recoin de l’entrepont, qui semblait lui être familier, assis sur une vieille malle couverte en peau de loup-marin pelée et garnie de clous jaunes, un pauvre voyageur à cheveux blancs pleurait, abîmé dans le deuil de sa dernière illusion.
– Ils sont encore pires qu’à Québec, murmura-t-il en sanglotant.
VII
Pauvre homme !
Il est parti depuis pour un monde qu’il n’a certainement pas eu de peine à trouver meilleur que le nôtre !
Tant mieux !
Les heureux d’ici-bas ne songent pas assez aux lies amères qui s’amassent et bouillent dans les bas-fonds de ces existences que l’impitoyable raillerie des hommes et des choses a reléguées en dehors de la sphère commune.
Quel boulet formidable attaché aux pieds de ces pauvres êtres, sur cette route déjà si rugueuse parfois !
Quel cabanon que la vie ainsi emmuraillée dans l’hostilité et l’attitude agressive de tout ce qui vous entoure !
Quel sentiment de délivrance, quand, l’heure suprême approchant, le malheureux pâtira voit enfin l’ironie mordante se figer pour la première fois sur les lèvres d’autrui, et la main de celui qui pardonne à ceux qui ont pardonné descendre, bénissante et douce, sur les affres de son agonie !
Ce fut moins d’un an avant sa mort que je vis pour la dernière fois cette victime légendaire de l’irresponsabilité méchante des foules.
Je clorai mon récit par cette anecdote.
En 1861, je faisais mon droit – j’étais « en cléricature », comme on dit ici – dans l’étude de Me François Lemieux, ancien ministre, et oncle du criminaliste célèbre qui lui a succédé pour quelques années au parlement provincial comme représentant de sa ville natale, qui est aussi la mienne.
L’étude du savant avocat était située au premier étage de ce pâté de maisons groupé entre le palais cardinalice et l’hôtel des Postes, juste à cette encoignure irrégulière qui domine l’escalier de la rue Buade, et fait face aux remparts de l’Est.
Des fenêtres du sud, on découvrait une partie de la côte de la Montagne, à traves les arcades de l’ancienne barrière Prescott, aujourd’hui disparue.
Un jour d’été, que les croisées étaient ouvertes, un bruit de voix – criailleries et jurements bien connus – retentit tout à coup dans cette direction.
C’était Grelot qui gravissait la montée, suivi d’une cinquantaine de petits Irlandais et de petites Irlandaises, qu’il avait sans doute recueillis le long de la rue Champlain, – très reconnaissables à l’accent avec lequel ils criaient :
– Guerlow !
Le tumulte grandissait ; mes camarades étudiants et moi, nous nous mîmes aux fenêtres.
À ce moment, le vieillard montait l’escalier, se retournant presque à chaque marche pour montrer le poing aux polissons acharnés à ses trousses, se garer d’un projectile, ou pousser une botte dans le vide, avec un accompagnement d’invectives à donner la chair de poule.
– Gredins ! criait-il ; canailles ! scorpions ! race de pendus ! couvée de démons !...
– Guerlow ! Guerlow ! Guerlow !... répondait-on en choeur.
Notre patron – une brebis du bon Dieu, s’il en fût jamais – s’approcha aussi de la fenêtre, mais pour s’indigner.
– Peut-on tolérer pareilles cruautés, disait-il. Ils feront mourir ce pauvre insensé ; c’est révoltant, parole d’honneur !
Au même instant, le vieux, qui était parvenu au haut de l’escalier, se tournait vers lui, et s’écriait à bout d’haleine et avec un geste à peindre :
– Quand donc que le bon Dieu fera une fricassée pour empoisonner les chiens avec la carcasse de ces animaux-là ?
– Voyons, voyons, fit Me Lemieux avec un accent de pitoyable commisération, voyons, mon cher monsieur Grelot, laissez donc...
– Ah ! toi aussi, vieux flambard ! éjacula le vagabond au paroxysme de la fureur, et se précipitant vers la porte d’entrée, sa terrible carvelle en avant.
Je n’eux que le temps d’accourir et de pousser le verrou.
Une grêle de coups formidables ébranla la porte, pendant qu’un flot d’invectives sans nom arrivait jusqu’à nous dans des hoquets saccadés et râlants comme les dégorgements d’une gargouille.
– Gale ! hurlait-il la gorge éraillée ; chancre ! gangrène !... Huissier de sabbat !... Bedeau de messe noire !
La kyrielle n’avait pas de bout.
Notre patron était au désespoir.
– Sapristi ! sapristi ! s’écriait-il en se frappant le front, je n’ai pas plus de tête que les autres ; c’est contagieux !
Le lendemain – par parenthèse – il envoyait un chèque de vingt-cinq dollars au malheureux qu’il avait offensé sans le vouloir.
Quant à Grelot, après avoir épuisé sa colère impuissante contre la porte, qui par chance était solide, il reprit haleine un instant, s’appuya de nouveau sur sa canne, et s’achemina clopin-clopant sur la rue Buade.
Au premier coin – malheur ! – la bande, ayant passé par l’évêché, était là qui le guettait.
– Grelot ! criait-on.
Il revint sur ses pas, redescendit l’escalier, et prit à son tour le côté de l’évêché.
J’étais allé me mettre à la fenêtre du nord, et je le regardais aller, – sans mauvaise intention, je vous le jure : c’était trop pénible.
Le pauvre naufragé de la vie faisait peine à voir.
Il traînait ses loques en geignant comme un animal égorgé, s’accrochant aux murailles, trébuchant sur les pavés inégaux, nu-tête, ses longues mèches toutes blanches collées sur sa figure noire de sueur et de poussière.
Au rez-de-chaussée, il y avait un petit compartiment éclairé par une espèce de hublot grand comme les deux mains.
Au moment où le misérable passait devant l’ouverture, une voix formidable et sans pitié y lança un Grelot ! féroce qui cloua le vieux sur place.
La mesure était comble.
Le martyr, flageolant sur ses jambes, laissa tomber son gourdin, étendit les bras, leva les yeux au ciel et s’écria sur un ton de tristesse inénarrable :
– Il y en a jusque dans les murs !
Puis, après un moment d’affaissement tragique, il reprit sa route en soupirant
:
– Mon Dieu ! mon Dieu ! mon Dieu !... |
|
 |
|
|
 |
|
|
|
 |
 |
 |
 | Autres documents associés au dossier Inaptitude |
 |  |
|
 |
|
|
|
| | L'autiste show de Blainville |
| | L'autiste show | | | Difficile de passer sous silence cette joyeuse initiative: les Autiste Show, qui ont lieu dans diverses régions du Québec, entre autres, Ville Lorraine et Repentigny, au printemps. Nous présentons celui qui a eu lieu le 22 mai 2010 au manège du Parc équestre de Blainville, à l'initiative de la ,
|  | | | Régime enregristré d'épargne invalidité |
| | Assouplissement de l'admissibilité au REEI | | | Pour être admis au REEI, il faut déjà être admis au régime de crédit d'impôt, ce qui suppose qu'on ait de l'argent dans un compte en banque. Jusqu'à ce jour, il n'était pas possible d'en appeler de cette règle. La procédure ayant récemment été simplifiée, les plus pauvres auront plus facilement droit au REEI. |  | | | Ce 3 décembre 2010, Journée Internationale des personnes handicapées |
| | Vivre, peindre et écrire avec le syndrome de Down | | | La video est en anglais, mais comme d'une part le son n'y est pas très clair et comme d'autre part le langage de la personne en cause est la peinture, vous ne perdrez rien si vous vous limitez à regarder attentivement les visages et les tableaux. Elisabeth Etmanski, née il y a trente-deux ans avec le syndrome de Down, mène une vie autonome depuis longtemps. Ne soyez pas étonnés, si jamais vous la rencontrez, qu'elle vous salue en écrivant ou en disant un poème à votre sujet. Votre sensibilité est peut-être reléguée à l'arrière plan de votre être, la sienne imprègne tout sa personne y compris la surface. Vous comprendrez à son contact comment le réenchantement du monde peut s'opérer. Quelles sont ses aspirations en tant que peintre? On lui pose la question à la fin de la video. Sa réponse est à l'image de sa personne, naïve: «Je veux être la prochaine Emily Carr.» |  |
|
 |
|
|
 |
 |
 |
|
 |  |
|