 |
|
 |
|
|
 | | Revue Le partenaire |  | | Créée en 1992, la revue le partenaire est devenue au Québec une voix importante pour les personnes utilisatrices de services en santé mentale et pour tous les acteurs concernés par la réadaptation psychosociale, le rétablissement et la problématique de la santé mentale. Ses éditoriaux, ses articles, ses dossiers proposent une information à la fine pointe des connaissances dans le champ de la réadaptation psychosociale. Ils contribuent à enrichir la pratique dans ce domaine et à stimuler le débat entre ses membres. | |
| Destination El Paradiso | 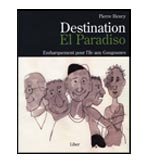 | | El Paradiso n’est pas une maison de retraite comme les autres. Située dans une île enchanteresse qui est réservée à son usage, elle accueille des pensionnaires bien particuliers. Ce sont, par un aspect ou l’autre de leur vie, par ailleurs tout à fait honorable, des originaux, des excentriques, habités par une douce folie, qui n’a sans doute d’égal que la simplicité de leur bonheur. C’est une galerie de personnages un peu fantasques que nous fait rencontrer cet ouvrage tout empreint de tendresse, d’humour et d’humanité. Voici donc les premiers douze membres de ce club très spécial:
Perry Bedbrook, Guy Joussemet, Édouard Lachapelle, Andrée Laliberté,
Céline Lamontagne, Guy Mercier, Avrum Morrow, Lorraine Palardy,
Antoine Poirier, Michel Pouliot, Charles Renaud, Peter Rochester.
| |
| Le Guérisseur blessé |  | | Le Guérisseur blessé de Jean Monbourquette est paru au moment où l’humanité entière, devant la catastrophe d’Haïti, s’est sentie blessée et a désiré contribuer de toutes sortes de façons à guérir les victimes de ce grand malheur. Bénéfique coïncidence, occasion pour l’ensemble des soignants du corps et de l’âme de s’alimenter à une source remarquable.
Dans ce livre qui fut précédé de plusieurs autres traitant des domaines de la psychologie et du développement personnel , l’auteur pose une question essentielle à tous ceux qui veulent soigner et guérir : « Que se cache-t-il derrière cette motivation intime à vouloir prendre soin d’autrui? Se pourrait-il que la majorité de ceux et celles qui sont naturellement attirés par la formation de soignants espèrent d’abord y trouver des solutions à leurs propres problèmes et guérir leurs propres blessures? » Une question qui ne s’adresse évidemment pas à ceux qui doivent pratiquer une médecine de guerre dans des situations d’urgence! | |
| Mémoire et cerveau |  | | Dans ce numéro de La Recherche, on se limite à étudier la mémoire dans la direction indiquée par le psychologue torontois Endel Tulving, reconnu en en ce moment comme l'un des grands maîtres dans ce domaine. Cela confère au numéro un très haut degré de cohérence qui en facilite la lecture. Culving est à l'origine de la distinction désormais universellement admise entre la « mémoire épisodique » portant sur des événements vécus et la « mémoire sémantique » portant sur des concepts, des connaissances abstraites. C'est la première mémoire que je mets en œuvre quand je m'efforce d'associer des mots à un événement passé, un voyage par exemple; je m'en remets à la seconde quand je m'efforce d'associer des mots automatiquement les uns aux autres, abstraction faite de tout événement vécu auquel ces mots pourraient se rapporter. Au cours de la décennie 1960, Tulving a constaté que les résultats obtenus grâce au premier exercice étaient beaucoup moins bons que ceux obtenus par le second exercice, ce qui l'a incité à faire l'hypothèse qu'il existe deux mémoires distinctes. | |
| Spécial Mémoire |  | | Dans ce numéro de La Recherche, on se limite à étudier la mémoire dans la direction indiquée par le psychologue torontois Endel Tulving, reconnu en en ce moment comme l'un des grands maîtres dans ce domaine. Cela confère au numéro un très haut degré de cohérence qui en facilite la lecture. Culving est à l'origine de la distinction désormais universellement admise entre la « mémoire épisodique » portant sur des événements vécus et la « mémoire sémantique » portant sur des concepts, des connaissances abstraites. C'est la première mémoire que je mets en œuvre quand je m'efforce d'associer des mots à un événement passé, un voyage par exemple; je m'en remets à la seconde quand je m'efforce d'associer des mots automatiquement les uns aux autres, abstraction faite de tout événement vécu auquel ces mots pourraient se rapporter. Au cours de la décennie 1960, Tulving a constaté que les résultats obtenus grâce au premier exercice étaient beaucoup moins bons que ceux obtenus par le second exercice, ce qui l'a incité à faire l'hypothèse qu'il existe deux mémoires distinctes.
| |
| L'itinérance au Québec |  | | La personne en situation d’itinérance est celle :
[…] qui n’a pas d’adresse fixe, de logement stable, sécuritaire et salubre, à très faible revenu, avec une accessibilité discriminatoire à son égard de la part des services, avec des problèmes de santé physique, de santé mentale, de toxicomanie, de violence familiale ou de désorganisation sociale et
dépourvue de groupe d’appartenance stable.
Cette définition met en évidence la complexité du phénomène et l’importance de l’aspect multifactoriel des éléments déclencheurs tels que la précarité résidentielle et financière, les ruptures sociales, l’accumulation de problèmes divers (santé mentale, santé physique, toxicomanie, etc.). L’itinérance n’est pas un phénomène dont les éléments forment un ensemble rigide et homogène et elle ne se limite pas exclusivement au passage à la rue.L’itinérance est un phénomène dynamique dont les processus d’exclusion, de marginalisation et de désaffiliation
en constituent le coeur. | |
| L’habitation comme vecteur de lien social |  | | Evelyne Baillergeau et Paul Morin (2008). L’habitation comme vecteur de lien social, Québec, Collection
Problèmes sociaux et intervention, PUQ, 301 p.
Quel est le rôle de l’habitation dans la constitution d’un vivre ensemble entre les habitants d’un immeuble, d’un ensemble d’habitations ou même d’un quartier ? Quelles sont les répercussions des conditions de logement sur l’organisation de la vie quotidienne des individus et des familles et sur leurs modes d’inscription dans la société ? En s’intéressant à certaines populations socialement disqualifi ées, soit les personnes ayant des problèmes de santé mentale et les résidents en habitation à loyer modique, les auteurs étudient le logement non seulement comme l’un des déterminants de la santé et du bien-être, mais également comme un lieu d’intervention majeur dans le domaine des services sociaux. De la désinstitutionnalisation à l’intégration, des maisons de chambres aux HLM, ils décrivent et analysent des expériences ayant pour objectif le développement
individuel et collectif des habitants et les comparent ensuite à d’autres réalisées au Canada, aux Pays-Bas et en Italie.
Pour en savoir plus : http://www.puq.ca | |
| Revue Développement social |  | | On a longtemps sous-estimé l'importance du lien entre les problèmes environnementaux et la vie sociale. Nous savons tous pourtant que lorsque le ciel est assombri par le smog, on hésite à sortir de chez soi pour causer avec un voisin. Pour tous les collaborateurs de ce numéro consacré au développement durable, le côté vert du social et le côté social du vert vont de soi. La vue d'ensemble du Québec qui s'en dégage est enthousiasmante. Les Québécois semblent avoir compris qu'on peut redonner vie à la société en assainissant l'environnement et que les défits à relever pour assurer le développement durable sont des occasions à saisir pour resserrer le tissu social.
| | La réforme des tutelles: ombres et lumières. |  | | En marge de la nouvelle loi française sur la protection des majeurs, qui doit entrer en vigueur en janvier 2009.
La France comptera un million de personnes " protégées " en 2010. Le dispositif actuel de protection juridique n'est plus adapté. Ce " livre blanc " est un plaidoyer pour une mise en œuvre urgente de sa réforme. Les enjeux sont clairs lutter contre les abus, placer la protection de la personne, non plus seulement son patrimoine, au cœur des préoccupations, associer les familles en les informant mieux, protéger tout en respectant la dignité et la liberté individuelle. Le but est pluriel. Tout d'abord, rendre compte des difficultés, des souffrances côtoyées, assumer les ombres, et faire la lumière sur la pratique judiciaire, familiale et sociale ; Ensuite, expliquer le régime juridique de la protection des majeurs, et décrire le fonctionnement, les bienfaits, et les insuffisances ; Enfin, poser les jalons d'une réforme annoncée comme inéluctable et imminente mais systématiquement renvoyée à plus tard.
Les auteurs: Michel Bauer, directeur général de l'Udaf du Finistère, l'une des plus grandes associations tutélaires de France, anime des groupes de réflexion sur le sujet et œuvre avec le laboratoire spécialisé de la faculté de droit de Brest. II est l'auteur d'ouvrages sur les tutelles et les curatelles. Thierry Fossier est président de chambre à la cour d'appel de Douai et professeur à l'Université d'Auvergne, où il codirige un master et l'IEJ. II est fondateur de l'Association nationale des juges d'instance, qui regroupe la grande majorité des juges des tutelles. II est l'auteur de nombreuses publications en droit de la famille et en droit des tutelles. Laurence Pécaut-Rivolier, docteur en droit, est magistrate à la Cour de cassation. Juge des tutelles pendant seize ans elle préside l'Association nationale des juges d'instance depuis plusieurs années. | |
| Puzzle, Journal d'une Alzheimer |  | | Ce livre, paru aux Éditions Josette de Lyon en 2004, a fait l'objet d'une émission d'une heure à Radio-France le 21 février 2008. Il est cité dans le préambule du rapport de la COMMISSION NATIONALE CHARGÉE DE L’ÉLABORATION DE PROPOSITIONS POUR UN PLAN NATIONAL CONCERNANT
LA MALADIE D’ALZHEIMER ET LES MALADIES APPARENTÉES. Ce rapport fut remis au Président de la République française le 8 novembre 2007.
«Je crois savoir où partent mes pensées perdues : elles s’évadent dans mon coeur…. Au fur et à mesure que mon cerveau se vide, mon coeur doit se remplir car j’éprouve des sensations et des sentiments extrêmement forts… Je voudrais pouvoir vivre le présent sans être un fardeau pour les autres et que l’on continue à me traiter avec amour et respect, comme toute personne humaine qui a des émotions et des pensées,même lorsque je semble «ailleurs »1à.
| | Les inattendus (Stock) |  | | Premier roman d'Eva Kristina Mindszenti, jeune artiste peintre née d’un père hongrois et d’une mère norvégienne, qui vit à Toulouse. Le cadre de l'oeuvre: un hôpital pour enfants, en Hongrie. «Là gisent les "inattendus", des enfants monstrueux, frappés de maladies neurologiques et de malformations héritées de Tchernobyl, que leurs parents ont abandonné. Ils gémissent, bavent, sourient, râlent, mordent parfois. Il y a des visages "toujours en souffrance" comme celui de Ferenc évoquant "le Christ à la descente de la croix". Tout est figé, tout semble mort. Pourtant, la vie palpite et la beauté s’est cachée aussi au tréfonds de ces corps suppliciés. » (Christian Authier, Eva Kristina Mindszenti : une voix inattendue, «L'Opinion indépendante», n° 2754, 12 janvier 2007) | |
| En toute sécurité |  | | Cet ouvrage est l'adaptation québécoise de Safe and secure, publié par les fondateurs du réseau PLAN (Planned Lifetime Advocacy Network) et diffusé au Québec par un groupe affilié à PLAN, Réseaux pour l'avenir. Il s'agit d'un guide pratique dont le but est d'aider à les familles à planifier l'avenir "en toute sécurité" des membres de leur famille aux prises avec un handicap. | |
| "Il faut rester dans la parade ! " - Comment vieillir sans devenir vieux |  | | Auteur : Catherine Bergman. Éditeur : Flammarion Québec, 2005. "Dominique Michel, Jacques Languirand, Jean Béliveau, Antonine Maillet, Jean Coutu, Gilles Vigneault, Hubert Reeves, ils sont une trentaine de personnalités qui, ayant dépassé l’âge de la retraite, sont restés actives et passionnées. Ils n’ont pas la prétention de donner des conseils ni de s’ériger en modèles, mais leur parcours exceptionnel donne à leur parole une valeur inestimable. Journaliste d’expérience, Catherine Bergman les interroge sur le plaisir qu’ils trouvent dans ce qu’ils font, leur militantisme et leur vision de la société ; sur leur corps, ses douleurs et la façon dont ils en prennent soin ; sur leur rapport aux autres générations, ce qu’ils ont encore à apprendre et l’héritage qu’ils souhaitent transmettre ; sur leur perception du temps et leur peur de la mort. Son livre est un petit bijou, une réflexion inspirante sur la vieillesse et l’art d’être vivant." (présentation de l'éditeur). | |
| Le temps des rites. Handicaps et handicapés |  | | Auteur : Jean-François Gomez.
Édition : Presses de l'Université Laval, 2005, 192 p.
"Il est temps aujourd’hui de modifier profondément notre regard sur les personnes handicapées et sur les « exclus » de toute catégorie, qu’ils soient ou non dans les institutions. Pour l’auteur du Temps des rites, l’occultation du symbolique, ou son déplacement en une société de « signes » qui perd peu à peu toutes formes de socialités repérable et transmissible produit des dégâts incalculables, que les travailleurs sociaux, plus que quiconque doivent intégrer dans leur réflexion.
Il faudrait s’intéresser aux rituels et aux « rites de passage » qui accompagnaient jusque là les parcours de toute vie humaine, débusquer l’existence d’une culture qui s’exprime et s’insinue dans toutes les étapes de vie. On découvrira avec étonnement que ces modèles anciens qui ont de plus en plus de la peine à se frayer une voie dans les méandres d’une société technicienne sont d’une terrible efficacité." | |
| Dépendances et protection (2006) |  | | Textes des conférences du colloque tenu le 27 janvier 2006 à l'Île Charron. Formation permanente du Barreau du Québec. Volume 238. 2006 | |  |
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
|
|
| L'euthanasie en France au début du XXe siècle : quelques réflexions d'époque |
 |
| Jean de Gourmont, Émile Forgue, Henri Bouquet |
  |
 |
 |
 |
| Texte |
Un cas d'euthanasie volontaire en 1924. Par Jean de Gourmont
Ainsi qu'on peut le voir à la lecture de cet article, les débats autour de l'euthanasie et du suicide assisté ne datent pas d'hier. Le texte est écrit sous le nom de R. de Bury, qui est un pseudonyme utilisé à cette époque par Jean de Gourmont. "R. de Bury est un des pseudonymes de Remy de Gourmont (et , après sa mort, de Jean de Gourmont)" (site des Amateurs de Remy de Gourmont).
"M. Louis Forest, qui est un homme d'un jugement sûr, épilogue dans Le Matin sur le cas de Mme Stanislowa Uminska qui, ne pouvant adoucir les souffrances de son mari Jean Ziznowski (1), qui se mourait d'un cancer, prit un revolver «et, d'un coup, avançant le destin de quelques jours, supprima le mal par la mort ».
Les commentaires sont naturellement ardents autour de cette tragédie, écrit-il. Ils ne sont pas nouveaux. Il y a quelque temps déjà, le docteur Binet-Sanglé a écrit L'art de mourir. (2) Il y réclame le droit légal d'abréger les souffrances des mourants et une organisation spéciale qui laisserait toutes garanties contre les abus.
Ces idées sont anciennes. Le «suicide secondé» a été admis par certaines civilisations antiques. Aujourd'hui encore, lorsque le médecin se sent impuissant devant certaines agonies, il recourt à des calmants qui, dans les cas extrêmes, sont une des plus belles conquêtes de la science.
Si nos lois évoluaient aussi vite que le temps, peut-être y aurait-il un texte pour codifier ces cas de conscience difficiles. On peut en effet concevoir une société qui, comme dans l'affaire Uminska Stanislowa, éviterait à une femme d'avoir à tuer celui qu'elle aime... par amour !
Dans son agonie M. Zyznowski, littérateur polonais célèbre, répétait sans cesse à sa femme : «Tue-moi!» mais la loi interdit ce geste de délivrance, acceptant en cela le code religieux. Il entre dans cette interdiction cette vieille idée religieuse de la volonté divine et de l'âme immortelle qui, lourde de péchés, peut se racheter par une contrition parfaite de la dernière heure, de la dernière seconde. Ce qui est grave, ce n'est pas d'interrompre les souffrances d'un moribond, c'est d'empêcher la grâce d'agir sur celui qui va paraître devant son juge. Il n'y a pas très longtemps qu'il est permis au médecin accoucheur, en certains cas difficiles, de sacrifier l'enfant à la mère. Naguère la mère était toujours sacrifiée : question de baptême. Du jour où un chirurgien bien pensant inventa la seringue à baptiser les foetus, on put, sans trop d'inquiétude sur leur vie éternelle, leur écraser la tête entre les fers et sauver la mère. La liste des femmes ainsi sacrifiées à cette idée religieuse serait longue. Mais actuellement il ne se trouverait peut-être pas un seul médecin qui consentirait à assassiner une femme, pour assurer la vie éternelle à un être incertain.
Le geste de Mme Uminska est un geste de pitié et d'amour."
Notes
(1) Il faut plutôt lire : Jan Żyznowski. Écrivain et peintre polonais (1889-1924, Paris). Notice en polonais et représentation d'une de ses oeuvres sur le site WebArt. On peut en savoir plus en consultant l'ouvrage qui suit : Christophe Laforest et Andrzej Nieuważny (dir.). De tout temps amis. Cinq siècles de relations franco-polonaises, Nouveau Monde Éditions, 2004, 445 p. (présentation sur le site de l'éditeur; courte recension de Jean-Michel Smoluch sur le site des Clionautes, 16 juin 2005)
(2) Il s'agit du docteur Charles-Hippolyte-Louis-Jules Binet, dit Binet-Sanglé (1868-1941). La référence complète de l'ouvrage est : L'art de mourir. Défense et tecnique du suicide secondé, Paris, A. Michel, 1919, 154 p. Cet auteur, quoique "progressiste", prend hélas place dans l'histoire de l'eugénisme au début du XXe siècle : "Certains libertaires mêmes, et leurs compagnons de route, n’ont pas échappé aux séductions du projet eugénique, dont ils n’ont pas vu la contradiction avec les principes antiautoritaires. (...) le Dr Binet-Sanglé, réformiste sincère, proche du mouvement néo-malthusien, et très influencé par les théoriciens anarchistes, estimera que "l’infanticide des dégénérés, le meurtre des idiots et des mélancoliques incurables ainsi que le suicide secondé sont parfaitement rationnels" (1919). Et ailleurs, il propose "d’encourager le suicide des mauvais générateurs et, à cet effet, de créer un institut d’euthanasie, où les dégénérés fatigués de la vie seront anesthésiés à mort à l’aide de protoxyde d’azote ou 'gaz hilarant'"(1918)." (Claude Guillon, "Alexis Carrel, ce méconnu ? - Un ancien chargé de mission de Jack Lang publie un livre à la gloire du théoricien raciste", 30 juin 2004).
Source imprimée : Mercure de France, 1er septembre 1924, p. 504.
***
"L'euthanasie", par Émile Forgue
Ce qui fait, à la fois, la dignité de la médecine et le poids de sa responsabilité, c'est la grandeur tragique de certaines situations qui lui sont soumises, c'est la hauteur morale des problèmes qui lui sont parfois proposés et dont la solution exige plus de conscience encore que de science. En voici un, auquel un drame récent vient de donner une émouvante actualité : à l'hospice de Villejuif, une jeune femme, meurtrière par compassion, tue son mari atteint d'un cancer incurable, et le même bras, qui, quelques jours avant, s'offrait généreusement à la transfusion pour tenter de sauver le malade, abat, d'un coup de revolver, l'homme aimé cependant jusqu'au sacrifice, pour le délivrer de ses intolérables souffrances.
A-t-on le droit de tuer pour mettre fin à la douleur? Grave question, qui est à la fois un sujet de hautes spéculations philosophiques, un problème de droit humain, et de médecine légale, un thème de loi morale et de doctrine religieuse : donc question aux faces multiples et rentrant justement dans le cadre des pensées générales qui, à l'heure actuelle, peuvent être portées devant le grand public. C'est, dans de pareils problèmes, qu'apparaît bien cette « liaison nécessaire des sciences » dont parlait Diderot, cette féconde collaboration des intelligences par laquelle nous nous affranchissons de l'étroitesse des vues trop spécialisées, nous nous gardons des jugements influencés par l'esprit professionnel, et pouvons nous ouvrir, de toute part, un large jour sur l'ensemble des connaissances humaines propres à guider notre raison.
Le sujet est austère et il faut excuser sa sévérité : il est indiqué d'ailleurs d'atténuer ses duretés et ses tristesses. Mais, en vérité, notre époque a vu de si dramatiques événements, notre résistance nerveuse a été si solidement trempée par dix ans d'épreuves, que l'esprit public est maintenant capable d'envisager, sans émotivité et avec une calme résolution, un problème de si impressionnante gravité. Nous apprécions bien, à l'heure présente, la pensée de Montaigne, remerciant Dieu « qui ne l'a pas fait naître dans un siècle de mollesse et de sécurité ». Ah ! Certes la vie moderne nous a aussi bronzés, et.nous pouvons entendre, désormais, toutes les vérités ! Au surplus, il s'est développé, depuis la guerre, qui nous a donné l'habitude et le goût du risque, une inclination excessive vers les spectacles de forte émotion : le roman, le théâtre, le cinéma éprouvent, à dure tension, les nerfs de nos contemporains. Et c'est précisément pourquoi nous devons mettre au point cette question, lui conserver son aspect scientifique, impassible et précis, la purifier des paradoxes et des audacieuses fictions de certains écrivains d'avant-garde, de la fausse sentimentalité que la douleur égare, et aussi de l'inutile réalisme qui n'a point craint de porter à la scène cette formidable situation... Bacon, dans son projet d'euthanasie, voulait que tous les arts se missent de la partie pour rendre la mort acceptable. « L'homme, disait-il, est incapable de jouir sainement de la vie, s'il n'a pas d'idées sereines sur la mort. » Quelle profonde règle de conduite morale est formulée en ces quelques mots : « Nous devons vivre comme s'il nous fallait mourir demain et travailler comme si nous ne devions jamais mourir! »
Montaigne, qui honorait les médecins, mais n'aimait point la médecine, nous a donné, sous une forme de bonhomie résignée, un exemple d'attitude vis-à-vis de la mort, qui n'a rien d'héroïque, mais qui est d'un sage conseil : « Si c'estoit ennemy qui se peust éviter, dit-il, je conseillerais d'emprunter les armes de la couardise; puisqu'il ne se peut, puisqu'il vous attrape fuyant et poltron aussi bien qu'honneste homme, et que nulle trempe de cuirasse vous couvre, apprenons à le soutenir de pied ferme et à le combattre; et, pour commencer à luy oster son plus grand advantage contre nous, prenons voye toute contraire à la commune : ostons luy l'estrangeté, pratiquons-le, accoutumons-le...» − C'est là le secret pour ne la point craindre : - habituons notre esprit à la regarder telle qu'elle est en soi, selon le mot de Maeterlinck, c'est-à-dire dépouillée de son apparat funèbre et des terreurs de.l'imagination; «chassons d'abord tout ce qui la précède et n’est pas à elle; nous lui imputons ainsi les tortures de la dernière maladie, et ce n'est pas juste ». − Et, dans cette pensée pénétrante de Maeterlinck, se trouve probablement la donnée essentielle de ce problème : tant il entre de divination dans l'âme d'un poète !
Au fronton de cette étude, un autre principe directeur doit se placer : c'est le caractère sacré de la vie humaine, et l'indispensable limitation de nos droits sur elle. En vérité, sous l'influence de hardiesses littéraires visant à l'originalité par l'affranchissement de toutes règles, sous l'inspiration d'un humanitarisme dévoyé qui ne tolère plus la souffrance, grâce aussi à l'exaltation croissante de l'individualisme, à l'indulgence pour les crimes passionnels, au fléchissement de l'idée religieuse et de son pouvoir de résignation, à la suite enfin de l'épouvantable destruction humaine de la guerre mondiale qui a supprimé dix millions d'hommes, le prix de la vie a perdu de sa valeur absolue. Sans doute, il faut reconnaître qu'il y a des misères physiques qui dépassent la capacité de résistance humaine; mais, hormis ces circonstances atténuantes, il est nécessaire de rétablir, dans les lois et dans les moeurs, le respect de la vie, de réprimer ces périlleux orgueils qui font de l'homme l'arbitre d'une destinée, de mettre fin à cette complaisance envers ceux qui désertent le devoir de vivre, et de réserver notre sympathie aux âmes fortes qui luttent contre les grandes infortunes et les grandes douleurs.
Il faut s'entendre, d'abord, sur la définition de l'euthanasie. Le mot n'est pas nouveau : il a été créé au XVIIe siècle par Bacon, philosophe illustre et grand chancelier d'Angleterre, dans son remarquable ouvrage intitulé le Novum Organum. Selon Littré, ce terme signifie : bonne mort, mort douce et sans souffrances. Mais, il faut distinguer l'euthanasie naturelle, celle où le besoin de la mort, selon le mot de Dastre, apparaît, à la fin de la vie, comme le besoin du sommeil arrive à la fin du jour, et l'euthanasie artificielle, où cet apaisement des minutes suprêmes est demandé aux substances calmantes ou narcotiques. Il faut aussi considérer les conditions variables de cette euthanasie provoquée, soit que le malade lui-même la réalise, ou que le médecin en prenne l'initiative et l'exécution, ou qu'une tierce personne en soit la complice. − Mais, au total, l'euthanasie, c'est, pour celui qui souffre incurablement, le droit à l'exeat, l'issue adoucie et scientifiquement facilitée. Et, à l'autre pôle de la vie humaine, c'est le pendant de l'eugénésie, entendue dans le sens de la naissance anesthésique et indolore; car l'humanité veut maintenant soigner sa sortie comme son entrée et libérer l'une et l'autre de la douleur; Bacon, comparant ces deux étapes extrêmes de la vie, disait, dans une phrase profonde : « Il est aussi naturel de mourir que de naître, et l'homme naissant souffre peut-être plus que l'homme mourant. »
Si le mot n'est pas neuf, la chose, est plus vieille encore; et nous la retrouvons dès les premiers groupements humains : c'était la règle, chez les Germains, que de mettre à mort les malades chroniques; en Birmanie, un incurable devait se pendre; les Esquimaux, au dire d'Amundsen, pratiquent le suicide quand les douleurs deviennent intolérables; dans l'Inde, le malade inguérissable était conduit en famille au bord du Gange, son nez et sa bouche étaient remplis du limon sacré, puis il était jeté dans le fleuve. Mais, en général, cette euthanasie des peuples primitifs répondait à une idée économique et alimentaire; elle résultait de la rareté des vivres et de la suppression nécessaire des bouches inutiles : c'était une question d'estomac. L'euthanasie moderne est d'ordre sentimental : c'est une question de nerfs; et son indication dominante, c'est la suppression de la douleur. Toutefois, chez le Germain barbare, enterrant vif le vieillard incurable, et chez le civilisé dernier-cri, offrant à qui veut fuir la douloureuse agonie, comme dans le roman de Benson, l'appareil moderne-style, distributeur automatique de mort par la narcose, il y a une égale culpabilité, qui consiste à devancer le destin et à clore volontairement une vie humaine.
J'examinerai cette question complexe de l'euthanasie sous son quadruple aspect : devant la loi; devant la société moderne, c'est-à-dire dans les exemples contemporains de sa mise en pratique; devant l'opinion, ou plutôt devant les organes qui la traduisent, le journal, le roman, le théâtre; enfin, devant l'observation médicale et nos règles de morale professionnelle.
C'est près de nous, c'est à Marseille, que nous trouvons la première ébauche d'euthanasie légale. Valère Maxime raconte que, dans la vieille ville phocéenne, on garde, dans un dépôt public, une potion de ciguë, réservée à quiconque justifie, devant le Sénat marseillais, des motifs qui lui font désirer la mort; et le point curieux de cette histoire, qui n'est peut-être qu'une galéjade, c'est que non seulement cette autorisation officielle pouvait être accordée à ceux que trop de douleurs accablent, mais aux privilégiés que trop de bonheur favorise et qui mettent fin à leur vie dans la crainte que cette félicité ne les abandonne ! C'est là, l'euthanasie à la façon de Gribouille; cela rappelle le conseil, donné par un sage Lacédémonien à. Diagoras, le jour où ses trois fils furent couronnés aux Jeux olympiques : comme il voyait que tout le peuple applaudissait ce vieillard et lui jetait des fleurs, il l'aborda froidement et lui dit : Meurs, Diagoras, car tu es trop heureux; et, effectivement, Diagoras mourut de joie entre les bras de ses trois champions. Notre enthousiasme pour le sport n'irait pas jusque-là !
Puis ce sont les Anglais − et c'est peut-être le spleen et le brouillard qui en sont cause − qui ont eu l'idée de codifier cette mort volontaire des incurables. Il y a quatre siècles, en 1516, Thomas Morus publie à Louvain la première édition de son livre Utopia ; comme il écrit sous des tyrans cruels et absolus, il doit recourir à la fiction pour risquer ses périlleuses audaces de pensée. Il imagine donc une île inconnue, perdue dans l'espace, à laquelle on pouvait bien croire puisqu'on n'était qu'à vingt ans de la découverte de l'Amérique par Colomb; il la baptise, pour cette absence de situation géographique précise, Utopie ; et ce nom restera synonyme des fictions et des chimères. Pour cette République imaginaire et idéale, il bâtit toute une législation fictive, mettant au nombre de ses institutions les plus libres la règle qui défend de faire tort à personne pour sa religion : conception de large tolérance dans une époque cruellement intolérante ! Et, de cette cité de songe, Morus veut bannir la douleur évitable; voici comment il règle le cas des incurables :
Si la maladie est non seulement inguérissable, mais pleine de douleurs continuelles et angoissantes, les prêtres et les magistrats exhortent cet homme à ne pas chérir cette maladie pestilentielle et douloureuse, aussi pénible pour lui que pour les autres; ils lui conseillent de se dépêcher hors de cette vie (nous traduisons littéralement) comme hors d'une prison, ou bien de permettre aux autres de l'en délivrer... et, comme, dans cet acte, il suit les conseils des prêtres, c'est-à-dire des interprètes de la volonté des dieux, ils lui montrent qu'il agit en homme bon et vertueux; ils ne le poussent pas à mourir contre sa volonté; mais, si quelqu'un se tue, sans la permission des prêtres et du conseil; il est indigne d'être enterré ou incinéré et jeté dans un marais nauséabond.
Or, il advint que, dix-sept ans après la publication de l'Utopia, Thomas Morus devait donner lui-même l'exemple d'une mort idéalement belle par sa haute tenue et sa dignité calme : condamné au supplice par le caprice injuste d'Henry VIII, il franchit les degrés de l'échafaud, et à un ami qui le soutenait, il dit en souriant : «Aidez-moi à monter; car il n'y a pas d'apparence que vous m'aidiez à descendre. »
Vers la fin de ce grand XVIe siècle, qui a vu la fondation de l'anatomie, avec Vésale et Fallope et la création de la chirurgie avec Ambroise Paré, le chancelier François Bacon, ce puissant cerveau encyclopédique que les choses de la médecine ont fortement intéressé, accordait, dans le vaste tableau qu'il traçait de l'avancement du savoir, humain, un chapitre à ce même sujet : le Traitement des maladies réputées incurables; l'euthanasie.
J'estime, écrit-il, que c'est l'office du médecin, à la fois de restaurer la santé, et d'adoucir peines et douleurs, et non seulement lorsque cet apaisement peut ramener la santé, mais lorsqu'il peut conduire à une mort facile et belle. Car, ce n'est pas une mince félicité que cette euthanasie que César Auguste ne cessait de se souhaiter. Ainsi mourut Antonius Pius, dont la fin ressemble au sommeil d'un enfant; ainsi, Épicure qui, lorsque son état fut jugé désespéré, noya son estomac et ses sens dans une large ingurgitation de vin et sur qui cette épigramme fut faite : hinc stygias ebrius hausit aquas, il sut dans son ivresse ne pas goûter à l'amertume des eaux du Styx.
Il est à remarquer que les pays anglo-saxons sont à peu près les seuls où cette légalisation de la mort anticipée, après certificat d'incurabilité, ait eu l'honneur de l'examen par les législateurs.
Ce ne sont pas nos parlementaires du Palais Bourbon qui ont jamais été sollicités par cette législation funèbre; et ma foi ! il faut les en louer. Certes, il n'y a pas de pays où l'on se tienne plus crânement devant la mort que chez nous; nous savons accueillir, avec noblesse, la sombre visiteuse. Mais l'esprit latin, d'une saine gaieté, épris de lumière et d'action, aime la vie et la dispute jusqu'à la dernière minute. Il a fallu, en Italie, que ce soit un homme du Nord, Nobel, qui, dans une pensée de fausse philanthropie, ait essayé d'acclimater dans le pays au ciel bleu ces idées noires et de créer à Rome et à Milan des établissements d'euthanasie pour les désespérés de la vie; mais Crispi, le premier ministre, a souri de ce projet et l'a promptement enterré.
En Allemagne, où dominent l'esprit de dure consigne, la discipline collective, le goût de l'autorité, cette odieuse réglementation a trouvé des défenseurs. Il y a une vingtaine d'années un projet de loi était présenté au Parlement du royaume de Saxe, ayant pour but d'accorder aux médecins l'autorisation de donner aux incurables qui la demandaient une mort prompte et douce; mais ce projet a été repoussé. Puis, dix ans après, c'est le Reichstag qui est saisi d'une proposition accordant à tout incurable ce droit à l'euthanasie et soumettant cette décision à l'examen d'un tribunal du ressort, sur la demande du malade et après avis favorable de trois médécins légistes : voilà bien, par ma foi ! une lugubre procédure ! Plus près de nous, c'est un juriste émérite, Binding, qui reprend laborieusement, impitoyablement, ce problème dans un traité publié par le psychiatre Hoche, de Fribourg, sur « la licence de détruire les vies qui ne valent pas la peine d'être vécues»; die Freigabe der Vernichtung lebensunwertern Lebens; et il y a deux ans, le conseiller Borckhardt a présenté dans la gazette allemande du droit pénal une proposition de loi conférant le droit de faire disparaître les idiots incurables. Combien ces tristes projets sont éloignés de notre sensibilité française, de notre pitié secourable aux plus déshérités, de notre profond sens d'humanité !
L'Amérique est, en législation, la: terre des nouveautés, des solutions radicales, des audaces qui dépassent notre vieux Code, sagement conservateur, et notre goût de la mesure.
Il y a vingt ans, une grande association médicale, la NewYork Stade Medical Association, ne craignait point de mettre publiquement en question le droit de raccourcir l'existence d'un cancéreux dont la tumeur a récidivé ou d'un paralytique incurable par fracture de la colonne vertébrale; au banquet (en Amérique comme ailleurs un banquet accompagne tous les congrès) un clergyman avait même été convié; et au dessert il se fit l'apôtre de cette revendication. − En 1906, l'état de Iowa a été saisi d'un projet de loi, présenté par le docteur Gregory, proposant que toute personne atteinte d'une maladie ou d'une blessure désespérée pût être débarrassée de l'existence par l'administration d'un anesthésique; le docteur Gregory osait affirmer que cette pratique était déjà quotidiennement appliquée par les plus grands médecins et chirurgiens des hôpitaux des Etats-Unis ! Il faut lire le commentaire véhément du rédacteur du British Medical Journal qui enregistre ce projet : le docteur Gregory en prend pour son grade; «c'est ou un gaillard d'un type particulièrement naïf, ou bien un arriviste assoiffé de réclame « the man is, either a crank of a particularly noxious type or a mere notoriethy hunter »; s'il croit à la fable des médecins d'hôpitaux supprimant les incurables, c'est de plus un gobe-mouches « is more credulous than the simplest gobe-mouche ». La même année, un bill était soumis à la législature de l'Ohio et passait en première lecture : l'inspiratrice de cette loi était miss Anna Hall, de Cincinnati, personne de grande douceur, qui sollicitait l'autorisation de mettre par le chloroforme un terme aux souffrances de sa mère incurable.
Il ne faut rien exagérer d'ailleurs, ni dramatiser ce sujet plus qu'il ne convient. Il est à considérer que, d'abord, le suicide des incurables est déjà moins fréquent qu'on ne pense; combien de cancéreux voyons nous, pas à pas, achever leur long calvaire, sans avoir la tentation ou la force d'en supprimer les dernières étapes ! C'est que, peu à peu, l'adaptation au mal s'établit et, sous l'action déprimante des toxines, la volonté fléchit. Quelle psychologie pénétrante est celle de Montaigne, quand il décrit cette accoutumance à ces misères !
Qui y tomberait tout à un coup, dit-il, je ne crois pas que nous fussions capables de porter un tel changement; mais, conduits par la main de la mort, d'une douce pente et comme insensible, de degré en degré, elle nous roule dans ce misérable estat et nous y apprivoise.
Quant aux cas où, passant de la conviction à l'acte, une personne que l'affection égare, témoin des douleurs intolérables de l'être aimé, se détermine à y mettre fin par une mort violente, ils restent très rares. Ces quelques faits divers suffisent à alimenter une exubérante chronique : en 1912, i1 y a eu le cas de cette dame hémiplégique tuée par son mari, ancien procureur de la République, qui déclarait n'avoir fait que son devoir, en arrachant sa femme à des tortures prolongées depuis un an; en juillet dernier, s'est produit le fait sensationnel de madame Uminska, que son mari, crucifié par un cancer, suppliait de lui rendre ce dernier service ! Sans doute il ne faudrait pas que ces cas, qui sont l'exception, deviennent l'exemple; mais, à la base de l'acte meurtrier, il y a, ici, tant d'angoisses, de sensibilité exaltée par la vue prolongée des souffrances, tant de dévouement impuissant, allant parfois jusqu'au sacrifice, qu'il faut pardonner à ces esprits égarés, parce qu'ils ont beaucoup compati et que leur geste est encore une suprême preuve d'affection et de charité!
La presse, toujours à l'affût de l'actualité, s'empare de ces faits et y trouve matière à des chroniques à sensation, mais forcément superficielles; le roman moderne, qui emprunte volontiers le document scientifique, les exagère du côté sentimental ou les développe en fictions pures.
C'est encore dans des romans anglais que nous trouvons, sous sa forme la plus réaliste, l'euthanasie à l'oeuvre; mais ces fictions d'Outre-Manche n'ont jamais la fantaisie brillante et justement prophétique, l'invention captivante de Jules Verne; elles heurtent notre esprit par l'outrance du détail, la dureté minutieuse du développement. Wells, dans ses anticipations, imagine une société idéale où l'euthanasie, érigée en loi, serait permise à l'incurable dans des institutions spécialisées et munies de tous les perfectionnements de la science. Mais cette conception scientifique du suicide, trouve, pour le lecteur français, sa plus pénible expression dans le fameux. roman de Benson, le Maître de la Terre; dans cette humanité future, que nous ne verrons point, espérons-le, l'objectif dominant est l'abolition de la souffrance, ce qui est sûrement l'idéal; mais à quelle réglementation cruelle il aboutit ! Voici la catastrophe : un des grands aériens internationaux vient de tomber dans le square de la station de Brighton : les premiers secours arrivent « ... Bientôt, des marches du grand hôpital, des hommes descendirent, chacun tenant à la main un objet qui avait la forme des appareils photographiques d'autrefois; c'étaient les exécuteurs de l'euthanasie; l'appareil qu'ils portaient allait mettre fin aux souffrances des agonisants, les faire passer doucement, délicieusement, dans le royaume de l'éternel repos. » Et quand l'héroïne du livre, Mabel, dans sa détresse morale, se décidé à renoncer à la vie, quand, après avoir subi l'examen prescrit, devant un magistrat spécial, elle entre dans une de ces cliniques privées, consacrées à l'euthanasie, il y a là une quinzaine de pages, douloureuses, d'une précision scientifique atroce, dont un médecin même supporte mal la lecture : ainsi les instructions suprêmes de la soeur Jeanne concernant le maniement de l'inhalateur, et les phases progressives du sommeil mortel ! Chez nous, il n'y a que le docteur Binet-Sanglé qui ait osé écrire sur cet « art de mourir » et se soit flatté de faire passer le suicide de sa période empirique, parla pendaison, l'immersion, l'oxyde de carbone, «cet euthanasique du pauvre », comme il dit, à sa forme scientifique (où, dans la chambre d'anesthésie, au son d'une musique de son choix, le candidat au nirvana final, endormi par les gaz, passera sans douleurs dans l'au-delà !) Qu'on se rassure d'ailleurs sur le danger de ces fictions : il est plus rapide d'enjamber le parapet de la Seine, ou d'allumer un réchaud, ou d'ouvrir un robinet de gaz, que d'accomplir, dans tous ses rites, ce cérémonial de l'euthanasie futuriste; et le nombre des suicides ne pourrait que baisser devant un tel programme.
Le théâtre contemporain abonde en pièces médicales; et nous n'y jouons pas toujours un rôle sympathique. Deux pièces récentes, le Droit de mort de Gravier et Lebret, et l'Assassinat légal de Raymond Groc, malgré leur titre, ne se rapportent pas à notre sujet; mais, l'an dernier, M. René Berton, qui est instruit des choses médicales et a eu la bonté de nous communiquer sa pièce, à donné, au Grand Guignol, un acte, bien construit, exactement documenté, sur l'euthanasie ou le droit de tuer. L'action est dramatique, conduite avec maîtrise, décision et vraisemblance : le professeur agrégé Saint-Gery, un des grands médecins de Paris, est appelé, par son confrère le docteur Sergeac, auprès d'un malheureux employé des postes, atteint d'un cancer du foie arrivé à sa période ultime; la situation médicale désespérée se double d'une position matérielle misérable, l'employé est arrivé au terme de ses congés et va être rayé; sa femme s'épuise en veilles douloureuses; l'homme souffre horriblement et réclame la mort. Une scène intéressante, bien développée, est celle où s'opposent l'esprit indépendant du jeune agrégé parisien, partisan des solutions radicales, confiant dans son diagnostic, et la résistance conservatrice du vieux médecin, que l'expérience a instruit de la faillibilité médicale et qui reste fidèle au devoir traditionnel de prolonger l'existence par tous les moyens. Puis, seul devant le malade qui implore la fin, devant ce tableau des pires souffrances, devant ce crescendo de douleurs qui abolit ses scrupules, après un violent combat de conscience, brusquement résolu, notre collègue, au lieu de morphine, charge sa seringue de cyanure; quand le médecin traitant rentre et voit le cadavre, son premier mouvement est l'indignation, la menace d'une dénonciation; puis, agissent la réflexion, l'apaisement du grand silence, le terme voulu des plaintes et des douleurs; et, lorsque, la femme du malheureux se présente, au lieu de crier la vérité, il lui fait le suprême mensonge : « Votre mari est mort... tout d'un coup... d'une embolie au coeur... » Tout bas il dit à Saint-Gery : « Vous avez peut-être commis une bonne action »; et le professeur agrégé, simplement, répond : « J 'ai fait mon devoir.» C'est du théâtre, du bon théâtre, et qui doit impressionner; mais ce n'est ni notre doctrine, ni notre pratique!
A ceux qui, comme Maeterlinck, demandent «une pitié plus audacieuse»que le simple apaisement de l'agonie, et qui espèrent qu'un jour viendra où la science n'hésitera pas à « accourcir nos disgrâces », c'est-à-dire, en langage clair, qui demandent au médecin, pour l'incurable, le coup de grâce, nous opposons ces deux fortes objections : d'abord, la faillibilité de notre pronostic, et la possibilité de guérison dans des cas apparemment incurables; en second lieu, la cruauté de révéler au malade sa situation irrémédiable.
Les cas sont fréquents de ces « rescapés » qui ont fait appel du jugement capital de la Faculté, et, comme disait un vieux dicton médical, nombreux sont les gens qui se portent bien et que Boerhaave (célèbre par la sûreté de son diagnostic) avait condamnés. Owen, à propos de l'euthanasie, cite le cas d'un marin, atteint d'une énorme tumeur du bassin, qu'il renvoie chez lui, pour mourir de son cancer inopérable; quelques années plus tard, un. ancien étudiant, revoyant son maître, lui demanda s'il se souvenait de ce cas : « Fort bien, répondit Owen, et qu'est-ce que l'autopsie a révélé ? – Oh ! dit le visiteur, l'homme est guéri; ce gros cancer inopérable était un abcès autour d'un corps étranger. » − Même aventure m'est advenue : les chirurgiens de Buenos-Ayres m'adressent un acrobate célèbre, spécialiste du trapèze volant, atteint d'un volumineux ostéo-sarcome du bassin, confirmé par une radiographie du professeur Imbert, qui ne comporte d'autre salut que l'amputation inter-ilio-abdominale, c'est-à-dire la plus mutilante opération de la chirurgie qui, pratiquée une trentaine de fois, a presque constamment causé la mort sur table. Le malade est informé : nous n'entreprendrons l'intervention que s'il en accepte le risque : la famille est consultée, on recule devant ce péril, le malade sort de l'hôpital. Quelques mois après, je le retrouve : la tumeur paraît être stationnaire. Or, quel n'est pas mon étonnement, un an après, de le voir, au début de la guerre, venir subir un examen d'aptitude pour un engagement; je l'accepte; il fait toute la campagne, la termine brillamment comme lieutenant d'infanterie, et continue à se bien porter; en réalité, il s'agissait d'un énorme chondrome de l'os iliaque qui s'est immobilisé, contre toute prévision possible. Une femme est traitée par Owen pour un cancer de l'estomac : une laparotomie confirme le diagnostic; on se borné à une opération palliative et on la renvoie, avec un pronostic de mort à échéance de quelques semaines : l'année suivante, elle gagnait un tournoi de tennis !
Il n'y a pas, d'ailleurs, que les erreurs de diagnostic : ne faut-il pas compter avec les continuels progrès de la médecine, et surtout de la chirurgie, qui font de l'incurable d'aujourd'hui le guérissable de demain? Montaigne a écrit : « Pline disait qu'il n'y a que trois sortes de maladies pour lesquelles éviter on aye le droist de se tuer : la plus aspre de toutes, c'est la pierre à la vessie; la seconde, la grande douleur à l'estomac; la troisième, les névralgies de teste. » Or, si Pline revenait en ce monde, il verrait la chirurgie maîtresse de ces trois maux, tailler ou lithotritier les calculeux, réséquer ou gastro-entérostomiser les ulcères de l'estomac et attaquer, en plein crâne, la névralgie trifaciale. On dit (et c'est une légende) que, jadis, les enragés étaient étouffés entre deux matelas : une série de piqûres suffit maintenant à les préserver de leur horrible mort. Il y a quelques années, à peine, nous considérions le cancer ulcéré de la langue comme l'opprobre de la chirurgie : voici que le radium apporte ici des espoirs inattendus. Avec quelques gouttes d'adrénaline injectées en plein coeur, nous réanimons des malades en syncope mortelle; et, par la transfusion du sang, nous pouvons ressusciter les blessés saignés à blanc, et les sauver de cette fin par hémorragie, dont Virgile a tracé l'admirable tableau, dans son récit de la mort de Didon où il peint l'extrême faiblesse de la reine de Carthage (ter sese attollens, ter revoluta toro est, trois fois essayant de se soulever, trois fois retombant sur son lit), et où l'on croit recueillir son extrême soupir !
Révéler au malade l'incurabilité de son état, ce serait, de la part du médecin, plus qu'une cruauté, un manquement à son devoir; nous sommes les éternels berceurs de la souffrance humaine et, jusqu'au bout, nous devons, chez l'inguérissable, entretenir l'espérance. Plus j'avance dans la vie, disait un des vieux maîtres montpelliérains, Lordat, plus je m'identifie avec Thomas d'Aquin qui déclare : « Je préfère un sentiment qui me console à une vérité qui m'éclaire. »
Le hasard des vieilles lectures m'a fait retrouver dans les souvenirs de Nadar un épisode à peu près inconnu touchant de la vie de Dupuytren. Un soir, comme le grand chirurgien terminait sa consultation, il vit entrer un pauvre prêtre atteint d'une tumeur jugée incurable. Après examen, Dupuytren le regardant fixement lui dit « Eh! monsieur l'abbé, avec cela, il faut mourir. » L'abbé, sans s'émouvoir, tirant de sa poche une pièce de cinq francs, la déposa sur la cheminée : « Je ne suis pas riche, monsieur le docteur, et mes pauvres sont bien pauvres; pardonnez-moi si je ne puis pas payer plus cher une consultation du docteur Dupuytren; au moins, je serai tout à fait disposé à ce qui m'attend; croyez-le bien, j'attendais depuis longtemps ce moment-là et j'étais prêt. Adieu, monsieur le docteur; je vais mourir à mon presbytère. » Et il sortit. Dupuytren resta pensif : cette âme de fer venait de se briser à quelques simples paroles d'un pauvre prêtre; dans ce corps débile, il rencontrait un coeur plus ferme que le sien; il avait trouvé plus fort que lui. Il s'élança vers l'escalier : « Monsieur l'abbé, cria-t-il, voulez-vous remonter ? » L'abbé remonta. « Il y a peut-être moyen de vous sauver si vous voulez que je vous opère. − Eh! mon Dieu, dit l'abbé, je ne suis venu à Paris que pour cela. » Quelques jours plus tard, devant un public de cinq cents élèves, Dupuytren opérait le prêtre et le sauvait.
L'histoire dit encore que, quand Dupuytren fut à son lit de mort, il fit mander le pauvre prêtre. Le petit curé arriva aussitôt et resta longtemps enfermé avec lui : quand il sortit de la chambre du mourant, ses yeux étaient humides et sa physionomie rayonnait d'une douce exaltation. Le lendemain, Dupuytren mourait; après le service, les élèves portèrent à bras le cercueil du grand chirurgien jusqu'au cimetière. Le petit prêtre suivait le convoi en pleurant.
Il faut des âmes d'une trempe surhumaine pour résister à pareille révélation : Saint François d'Assise, à ses derniers jours, exigea de son médecin la vérité; celui-ci répondit : « Je conjecture que tu pourras vivre encore jusqu'à la fin de septembre »; François resta un moment silencieux; puis il éleva les mains vers le ciel et s'écria : « Eh bien ! donc, sois la bienvenue, ma soeur la Mort! »
« Dieu a fait deux dons à l'homme, dit Victor Hugo : l'espérance et l'ignorance; l'ignorance est le meilleur des deux.» C'est, en effet, l'ignorance de son destin; c'est l'illusion charitablement entretenue, qui soutient le cancéreux sur son chemin de croix : quelle est, au contraire, la détresse du médecin qui se sait, dès le début, frappé à mort, et qui suit pas à pas les étapes du mal, comme Trousseau voyant apparaître la phlegmatia alba dolens, dont il a précisé la valeur symptomatique et qui lui révèle le cancer gastrique dont il va mourir !
Notre devoir est de lutter, notre devoir est de conserver : c'est la noble réponse de Desgenettes à Bonaparte lui demandant d'empoisonner les pestiférés inévacuables de Jaffa : ce qui était, si l'on peut dire, de l'euthanasie en série. La scène a été souvent citée et mérite d'être rappelée : « Peu avant la levée du siège, raconte Desgenettes, le général Bonaparte me fit appeler de grand matin dans sa tente où il était seul avec son chef d'état-major. Après un court préambule sur la situation sanitaire, il me dit : « A votre place, je terminerais à la fois les souffrances de nos pestiférés, et je ferais cesser les dangers dont ils nous menacent, en leur donnant de l'opium.» « − Je répondis simplement : « Mon devoir, à moi, c'est de conserver. » Cette attitude est de tradition dans la chirurgie d'armée : un homme de la compagnie de M. de Rohan était atteint de sept coups d'épée à la tête; son maître, devant partir le lendemain, et estimant qu'il était inguérissable, voulait sans plus tarder, et par mesure d'euthanasie expéditive, le faire jeter dans une fosse qu'il avait fait creuser; Ambroise Paré intervint de toute sa charité agissante : « Je luy fis office, écrit-il, de médecin, d'apothicaire, de chirurgien et de cuisinier; je le pansai jusques à la fin de la cure et Dieu le guérit. »
Maeterlinck a écrit, dans son livre sur la mort : « Les médecins consentent peu à peu, lorsqu'il ne reste plus d'espoir, sinon à endormir, du moins à assoupir les suprêmes angoisses. » Cela c'est, en effet, notre droit, et, parfois, notre devoir : il ne s'agit plus, alors, d'une anticipation de la mort, mais d'une abréviation et d'une atténuation de l'agonie. Il y a, vraiment, certaines fins de vie qui excèdent ce que la créature humaine peut endurer ou ce que les êtres chers qui l'assistent peuvent subir, à l'extrême tension de leur sensibilité. A propos de la mort d’Henry Heine, Théophile Gauthier écrivait : « Il n'y a que la mère ou l'épouse qui puissent ne pas abandonner une aussi persistante agonie; les yeux humains ne sauraient, sans se détourner, contempler trop longtemps le spectacle de la douleur; les déesses mêmes s'en lassent et les trois mille Océanides qui vinrent consoler Prométhée sur sa croix du Caucase, s'en retournèrent le soir même. »
On comprend le cri du coeur échappé au compositeur Berlioz dont la soeur se mourait d'un cancer du sein : « Il ne se trouvera donc pas un médecin pour mettre fin à ce martyre. » Comme sainte Thérèse d'Avila, dans sa peine, la pauvre femme qui finit lentement d'un cancer de l'utérus, a le droit d'implorer la mort bienveillante et adoucie : « Qu'elle vienne donc la douce mort, disait la sainte, qu'il vienne le trépas, parce que je meurs de ne point mourir. » Mirabeau, dans ses derniers moments, ayant perdu l'usage de la parole, fit signe qu'on lui donnât une plume et du papier et il écrivit : « Dormir! » Cabanis et Petit se décidèrent à lui administrer de l'opium.
Opium et mentiri : morphine et illusions; ce sont les suprêmes secours qui, jusqu'au bout du chemin, doivent faire cortège à une vie qui s'éteint. Si le devoir du médecin est de lutter tant qu'il reste un espoir (dum spiro, spero), il y a parfois des doses inutiles d'huile camphrée, de sérum et d'oxygène, il y a des prolongations d'agonie qui sont une cruauté, et qui, pour une part, justifient les paroles excessives de Maeterlinck, quand il accuse les médecins de retarder la fin d'un supplice et d'accroître l'horreur de la mort.
Tout est relatif; car il est des cas, par contre, où il n'est pas indifférent de gagner, sur la mort, un délai de quelques heures, en donnant au malade, le temps de prendre ses dernières dispositions, de revoir des êtres aimés.
Au surplus, la douleur n'est pas la compagne nécessaire de la mort et il faut se rassurer sur les angoisses que paraissent éprouver certains agonisants qui n'en ont pas la perception. Maeterlinck lui-même veut bien reconnaître que « souvent la sensibilité de celui qui est aux abois de la mort, selon l'expression de Bossuet, déjà très émoussée, ne perçoit que la rumeur lointaine des souffrances qu'elle paraît endurer » : c'est d'un français assez incorrect, mais c'est d'une exacte notation. Sir William Osler, qui a tenu comptabilité de cinq cents agonies, observe que, dans les trois quarts des cas, le moribond a paru s'éteindre sans souffrance. Combien de fois nous avons été frappé, surtout dans les péritonites hypertoxiques, de cette euphorie, de cette sensation de bien-être, qui marque, cependant, le lâchage définitif du coeur et l'entrée en agonie ! William Hunter, le grand anatomiste, murmurait sur son lit de mort : « Si j'avais la force de tenir une plume, j'écrirais combien il est aisé et agréable (easy and pleasant) de mourir. » Et Montaigne, qui a rédigé son auto-observation, à l’occasion de sa grave commotion cérébrale, par chute de cheval, parle de cet alanguissement, de « cet état non seulement exempt de déplaisir, mais mêlé à cette douceur que sentent ceux qui se laissent glisser au sommeil ». «Je croy, ajoute-t-il, que c'est ce même estat où se trouvent ceux qu'on voit défaillir en l'agonie et tiens que nous les plaignons sans cause. » Comme l'écrivait notre collègue, le professeur Sabatier : « Quiconque a vu s'éteindre doucement un de ces vieillards chargés d'ans, par une lente diminution du mouvement vital, a pu s'apercevoir de ce qu'il y avait d'indolore et de calme dans cette extinction progressive de la vie corporelle. » C'est là la mort naturelle; et il est consolant d'entrevoir, à mesure que l'hygiène allonge la durée de la vie humaine, à mesure que notre espèce s'affranchit des maladies évitables, que sauf la menace encore inéluctable du cancer, une perspective de vie longue et saine, aboutissant à une fin douce et « indolore », s'ouvre de plus en plus, pour l'homme, dans l'avenir !
Plus que la morphine, la profonde paix de la conscience donne à la fin de la vie humaine sa sérénité et sa beauté tranquille. L'illusion consolatrice est un doux viatique vers l'au-delà. « Le meilleur médecin, a dit Richardson, est celui qui sait le mieux entretenir l'espérance. » Ce sont les forces morales, quelle qu'en soit la source, qui aident le mieux l'homme à franchir ce passage. Béatitude religieuse et espoir de vie future chez les uns; satisfaction du devoir pleinement rempli chez les autres; sacrifice à une grande cause : le support psychique est variable, mais c'est l'appui suffisant pour sortir de la vie, en beauté, en douceur. Pendant ses dernières heures, saint François se fait chanter le cantique du soleil; vers le soir, il chante lui-même, avec force, le psaume de David; sa petite cellule s'emplit d'ombre : enfin, sa voix se tait; il était entré, en chantant, dans l'éternité. Les yeux tournés vers l'horizon, dans un dernier regard, Mistral murmure : Li Santo! Li Santo! − Les Saintes de Provence, - puis il meurt ! Le maréchal Ney est amené sur le terrain d'exécution : au moment de monter dans la voiture cellulaire il s'adresse au curé de Saint-Sulpice et lui dit avec calme : « Montez le premier, monsieur le curé, je serai plus tôt que vous là-haut »; quand on lui propose de lui bander les yeux : « Ignorez-vous, répond-il, que depuis vingt-cinq ans, je sais regarder en face les balles et les boulets. » Gallieni termine sa vie, comme un saint laïque, à la clinique de Versailles, en demandant, jusqu'à la dernière minute, quelles étaient les dépêches venant de Douaumont et de Verdun. Goethe, un matin, son oeuvre étant consommée, se lève pour ouvrir sa fenêtre au printemps qui arrive; mais il retombe dans son fauteuil; sa main s'efforce de tracer quelques lignes dans le vide; il rend l'âme en murmurant ces mots : « Dass mehr Licht herein komme ! » Qu'il entre plus de lumière !
Voilà des exemples d'euthanasie morale. Et c'est bien la grande accalmie finale que Sully-Prudhomme a traduite dans ce poème, de si humaine émotion, qui est, à mon sens, un des plus purs chefs-d'oeuvre du lyrisme français :
Vous qui m'aiderez dans mon agonie,
Ne me dites rien !
Faites que j'entende un peu d'harmonie
Et je mourrai bien...
Ainsi mourut doucement, l'âme plongée dans la mélodie, mademoiselle de Limeuil, fille d'honneur de Catherine de Médicis. Voici le savoureux récit qu'en fait Brantôme.
Quand l'heure de la mort fut venue, elle fit .venir son valet qui s'appelait Julien, et qui savait très bien jouer du violon. « Julien, lui dit-elle, prenez votre violon, et sonnez-moi toujours, jusqu'à ce que vous me voyiez morte, la Défaite des Suisses, et le mieux que vous pourrez; et quand vous serez sur le mot, tout est perdu, sonnez-le par quatre ou cinq fois, le plus piteusement que vous pourrez. » Ce que fit l'autre et quand se vint tout-est perdu, elle réitère par deux fois, se tournant de l'autre côté du chevet, elle dit à ses compagnes : « Tout est perdu à ce coup, et à bon escient »; et ainsi décéda.
Émile Forgue
Médecin, Professeur de Clinique chirurgicale, Membre correspondant de l'Académie de médecine
Source imprimée : La Revue de Paris, année 32, tome 2, 1er mars 1925, p. 161-178.
***
"Sciences médicales. L'euthanasie", par Henri Bouquet
Un drame lamentable vient de poser une fois de plus le problème de l'euthanasie, c'est-à-dire de la mort provoquée dans le dessein de faire cesser les souffrances d'un malade que l'on estime incurable. On connaît les faits : une mère a tué son fils qui, atteint d'un cancer contre lequel la médecine se reconnaissait impuissante, endurait un horrible martyre. Après quoi elle est allée se noyer. Eut-elle raison ou non ? Voici la controverse rouverte.
Ni la question ni le mot ne sont nouveaux. Les historiens n'ont pas de peine à découvrir dans l'antiquité même des cas de ce genre, et le terme d'euthanasie a été proposé au XVIIe siècle par Bacon dans le Novum Organum. Mais il est hors de doute que les exemples de cette pitié meurtrière se sont singulièrement multipliés à notre époque; ce n'est que récemment que des projets de loi ont été déposés dans certains Parlements pour légaliser, pour ainsi dire, cette hardie façon de faire (cette initiative n'a d'ailleurs jamais eu de succès); ce n'est que de notre temps qu'une fille a demandé aux pouvoirs publics l'autorisation d'agir ainsi vis-à-vis de sa mère. Cette autorisation, beaucoup s'en sont passés.
Lorsque nous lisons le récit d'un drame de cette espèce, notre esprit est partagé entre l'étonnement, la pitié et la révolte. Au bout d'un certain temps, deux de ces sentiments s'atténuent, le second seul persiste, et c'est heureux pour l'acteur du drame qui est régulièrement acquitté, ce que nous finissons par trouver juste. Ces acquittements − et la publicité qu’ils donnent au geste meurtrier − ont d'ailleurs un effet désastreux, qui est de multiplier par contagion le nombre de ceux qui croient devoir faire de même dans des circonstances qu'ils jugent analogues. En 1925, à la suite de l'acquittement de Mme Uminska, qui avait mis ainsi un terme aux souffrances de son mari, on assista à une véritable épidémie d'euthanasie provoquée. Au demeurant, les circonstances sont rarement identiques et ce pardon, que nous ne pouvons faire autrement que d'approuver, ne manque pas de provoquer des abus. On a vu des gens, de parfaite bonne foi, exécuter ainsi des êtres chers sans motifs suffisants.
Mais sur ce point tout a été dit sans doute, de même que l'opinion des juristes, des moralistes, des ministres religieux est connue. Elle se confond avec celle des simples honnêtes gens qui n'admettent que difficilement que l'on supprime une vie humaine, dans quelque cas que ce soit. Certes, il y a des drames exceptionnels qui font chanceler notre belle assurance. Le docteur Blazer avait une fille qui était proprement un déchet d'humanité: née sans bras ni jambes, sourde-muette et idiote, elle ne connaissait que son père, qui ne la quittait pas; lui seul s'occupait d'elle avec la sollicitude infinie, sans lassitude, qui s'imposait vis-à-vis de cette tragique infortune; au bout de 32 ans de ces soins inimitables, se sentant lui-même frappé à mort, il la tua, afin qu'elle ne fût pas l'innocente victime, livrée à des mains indifférentes, de sa monstruosité, qu'elle ne connût pas l'horrible abandon après l'affection paternelle qui ne s'était pas ralentie une heure. Mais, en face de cette tragédie, en nous revient, implacable, la parole sainte : «Tu ne tueras point», et la conscience des philosophes et des penseurs, rejoignant la nôtre, réprouve unanimement cette sorte de meurtre qui, malgré toute la puissance des excuses qu'on lui peut découvrir, n'en reste pas moins un meurtre. Résumons cet avis dans deux phrases : « Le droit de supprimer la vie ne nous appartient pas », dit l'abbé Peylaube, ce à quoi le doyen Berthélemy ajoute : « Au-dessus de tout, il y a le respect de la vie humaine. » Ce côté moral, philosophique, légal de la question, je le laisse à développer à d'autres. Je ne veux parler ici que de l'opinion des médecins, et ceci pour deux raisons. La première est qu'ils sont particulièrement compétents dans ce domaine de la souffrance, contre laquelle ils luttent sans cesse et dont ils connaissent mieux que quiconque les modalités et les retentissements, dans le domaine aussi du pronostic sur lequel prétendent se baser ceux qui suppriment aussi brutalement des souffrances jugées par eux insupportables. La seconde raison est que, immanquablement, quand un fait de ce genre est connu, ceux qui approuvent ce meurtre sentimental demandent que les médecins en soient chargés et que ce soit eux qui mettent un terme à ces martyres.
Cette opinion des médecins, j'ai eu l'occasion d'en parler il y a vingt ans, au moment où venait de paraître le beau livre de Maeterlinck, la Mort. Le grand écrivain belge est, en effet, un de ceux qui ont formulé le plus énergiquement - et avec quel talent! - la thèse à laquelle j'ai fait allusion lorsqu'il a dit : « Les médecins estiment que le premier de leurs devoirs est de mener aussi loin que possible les convulsions les plus atroces de l'agonie la plus désespérée... Ils agissent comme s'ils étaient convaincus qu'il n'est point de torture connue qui ne soit préférable à celles qui nous attendent dans l'inconnu... et de deux maux, pour éviter celui qu'ils savent imaginaire, choisissent le seul réel... Un jour viendra où la science se retournera contre son erreur et n'hésitera plus à accourcir nos disgrâces.»
Ce jour n'a pas encore lui, et ce qui en a empêché l'avènement, ce sont les raisons que j'alléguais à ce moment, qui ont gardé depuis toute leur valeur et que les médecins invoquent quand, d'un commun accord (car on peut dire qu'il n'y a pas d'exception), ils repoussent la besogne d'assassinat légal qu'on voudrait leur imposer. Ils la repoussent aujourd'hui comme la repoussait Desgenettes qui, à Bonaparte lui demandant d'abréger les souffrances des pestiférés, répondait : « Mon devoir, à moi, c'est de conserver. » Depuis lors, nombreux sont ceux qui ont approfondi le problème, et il me suffira de citer quelques noms parmi nos contemporains, ceux de Grasset, de Ch. Richet, de Forgue, de H. Roger, pour donner à cette opinion unanime un poids imposant.
Les arguments sur lesquels les médecins s'appuient pour se refuser à être des artisans d'euthanasie, ils les tirent en grande partie de la connaissance qu'ils ont des erreurs toujours possibles pour un art en perpétuel devenir comme celui qu'ils exercent. Il faudrait, en effet, à cet acte hors série qu'on leur demande d'accomplir, une base inébranlable : ce serait la certitude absolue que le mal est bien ce qu'ils jugent qu'il est, que son incurabilité est hors de conteste et enfin que les souffrances qu'on les prie d'abréger ne connaîtront pas de rémission jusqu'à l'heure dernière. Ces bases, ils ne sont pas toujours assurés de les posséder.
Qui donc, parmi les médecins, se peut faire fort de ne jamais errer dans le diagnostic et, corrélativement, dans le pronostic ? N'ont-ils pas vu souvent les événements démentir leurs prévisions ? N'ont-ils pas vu, par exemple, de prétendus cancers qui n'étaient que des tumeurs inflammatoires, de supposés sarcomes des os qui se résolvaient en abcès, de fausses paralysies générales, des angines de poitrine qui disparaissaient spontanément un beau jour, des affections de la moelle dont l'évolution, brusquement, tournait court ? N'ont-ils pas constaté parfois que d'horribles douleurs qui duraient depuis longtemps s'évanouissaient soudain ou du moins s'amendaient dans de surprenantes proportions ? Ignorent-ils que les progrès de certaines lésions ont pour résultat l'apaisement des souffrances ? Nient-ils que les procédés de laboratoire, conquête moderne cependant inappréciable, ne donnent que rarement des précisions inattaquables et que leurs résultats sont sujets à des interprétations où, comme dans toute opération de l'esprit humain, peut se glisser l'erreur ? L'un d'eux a écrit jadis sur ce thème un roman qui portait le titre Plutôt souffrir et où justement il s'agissait d'un faux cancer qui avait donné lieu à une provocation d'euthanasie. Dans combien de cas l'homme de l'art le plus averti, le plus consciencieux, le plus habile, peut-il dire en toute sûreté que tout espoir doit être définitivement abandonné et fixer une limite exacte à la vie d'un malade, si ce n'est dans certaines agonies terminales où la plupart du temps la conscience a disparu et, avec elle, la souffrance réelle ? Devant une aussi fréquente incertitude, quel est celui qui assumerait sans frémir la responsabilité d'un geste aux conséquences définitives ? Lorsque, par hasard, comme à Chicago en 1917, l'un d'eux y a consenti, n'a-t-il pas été unanimement désavoué par ses confrères ?
Et si le médecin met toujours quelque réserve dans son diagnostic et surtout dans son pronostic, quelle prudence ne devront pas apporter en ces matières ceux qui n'ont même pas pour les guider le savoir et l'expérience ? Sur quoi donc jugent-ils qui puisse leur donner une assurance telle qu'ils n'hésitent pas devant les conséquences de la conviction qu'ils se sont faite?
***
D'autre part, le médecin sait bien que les malades les plus torturés et les plus résignés en apparence gardent toujours au coeur quelque espoir que la situation n'est pas pour eux sans aucune autre issue que celle qui aboutit à la tombe. S'ils n'ont plus foi dans la science des hommes, peut être l'ont-ils dans un miracle divin. Il ne faut se fier qu'à moitié au stoïcisme avec lequel ils demandent la vérité absolue sur ce que leur réserve un avenir plus ou moins proche; ils tremblent, en réalité qu'on la leur dise si elle doit être désespérante. La fable du bûcheron et de la mort est applicable aux misères physiques de tout genre et tel qui appelle à grand cri la camarde se satisfait de voir qu'elle ne répond pas. De quel droit prend-on pour argent comptant ce souhait de 1a fin, qui est si rarement sincère ? Dans combien de cas serait-on autorisé à accéder à ce désir même formulé et dans combien d'autres n'a-t-on pas agi le malade étant peu conscient, sans s'assurer que sa volonté correspondait sans réticence à la persuasion de ses proches ? Ne pourrait-on même répondre à Maeterlinck que c'est, en effet, devant un inconnu, que beaucoup d'hommes regardent comme redoutable en raison de son mystère même, que se cabre la raison humaine et que s'effraye l'esprit ? Qui donc sait à coup sûr ce qu'est la mort et vers quoi s'achemine celui qui succombe et celui que l'on aide à succomber ?
En troisième lieu, les progrès mêmes de la médecine doivent rendre le médecin plus circonspect encore dans son verdict et renforcer sa détermination de ne pas accomplir l'acte irrémédiable. Il n'est pas d'année où l'humanité ne soit dotée de remèdes actifs et inédits, où quelque nouvelle hardiesse chirurgicale ne vienne améliorer des situations que l'on pouvait tenir auparavant pour désespérées, où quelque méthode de traitement jusqu'alors inconnue ne remette en question des pronostics que l'on pensait immuables. Quel était le sort fatal de ceux qui avaient subi les morsures profondes d'un animal enragé avant la découverte de Pasteur ? La paralysie générale, qui jadis ne pardonnait pas, cède maintenant, dans maint cas, à l'inoculation du paludisme. C'est hier que l'on nous apportait des cas de méningite tuberculeuse guéris. En matière de cancer, la science progresse et des espoirs nouveaux luisent à tout instant. N'est-ce pas demain que l'affreux mal sera vaincu, tout au moins dans quelques-unes de ses formes ? Que direz-vous si, quelques heures après le meurtre par pitié, la découverte est proclamée ?
Enfin, pourquoi s'adresser au médecin en pareil cas ? Retient-il, par hasard, comme je le demandais déjà il y a vingt ans, des secrets tels qu'il soit seul à les connaître ? Possède-t-il des agents particulièrement actifs ou des méthodes ignorées de tout autre ? Est-ce en je ne sais quel tour de main spécial que l'on mettrait une si aveugle et si exclusive confiance ? A ces questions, il semble que les faits eux-mêmes ont suffisamment répondu. Ceux qui délibérément, jusqu'ici, ont supprimé l'un de leurs proches pour lui épargner d'indicibles souffrances n'ont pas fait, qua je sache, appel au médecin. Ils s'en sont parfaitement tirés sans son aide. Les innombrables suicides qu'enregistre notre époque démontrent bien qu'assez d'agents de mort subite sont à la disposition de tous. Si le malade ne peut mettre lui-même un terme à sa torture, c'est aux parents qu'incombe, en admettant qu'à d'autres point de vue le geste soit acceptable, la responsabilité de le remplacer. Cette responsabilité, le médecin n'a aucune raison de l'endosser; c'est déjà assez qu'il porte celle de son pronostic, dans lequel il a cependant introduit souvent les réserves qui s'imposent. Devant la justice, comment légitimerait-il son acte et serait-il aussi sûrement mis hors de cause que la mère, l'épouse ou le fils qui ont hâté la fin de l'être qu'ils chérissaient ?
Voilà bien longtemps que la mission du médecin a été codifiée dans la phrase célèbre : « Guérir quelquefois, soulager souvent, consoler toujours. » La médecine guérit aujourd'hui beaucoup plus souvent qu’elle ne le faisait jadis, et surtout elle soulage mieux et dans bien des cas où elle ne savait pas autrefois parer aux souffrances des hommes. Nous possédons à l'heure actuelle des méthodes et des remèdes qui nous permettent de supprimer, d'atténuer tout au moins la douleur dans les maladies les plus torturantes et on en invente tous les jours. Dans cet arsenal, nous avons le droit et le devoir de puiser. Ce n'est certes pas sans risques que nous pouvons nous servir des uns et des autres chez des malades graves quand il nous faut atteindre, pour qu'ils ne souffrent plus, les fortes intensités ou les doses massives. Mais ce risque, il est de ceux que les médecins savent accepter. Opium et mentiri, disait la médecine ancienne quand elle traçait le devoir du médecin en présence de douleurs résultant de lésions dites incurables. Nous avons autre chose que l'opium à opposer à ces tortures et le mensonge sera longtemps encore un agent d'apaisement. Calmer la souffrance par tous les moyens possibles, tel est le rôle du médecin en face de ces situations effroyables, mais il ne saurait aller plus loin. La mort est l'ennemie qu'à chaque instant de sa vie professionnelle il combat. Ne lui demandez pas de hâter, dans quelque circonstance que ce soit, son inévitable triomphe.
Docteur Henri Bouquet
Source imprimée : Revue générale des sciences pures et appliquées, tome 44, 1933, p. 532-534. |
|
 |
|
|
 |
|
|
|
 |
|
|
 |
 | Autres documents associés au dossier Euthanasie |
 |  |
 |
 |
| | Euthanasie: les enjeux lointains | | Auteur: Jacques Dufresne | | Eugénisme, Mort, Suicide, Culte des morts, Soins palliatifs, Mystère, Problème | | Extrait: L'éthique est une science de la complexité. Pour comprendre la question de l'euthanasie, il faut la situer par rapport aux divers courants qui l'ont imposée à nos esprits. |  | | Euthanasie et complexité | | Auteur: Jacques Dufresne | | Mort, Euthanasie, Complexité, Système vivant, Culte des morts, | | Extrait: Dans la science classique, on considérait bien des facteurs comme négligeables. C'est ce qui a permis à Newton d'établir les lois simples et élegantes de l'attraction. |  | | Euthanasie des incurables | | Auteur: Thomas More | | Extrait: Les malheureux affligés de maux incurables reçoivent toutes les consolations, toutes les assiduités, tous les soulagements moraux et physiques capables de leur rendre la vie supportable. |  | | L'euthanasie familiale dans la France du XIXe siècle | | Auteur: Philippe Ariès | | Extrait: CRITÈRE. Que pensez-vous du jugement rendu dans le cas de la petite Américaine, Karen (1), dont on a prolongé l'existence artificiellement? On a donné raison aux médecins. P. A. |  | | Le médecin doit adoucir les douleurs et les souffrances attachées aux maladies | | Auteur: Francis Bacon | | Extrait: Je dirai de plus, en insistant sur ce sujet, que l’office du médecin n’est pas seulement de rétablir la santé, mais aussi d’adoucir les douleurs et les souffrances attachées aux maladies; |  | | Les principes et la réalité | | Extrait: « Gilles Carle a-t-il déjà songé au suicide assisté? Chloé Sainte-Marie répond : "Non. Il a toujours dit quand il était en parfaite santé qu'il était pour l'euthanasie. (.) Quand on est dans la situation où la mort est proche, le discours change.» |  |

|
 |
|
 |
|
|
|
| | L'autiste show de Blainville |
| | L'autiste show | | | Difficile de passer sous silence cette joyeuse initiative: les Autiste Show, qui ont lieu dans diverses régions du Québec, entre autres, Ville Lorraine et Repentigny, au printemps. Nous présentons celui qui a eu lieu le 22 mai 2010 au manège du Parc équestre de Blainville, à l'initiative de la ,
|  | | | Régime enregristré d'épargne invalidité |
| | Assouplissement de l'admissibilité au REEI | | | Pour être admis au REEI, il faut déjà être admis au régime de crédit d'impôt, ce qui suppose qu'on ait de l'argent dans un compte en banque. Jusqu'à ce jour, il n'était pas possible d'en appeler de cette règle. La procédure ayant récemment été simplifiée, les plus pauvres auront plus facilement droit au REEI. |  | | | Ce 3 décembre 2010, Journée Internationale des personnes handicapées |
| | Vivre, peindre et écrire avec le syndrome de Down | | | La video est en anglais, mais comme d'une part le son n'y est pas très clair et comme d'autre part le langage de la personne en cause est la peinture, vous ne perdrez rien si vous vous limitez à regarder attentivement les visages et les tableaux. Elisabeth Etmanski, née il y a trente-deux ans avec le syndrome de Down, mène une vie autonome depuis longtemps. Ne soyez pas étonnés, si jamais vous la rencontrez, qu'elle vous salue en écrivant ou en disant un poème à votre sujet. Votre sensibilité est peut-être reléguée à l'arrière plan de votre être, la sienne imprègne tout sa personne y compris la surface. Vous comprendrez à son contact comment le réenchantement du monde peut s'opérer. Quelles sont ses aspirations en tant que peintre? On lui pose la question à la fin de la video. Sa réponse est à l'image de sa personne, naïve: «Je veux être la prochaine Emily Carr.» |  |
|
 |
|
|
 |
 |
 |
|
 |  |
|