 |
|
 |
|
|
 | | Revue Le partenaire |  | | Créée en 1992, la revue le partenaire est devenue au Québec une voix importante pour les personnes utilisatrices de services en santé mentale et pour tous les acteurs concernés par la réadaptation psychosociale, le rétablissement et la problématique de la santé mentale. Ses éditoriaux, ses articles, ses dossiers proposent une information à la fine pointe des connaissances dans le champ de la réadaptation psychosociale. Ils contribuent à enrichir la pratique dans ce domaine et à stimuler le débat entre ses membres. | |
| Destination El Paradiso | 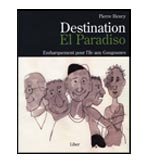 | | El Paradiso n’est pas une maison de retraite comme les autres. Située dans une île enchanteresse qui est réservée à son usage, elle accueille des pensionnaires bien particuliers. Ce sont, par un aspect ou l’autre de leur vie, par ailleurs tout à fait honorable, des originaux, des excentriques, habités par une douce folie, qui n’a sans doute d’égal que la simplicité de leur bonheur. C’est une galerie de personnages un peu fantasques que nous fait rencontrer cet ouvrage tout empreint de tendresse, d’humour et d’humanité. Voici donc les premiers douze membres de ce club très spécial:
Perry Bedbrook, Guy Joussemet, Édouard Lachapelle, Andrée Laliberté,
Céline Lamontagne, Guy Mercier, Avrum Morrow, Lorraine Palardy,
Antoine Poirier, Michel Pouliot, Charles Renaud, Peter Rochester.
| |
| Le Guérisseur blessé |  | | Le Guérisseur blessé de Jean Monbourquette est paru au moment où l’humanité entière, devant la catastrophe d’Haïti, s’est sentie blessée et a désiré contribuer de toutes sortes de façons à guérir les victimes de ce grand malheur. Bénéfique coïncidence, occasion pour l’ensemble des soignants du corps et de l’âme de s’alimenter à une source remarquable.
Dans ce livre qui fut précédé de plusieurs autres traitant des domaines de la psychologie et du développement personnel , l’auteur pose une question essentielle à tous ceux qui veulent soigner et guérir : « Que se cache-t-il derrière cette motivation intime à vouloir prendre soin d’autrui? Se pourrait-il que la majorité de ceux et celles qui sont naturellement attirés par la formation de soignants espèrent d’abord y trouver des solutions à leurs propres problèmes et guérir leurs propres blessures? » Une question qui ne s’adresse évidemment pas à ceux qui doivent pratiquer une médecine de guerre dans des situations d’urgence! | |
| Mémoire et cerveau |  | | Dans ce numéro de La Recherche, on se limite à étudier la mémoire dans la direction indiquée par le psychologue torontois Endel Tulving, reconnu en en ce moment comme l'un des grands maîtres dans ce domaine. Cela confère au numéro un très haut degré de cohérence qui en facilite la lecture. Culving est à l'origine de la distinction désormais universellement admise entre la « mémoire épisodique » portant sur des événements vécus et la « mémoire sémantique » portant sur des concepts, des connaissances abstraites. C'est la première mémoire que je mets en œuvre quand je m'efforce d'associer des mots à un événement passé, un voyage par exemple; je m'en remets à la seconde quand je m'efforce d'associer des mots automatiquement les uns aux autres, abstraction faite de tout événement vécu auquel ces mots pourraient se rapporter. Au cours de la décennie 1960, Tulving a constaté que les résultats obtenus grâce au premier exercice étaient beaucoup moins bons que ceux obtenus par le second exercice, ce qui l'a incité à faire l'hypothèse qu'il existe deux mémoires distinctes. | |
| Spécial Mémoire |  | | Dans ce numéro de La Recherche, on se limite à étudier la mémoire dans la direction indiquée par le psychologue torontois Endel Tulving, reconnu en en ce moment comme l'un des grands maîtres dans ce domaine. Cela confère au numéro un très haut degré de cohérence qui en facilite la lecture. Culving est à l'origine de la distinction désormais universellement admise entre la « mémoire épisodique » portant sur des événements vécus et la « mémoire sémantique » portant sur des concepts, des connaissances abstraites. C'est la première mémoire que je mets en œuvre quand je m'efforce d'associer des mots à un événement passé, un voyage par exemple; je m'en remets à la seconde quand je m'efforce d'associer des mots automatiquement les uns aux autres, abstraction faite de tout événement vécu auquel ces mots pourraient se rapporter. Au cours de la décennie 1960, Tulving a constaté que les résultats obtenus grâce au premier exercice étaient beaucoup moins bons que ceux obtenus par le second exercice, ce qui l'a incité à faire l'hypothèse qu'il existe deux mémoires distinctes.
| |
| L'itinérance au Québec |  | | La personne en situation d’itinérance est celle :
[…] qui n’a pas d’adresse fixe, de logement stable, sécuritaire et salubre, à très faible revenu, avec une accessibilité discriminatoire à son égard de la part des services, avec des problèmes de santé physique, de santé mentale, de toxicomanie, de violence familiale ou de désorganisation sociale et
dépourvue de groupe d’appartenance stable.
Cette définition met en évidence la complexité du phénomène et l’importance de l’aspect multifactoriel des éléments déclencheurs tels que la précarité résidentielle et financière, les ruptures sociales, l’accumulation de problèmes divers (santé mentale, santé physique, toxicomanie, etc.). L’itinérance n’est pas un phénomène dont les éléments forment un ensemble rigide et homogène et elle ne se limite pas exclusivement au passage à la rue.L’itinérance est un phénomène dynamique dont les processus d’exclusion, de marginalisation et de désaffiliation
en constituent le coeur. | |
| L’habitation comme vecteur de lien social |  | | Evelyne Baillergeau et Paul Morin (2008). L’habitation comme vecteur de lien social, Québec, Collection
Problèmes sociaux et intervention, PUQ, 301 p.
Quel est le rôle de l’habitation dans la constitution d’un vivre ensemble entre les habitants d’un immeuble, d’un ensemble d’habitations ou même d’un quartier ? Quelles sont les répercussions des conditions de logement sur l’organisation de la vie quotidienne des individus et des familles et sur leurs modes d’inscription dans la société ? En s’intéressant à certaines populations socialement disqualifi ées, soit les personnes ayant des problèmes de santé mentale et les résidents en habitation à loyer modique, les auteurs étudient le logement non seulement comme l’un des déterminants de la santé et du bien-être, mais également comme un lieu d’intervention majeur dans le domaine des services sociaux. De la désinstitutionnalisation à l’intégration, des maisons de chambres aux HLM, ils décrivent et analysent des expériences ayant pour objectif le développement
individuel et collectif des habitants et les comparent ensuite à d’autres réalisées au Canada, aux Pays-Bas et en Italie.
Pour en savoir plus : http://www.puq.ca | |
| Revue Développement social |  | | On a longtemps sous-estimé l'importance du lien entre les problèmes environnementaux et la vie sociale. Nous savons tous pourtant que lorsque le ciel est assombri par le smog, on hésite à sortir de chez soi pour causer avec un voisin. Pour tous les collaborateurs de ce numéro consacré au développement durable, le côté vert du social et le côté social du vert vont de soi. La vue d'ensemble du Québec qui s'en dégage est enthousiasmante. Les Québécois semblent avoir compris qu'on peut redonner vie à la société en assainissant l'environnement et que les défits à relever pour assurer le développement durable sont des occasions à saisir pour resserrer le tissu social.
| | La réforme des tutelles: ombres et lumières. |  | | En marge de la nouvelle loi française sur la protection des majeurs, qui doit entrer en vigueur en janvier 2009.
La France comptera un million de personnes " protégées " en 2010. Le dispositif actuel de protection juridique n'est plus adapté. Ce " livre blanc " est un plaidoyer pour une mise en œuvre urgente de sa réforme. Les enjeux sont clairs lutter contre les abus, placer la protection de la personne, non plus seulement son patrimoine, au cœur des préoccupations, associer les familles en les informant mieux, protéger tout en respectant la dignité et la liberté individuelle. Le but est pluriel. Tout d'abord, rendre compte des difficultés, des souffrances côtoyées, assumer les ombres, et faire la lumière sur la pratique judiciaire, familiale et sociale ; Ensuite, expliquer le régime juridique de la protection des majeurs, et décrire le fonctionnement, les bienfaits, et les insuffisances ; Enfin, poser les jalons d'une réforme annoncée comme inéluctable et imminente mais systématiquement renvoyée à plus tard.
Les auteurs: Michel Bauer, directeur général de l'Udaf du Finistère, l'une des plus grandes associations tutélaires de France, anime des groupes de réflexion sur le sujet et œuvre avec le laboratoire spécialisé de la faculté de droit de Brest. II est l'auteur d'ouvrages sur les tutelles et les curatelles. Thierry Fossier est président de chambre à la cour d'appel de Douai et professeur à l'Université d'Auvergne, où il codirige un master et l'IEJ. II est fondateur de l'Association nationale des juges d'instance, qui regroupe la grande majorité des juges des tutelles. II est l'auteur de nombreuses publications en droit de la famille et en droit des tutelles. Laurence Pécaut-Rivolier, docteur en droit, est magistrate à la Cour de cassation. Juge des tutelles pendant seize ans elle préside l'Association nationale des juges d'instance depuis plusieurs années. | |
| Puzzle, Journal d'une Alzheimer |  | | Ce livre, paru aux Éditions Josette de Lyon en 2004, a fait l'objet d'une émission d'une heure à Radio-France le 21 février 2008. Il est cité dans le préambule du rapport de la COMMISSION NATIONALE CHARGÉE DE L’ÉLABORATION DE PROPOSITIONS POUR UN PLAN NATIONAL CONCERNANT
LA MALADIE D’ALZHEIMER ET LES MALADIES APPARENTÉES. Ce rapport fut remis au Président de la République française le 8 novembre 2007.
«Je crois savoir où partent mes pensées perdues : elles s’évadent dans mon coeur…. Au fur et à mesure que mon cerveau se vide, mon coeur doit se remplir car j’éprouve des sensations et des sentiments extrêmement forts… Je voudrais pouvoir vivre le présent sans être un fardeau pour les autres et que l’on continue à me traiter avec amour et respect, comme toute personne humaine qui a des émotions et des pensées,même lorsque je semble «ailleurs »1à.
| | Les inattendus (Stock) |  | | Premier roman d'Eva Kristina Mindszenti, jeune artiste peintre née d’un père hongrois et d’une mère norvégienne, qui vit à Toulouse. Le cadre de l'oeuvre: un hôpital pour enfants, en Hongrie. «Là gisent les "inattendus", des enfants monstrueux, frappés de maladies neurologiques et de malformations héritées de Tchernobyl, que leurs parents ont abandonné. Ils gémissent, bavent, sourient, râlent, mordent parfois. Il y a des visages "toujours en souffrance" comme celui de Ferenc évoquant "le Christ à la descente de la croix". Tout est figé, tout semble mort. Pourtant, la vie palpite et la beauté s’est cachée aussi au tréfonds de ces corps suppliciés. » (Christian Authier, Eva Kristina Mindszenti : une voix inattendue, «L'Opinion indépendante», n° 2754, 12 janvier 2007) | |
| En toute sécurité |  | | Cet ouvrage est l'adaptation québécoise de Safe and secure, publié par les fondateurs du réseau PLAN (Planned Lifetime Advocacy Network) et diffusé au Québec par un groupe affilié à PLAN, Réseaux pour l'avenir. Il s'agit d'un guide pratique dont le but est d'aider à les familles à planifier l'avenir "en toute sécurité" des membres de leur famille aux prises avec un handicap. | |
| "Il faut rester dans la parade ! " - Comment vieillir sans devenir vieux |  | | Auteur : Catherine Bergman. Éditeur : Flammarion Québec, 2005. "Dominique Michel, Jacques Languirand, Jean Béliveau, Antonine Maillet, Jean Coutu, Gilles Vigneault, Hubert Reeves, ils sont une trentaine de personnalités qui, ayant dépassé l’âge de la retraite, sont restés actives et passionnées. Ils n’ont pas la prétention de donner des conseils ni de s’ériger en modèles, mais leur parcours exceptionnel donne à leur parole une valeur inestimable. Journaliste d’expérience, Catherine Bergman les interroge sur le plaisir qu’ils trouvent dans ce qu’ils font, leur militantisme et leur vision de la société ; sur leur corps, ses douleurs et la façon dont ils en prennent soin ; sur leur rapport aux autres générations, ce qu’ils ont encore à apprendre et l’héritage qu’ils souhaitent transmettre ; sur leur perception du temps et leur peur de la mort. Son livre est un petit bijou, une réflexion inspirante sur la vieillesse et l’art d’être vivant." (présentation de l'éditeur). | |
| Le temps des rites. Handicaps et handicapés |  | | Auteur : Jean-François Gomez.
Édition : Presses de l'Université Laval, 2005, 192 p.
"Il est temps aujourd’hui de modifier profondément notre regard sur les personnes handicapées et sur les « exclus » de toute catégorie, qu’ils soient ou non dans les institutions. Pour l’auteur du Temps des rites, l’occultation du symbolique, ou son déplacement en une société de « signes » qui perd peu à peu toutes formes de socialités repérable et transmissible produit des dégâts incalculables, que les travailleurs sociaux, plus que quiconque doivent intégrer dans leur réflexion.
Il faudrait s’intéresser aux rituels et aux « rites de passage » qui accompagnaient jusque là les parcours de toute vie humaine, débusquer l’existence d’une culture qui s’exprime et s’insinue dans toutes les étapes de vie. On découvrira avec étonnement que ces modèles anciens qui ont de plus en plus de la peine à se frayer une voie dans les méandres d’une société technicienne sont d’une terrible efficacité." | |
| Dépendances et protection (2006) |  | | Textes des conférences du colloque tenu le 27 janvier 2006 à l'Île Charron. Formation permanente du Barreau du Québec. Volume 238. 2006 | |  |
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
|
|
| Originaux et détraqués - Douze types québecquois 2 |
 |
| Louis Fréchette |
  |
 |
 |
 |
| Texte |
III. Drapeau
I
Tous ceux qui ont visité notre pays le diront comme moi, le bassin de Québec présente un des plus beaux coups d’œil qui soient au monde.
Ce soir-là, le hasard m’avait conduit sur le haut des grandes falaises de Lévis, d’où le regard embrasse ce merveilleux horizon, et ma rêverie d’enfant – j’avais quinze ans à peine – m’y avait fait oublier l’heure.
Le soleil plongeait tout rouge derrière les couronnements massifs et sombres de la ville qu’on a appelée le Gibraltar d’Amérique, allumant des lignes d’or et des aigrettes de flamme à l’angle des pinacles, des dômes et des clochers à jour étagés aux flancs du promontoire.
La basse ville s’enveloppait de nuit, jusqu’aux arêtes du cap Diamant, dont la masse noire enténébrait le fleuve, tandis que l’embouchure du Saint-Charles et son vaste estuaire se teintaient de rose et de lilas sous les lueurs du crépuscule, qui, des hauteurs de Charlesbourg, épanouissait son éventail dans le ciel.
Sur les pentes de Beauport, des alternatives de taches brunes et de flaques de lumière, variables d’aspect comme un décor de féerie, allaient se perdant, lentement et une à une, dans l’élargissement des ombres et l’effacement de la perspective.
À droite et à gauche, les lointains s’estompaient petit à petit dans le bleuâtre des brumes ouateuses.
Devant moi, la ville crénelée, assise dans le noir et le front nimbé d’apothéose, se ceinturait d’une myriade de petits points d’or multipliés à l’infini dans le frissonnement des vagues.
À mes pieds, du pont des navires à l’ancre ou du foyer rougeâtre des grands radeaux endormis dans les enfoncements de la côte, une voix isolée s’élevait par intervalles, mêlant sa note mélancolique aux derniers bruits du jour !...
Et la nuit descendait, descendait, noyant dans l’obscurité, comme une marée montante, les prés, les maisons, les rochers et les bois, tandis que le Saint-Laurent, de plus en plus assombri, et se laissant à peine deviner dans l’ombre, semblait, pour ne pas troubler la paix de l’heure sereine, retenir sa respiration de géant assoupi.
Tout à coup un éclair creva au flanc du bastion le plus élevé de la forteresse.
Puis, quelques instants après – le temps aux ondes sonores de parvenir jusqu’à moi – une détonation se fit entendre, puissante comme un coup de tonnerre, et, répétée d’échos en échos, alla s’éteindre en grondements sourds du côté du cap Tourmente, dans les solitudes revêches des montagnes du nord.
C’était le canon de la citadelle annonçant la demie de neuf heures, du haut de son immense affût de granit.
Les dernières vibrations flottaient encore dans l’atmosphère, lorsqu’un choc nerveux me secoua de la tête aux pieds.
Une voix tonitruante venait d’éclater au-dessus de moi. Je levai la tête.
Et j’aperçus, aux dernières lueurs du couchant, un grand vieillard augeste farouche, qui, debout sur un escarpement voisin, brandissait un gourdin énorme en dégorgeant un flot d’invectives du côté de Québec. Si la voix m’avait effrayé, l’apparition me rassura. Drapeau ne m’était pas inconnu.
« Drapeau le fou », comme nous l’appelions dans notre langage d’enfants.
Sans l’avoir jamais vu de près, j’avais plus d’une fois entendu de loin ses harangues nocturnes.
– Damnés Anglais !... criait-il d’une voix formidable. Nation d’assassins ! tirez, tirez vos canons !... Si le bon Dieu est juste, il finira bien par vous chasser d’ici... C’est le feu de Sodome et de Gomorrhe qui nous vengera de vous, infâmes voleurs de pays !... Ah ! parce que vous avez la poudre et les balles, vous triomphez ! Eh bien, je n’en ai pas peur, moi, de votre poudre et de vos balles... Pointez vos canons, armez vos fusils, sortez vos baïonnettes ! Sortez-les toutes, vos baïonnettes ! Je vous attends de pied ferme, moi, entendez-vous, misérables ?... Venez-y donc ! cent contre un, comme de coutume, lâches !... Vous n’osez pas ?... Cachez-vous donc alors, brigands, canailles, maudits !...
Et les vociférations du maniaque allaient se perdre, dans les échos de la nuit, parmi les aboiements qu’elles provoquaient de loin en loin, au fond des chantiers populeux et dans les fermes solitaires.
Longtemps le vieux jeta ses folles provocations à la face de l’ennemi imaginaire, sa voix allant toujours s’affaiblissant, jusqu’à ce qu’on n’entendît plus que des grondements inarticulés, entrecoupés de soupirs semblables à des sanglots.
Enfin, il se tut, resta quelques minutes absorbé dans je ne sais quelle rêverie tragique ; puis, après avoir promené un regard inquiet autour de lui, il s’enfonça lentement dans le fourré, hagard et fredonnant, sur un ton moitié triste moitié rageur, une étrange mélopée qui commençait par ces mots :
Allant à l’école,
J’eus grand’peur des loups,
Hou, hou, hou !
II
J’eus l’occasion de revoir Drapeau par la suite, et j’ai retenu les autres vers de ce chant bizarre, qu’il semblait affectionner tout particulièrement, et que je n’ai entendu chanter que par lui :
Allant à l’école,
J’eus grand’peur des loups,
Hou, hou, hou !
La jeunesse est folle,
Hou !
Berthe se désole, Seule au rendez-vous, Hou, hou, hou !
La jeunesse est folle, Hou !
Et les vieux sont fous !
L’oiseau bleu s’envole, J’entends le hibou,
Hou, hou, hou !
La jeunesse est folle,
Hou !
Et les vieux sont fous !
Qui rit sous le saule, Pleure sous les houx,
Hou, hou, hou !
La jeunesse est folle,
Hou !
Et les vieux sont fous !
À moi gaudriole, Truffes et vins doux,
Les atouts !
Ris, jeunesse folle,
Hou !
Et pleurez, vieux fous !
Ce Drapeau était un vieux détraqué à figure morose et renfrognée, qui passait sa vie à voyager entre Lévis et Montmagny – une distance d’une douzaine de lieues – un peu sauvage, généralement taciturne, acceptant une aumône par-ci par-là, sans domicile arrêté, sans moyens d’existence connus.
Malgré son air peu sympathique, il n’était pas malfaisant.
Il se montrait même serviable à l’occasion.
Et, comme tout le monde connaissait sa bonne nature, personne ne le molestait; chacun, au contraire, s’efforçait de lui rendre la vie aussi douce que possible.
Il voyageait un bissac sur le dos, courbé, pensif, l’air sombre.
Quand il avait faim, il s’asseyait au bord des routes, au coin des ponts, n’importe où, et cassait une croûte.
Le soir, il entrait chez les pauvres gens, et demandait à couvert.
L’hospitalité qu’on lui accordait volontiers, il la payait en sciant une voie de bois, en balayant le devant des portes, en faisant des commissions.
Mais il s’acquittait surtout, le soir, à la veillée, en chantant soit les couplets que j’ai cités plus haut, soit des lambeaux de complaintes plus ou moins lamentables.
Il chantait cela, comme s’il eût été seul, sur un ton et avec un accent qui impressionnaient singulièrement tous ceux qui l’entendaient.
Son regard vitreux se retournait alors pour ainsi dire en dedans, et le chanteur semblait mêler sa voix à quelque scène étrange, à quelque chose de dramatique qui se serait passé dans son intérieur.
Il risquait même quelquefois certains la ri don don assez croustillants, qu’il trouvait le moyen de rendre lugubres en traînant sa voix chevrotante à travers les mille fioritures d’agrément dont les campagnards aiment à enjoliver leurs couplets rustiques.
Ce qu’il entonnait avec un véritable entrain, par exemple, c’était ce vieux refrain des Ardennes, qui, comme tant d’autres chants populaires de France, s’est transmis parmi nous de père en fils, à travers nos trois siècles d’éloignement et de séparation :
À cheval, gens d’armes !
À pied, Bourguignons !
Montons en Champagne,
Les Anglais y sont !
Le fait est que sa principale manie – la seule véritablement désagréable qu’il eût d’ailleurs – c’était sa haine profonde des Anglais. Haine féroce, folle.
Un seul mot en langue anglaise le mettait hors de lui.
S’il rencontrait un Anglais sur sa route, il lui montrait le poing et le menaçait de sa canne en jurant.
À part cela, comme je l’ai fait entendre il y a un instant, pas la moindre méchanceté.
Un regard l’intimidait.
Cet homme avait une histoire.
III
Le grand-père de Drapeau – Jacques-Placide – était né à Saint-Michel-de-Bellechasse, d’une famille de colons établie dans le pays depuis les commencements de l’immigration française, et originaire de Fonteney-le-Comte, en Vendée.
Pendant la guerre de Sept Ans, il avait pris les armes comme tout le monde, et combattu vaillamment pour la suprématie de la France dans le nouveau monde.
Deux ans il avait grignoté la ration de pain noir qu’on distribuait aux meurt-de-faim qui composaient la garnison de Québec.
Il avait vu de loin la fumée des campagnes incendiées.
Et, blessé sur le champ de bataille d’Abraham, il avait pu suivre des yeux les troupes anglaises entrant dans la ville derrière « monsieur le marquis » mourant.
Le soldat était retourné dans ses foyers, la fureur dans l’âme, et n’ayant qu’un espoir au cœur, celui de la revanche.
La France vaincue, le pays au pouvoir de l’ennemi, cela lui faisait l’effet d’un cauchemar ; et dans les cercles du village, aux veillées de la chaumière, le pauvre invalide s’efforçait de ranimer le courage de ses compatriotes en leur parlant toujours de ces secours de France qui devaient infailliblement nous rendre la victoire, mais qui n’arrivaient jamais.
Montréal avait capitulé.
Lévis, après avoir brûlé ses drapeaux dans l’île de Sainte-Hélène, s’était rembarqué pour la France.
Les semaines, les mois, les années même s’écoulèrent.
Et l’on espérait toujours dans l’angoisse et la détresse...
Enfin – au lieu de la flotte libératrice si longtemps attendue – une nouvelle terrifiante, incroyable, arriva :
Louis XV avait cédé le Canada aux Anglais !
Ce fut d’abord un haussement d’épaules général.
La France accepter sa défaite !
Tout un peuple livré comme une marchandise ! Le Canada aux Anglais, allons donc !
La chose était tellement invraisemblable, qu’on refusa obstinément d’y croire, jusqu’au jour où, du haut de toutes les chaires du pays, les ministres de la religion durent officiellement annoncer l’événement et prêcher la soumission au nouveau régime.
Ce fut un cri de protestation universelle.
– Jamais ! jamais ! s’écriait-on ; jamais nous ne serons des Anglais. Nous mourrons français. Vive la France !...
Drapeau, lui, pleurait de rage, et se rongeait les poings.
Devant l’attitude menaçante des populations, le clergé – qui craignait sans doute pour nous le sort des malheureux Acadiens – redoubla d’efforts pour engager le peuple des campagnes à accepter, comme celui des villes, un ordre de choses imposé par la force, et contre lequel toute résistance était inutile.
– C’est maintenant le pouvoir établi, mes frères, disait chaque pasteur dans son prône du dimanche ; c’est l’autorité légitime : Dieu vous commande de vous soumettre et d’obéir.
C’était là la thèse que développait le curé de Saint-Michel-de-Bellechasse, dans son sermon du 13 juillet 1763, lorsqu’un homme se leva dans la nef et interrompit violemment le prédicateur.
C’était le soldat Drapeau.
– Monsieur le curé, dit-il, voilà assez longtemps que vous prêchez pour les Anglais, prêchez donc un peu pour le bon Dieu maintenant !
Cette algarade fit scandale, comme on le pense bien; et son résultat, grâce à la gravité exceptionnelle des circonstances, fut déplorable.
Deux paroisses – Saint-Michel et Saint-Valliers – qui avaient pris fait et cause contre leur curé commun, furent excommuniées en bloc par Mgr Briand, alors évêque de Québec.
La révolte dura des années; et l’on montre encore l’endroit proface où furent inhumés, sans les prières de l’Église, cinq des rebelles – trois hommes et deux femmes – qui ne voulurent jamais faire leur soumission.
Ces naïfs croyants renoncèrent à leur salut éternel pour rester fidèles à la France.
Je respecte l’arrêt qui les frappa, sans doute.
Mais lorsque le hasard me met sur cette route, Sans demander à Dieu si j’ai tort en cela, Je découvre mon front devant ces tombes-là !
Quant à Drapeau, il était sorti de l’église en chantant à tue-tête :
À cheval, gens d’armes ! À pied, Bourguignons ! Montons en Champagne, Les Anglais y sont !
Le malheureux était devenu fou.
IV
Il avait un fils, – Pierre.
Celui-ci hérita de la terre paternelle, se maria et devint père de famille à son tour.
C’était un homme paisible et industrieux.
Il prospérait.
Mais, l’imagination montée par les divagations patriotiques de son père, il s’entretenait volontairement dans un état d’exaltation maladive qui devait, lui aussi, le mener à mal.
Il ne pouvait pas se faire à l’idée que le pouvoir de l’Angleterre, chez nous, fût permanent.
Il rêvait sans cesse je ne sais quel revirement, révolte ou contre-conquête qui chasserait l’étranger du pays et ramènerait sur nos bords la France victorieuse.
Quand il allait vendre ses denrées à Québec, il revenait toujours au comble de l’exaspération.
– Maudits Anglais ! grommelait-il ; il y en a plein les rues. Des guérites à toutes les portes ! Des baïonnettes dans tous les coins ! Toujours quelques frégates qui débarquent des canons. On n’est plus maître chez soi !... Québec n’est plus qu’une fourmillière de goddems. Est-ce qu’on ne fera pas sauter cette vermine ?... Ah ! si le Bonaparte pouvait donc venir !...
Napoléon alors commandait à l’Europe et faisait trembler le monde.
Les bulletins de l’immortelle légende arrivaient jusqu’à nous ; et, malgré tous les efforts des intéressés pour en atténuer l’éclat, ces interminables échos de victoires exaltaient les esprits et ranimaient l’espoir dans les coeurs toujours dévoués au souvenir de la France.
La France toute-puissante, c’était le salut, c’était la délivrance prochaine.
Les vieux Canadiens pleuraient rien que d’y penser, et murmuraient comme Crémazie plus tard :
Napoléon, rassassié de gloire,
Oublierait-il nos malheurs et nos voeux,
Lui dont le nom, soleil de la victoire,
Sur l’univers se lève radieux ?
Serions-nous seuls privés de la lumière
Qu’il verse à flots aux plus lointains climats ? Oh ! ciel, qu’entends-je ? une salve guerrière !... – Dis-moi, mon fils, ne paraissent-ils pas ?
Les jeunes patriotes, eux, soupiraient après le jour où ils pourraient sortir de sa cachette le fusil rouillé de leurs pères, pour recommencer, sans merci, la lutte éternelle et légendaire.
Un jour – en 1815 – Drapeau fils mettait le pied sur le marché de Québec avec un plein chargement de produits de la plus belle venue, – et tout joyeux.
La nouvelle était arrivée que l’empereur, échappé de l’île d’Elbe, venait de rentrer triomphalement à Paris.
Les Bourbons étaient en fuite.
L’Angleterre n’avait qu’à bien se tenir cette fois !
Enfin, les « maudits habits-rouges » allaient donc faire demi-tour !...
Drapeau les voyait déjà prendre leurs cliques et leurs claques, et plier bagage sans demander leur reste.
Pauvres gens, après tout !
Il les plaignait déjà, et se sentait presque disposé à leur pardonner... Tout à coup :
Boum !...
Un coup de canon.
Puis deux.
Puis trois.
Puis quatre.
Enfin, vingt et un !
– Qu’est-ce donc ?
– Vous ne savez pas ?
– Non.
– C’est un bâtiment qui est entré dans le port ce matin, avec une grosse nouvelle, à ce qu’on dit.
– Vrai ? Qu’est-ce que ça peut bien être ?
– Sais pas.
– Eh ! vous autres, là-bas, savez-vous ?
– Quoi ?
– La nouvelle.
– Quelle nouvelle ?
– La grande nouvelle de ce matin, parbleu !
– Je la connais, moi, fait une vieille revendeuse ; on vient de la crier partout à la haute ville.
– De quoi s’agit-il donc ?
– On dit que le Bonaparte a été battu.
– C’est pas vrai !...
– Dame... c’est difficile à croire.
– Ce n’est malheureusement que trop vrai, fit un nouvel arrivé. Napoléon a été vaincu par le général Wellington. L’armée française a été écrasée à Waterloo, près de Bruxelles en Brabant. Les Anglais, les Russes et les Prussiens marchent sur Paris avec les Autrichiens.
Il prononçait probablement les autres chiens.
En ce moment une fanfare retentissait au loin avec des roulements de tambour.
Et la musique d’un régiment lança solennellement aux échos de la vieille ville française les premières notes du God save the King !
Cette nuit-là même – à une heure du matin – après avoir mis son cheval au râtelier, Pierre Drapeau rentrait chez lui, pleurant à sanglots et chantant d’une voix terriblement sinistre :
À cheval, gens d’armes !
À pied, Bourguignons !
Montons en Champagne,
Les Anglais y sont !...
Sa femme et ses enfants constatèrent avec désespoir que le pauvre homme avait perdu la raison à son tour.
V
Un malheur ne vient jamais seul, dit-on.
À celui-ci succéda toute une série de fatalités.
Une grange brûlée, une récolte entière perdue, l’épidémie sur les bestiaux ; enfin, les hypothèques, les huissiers, la ruine.
Drapeau mourut dans la misère ; et son fils Charles – celui qui nous occupe en ce moment – dut quitter la paroisse natale, le sac au dos, pour aller gagner son existence dans les chantiers.
Il vivota d’abord tant bien que mal, l’hiver dans les forêts de l’Ottawa, le printemps sur les trains de bois charriés par le fleuve, l’été dans les anses de la Pointe-Lévis, la gaffe du flotteur ou la hache de l’équarisseur à la main.
C’était une rude vie, mais qui ne lui aurait pas été trop dure, cependant, s’il n’eût été forcé de travailler pour des Anglais.
Cela révoltait sa vieille rancune de race.
Tout ce bois – ces beaux ormes, ces grands chênes, ces pins magnifiques – qu’il voyait charger sur les navires d’Angleterre, cela lui semblait un vol odieux commis au détriment de son pays.
Ce travail au profit de l’ennemi lui faisait l’effet d’une abdication, et lui pesait comme un esclavage.
Le salaire même qu’il recevait pour son labeur de chaque jour lui brûlait les doigts comme le prix d’une trahison.
Or, 1837 approchait.
Le nom de Papineau sonnait de bouche en bouche, et d’un bout à l’autre du pays le vaillant et incorruptible tribun était acclamé comme un futur libérateur.
Les insolentes prétentions de l’oligarchie autoritaire poussaient le peuple à la résistance.
Le vieux levain d’indépendance fermentait.
De tous côtés, l’on entendait sourdre les premières rumeurs d’une révolte qui ne devait s’éteindre, hélas ! que dans le sang des échafauds.
Comme on le pense bien, Drapeau ne fut pas le dernier à fourbir ses armes.
Après l’assemblée des Cinq comtés, trouvant que le district de Québec n’entrait pas assez vite dans la voie de l’insurrection, et l’esprit chauffé à blanc par les nouvelles plus ou moins authentiques qui arrivaient du sud et du nord de Montréal, il boucla son havresac, décrocha le fusil du grand-père, et partit pour Sorel et les paroisses de la rivière Chambly, en chantant :
À cheval, gens d’armes !
À pied, Bourguignons !
Montons en Champagne,
Les Anglais y sont !...
Où alla-t-il ?
Que fit-il ?
Prit-il part aux combats de Saint-Denis et de Saint-Charles ? Alla-t-il rejoindre Chénier à Saint-Eustache ? Personne ne l’a jamais su.
Seulement, Philippe Pacaud, qui s'était battu à Saint-Denis à côté de Nelson, me disait un jour, en parlant de cette mémorable journée :
- Il y avait là un nommé Drapeau qui nous donna le frisson par sa soif de massacre. Nous n'avions plus ni poudre ni balles : je le vis, dans l'espace de dix minutes, crever et fracasser le crâne à trois soldats anglais avec la crosse de son fusil ! « Point de prisonniers ! criait-il ; tue ! tue ! »
Était-ce le Drapeau que j'ai connu ?
En tout cas, quand ce dernier reparut à Lévis, les cheveux lui avaient blanchi, et il était devenu fou comme son père et son grand-père.
VI
À dater de ce moment, l'histoire du vieux patriote se résume en bien peu de choses.
Il menait, comme je l'ai dit plus haut, une vie nomade, et ne se faisait remarquer que par sa haine héréditaire pour les maîtres du pays. C'était là le trait caractéristique de sa folie.
Tous les soirs - du moins quand il était à Lévis - on le voyait gravir une des grandes côtes, à la brume.
Puis, l'instant d'après, sur une des saillies à pic qui font face au rocher de Québec, sa haute silhouette apparaissait immobile et debout, se profilant en noir sur les tons fauves du couchant.
Il restait là longtemps, longtemps, attendant l'heure. Puis, aussitôt que le canon réglementaire avait lancé son coup de foudre, on entendait les imprécations du malheureux retentir au loin dans la nuit - toujours les mêmes.
Les gamins le suivaient quelquefois en riant, mais ne l'injuriaient jamais, - ainsi qu'ils en contractent trop souvent l'habitude à l'endroit des pauvres êtres privés de raison.
Cette folie, dont la source était si touchante après tout, semblait inspirer, même à cet âge sans pitié, une commisération involontaire et presque attendrie.
La voix terrible de l’aliéné et les gestes effrayants dont il soulignait sa farouche éloquence n’étaient-ils pas pour quelque chose dans cette attitude respectueuse de la jeunesse à son égard ?
Peut-être aussi.
En tout cas, lorsque après avoir épuisé son chapelet de malédictions à l’adresse du conquérant éternellement détesté, Charles Drapeau reprenait sa route en murmurant :
Allant à l’école,
J’eus grand’peur des loups,
ceux qui avaient assisté de près à la scène secouaient avec peine l’étrange impression qui leur en restait.
Pauvre Drapeau, il dort aujourd’hui son dernier somme dans le vieux cimetière de Saint-Michel-de-Bellechasse, côte à côte avec ses pères, attendant comme eux et avec eux la miséricorde de Celui qui pardonne à ceux qui ont beaucoup aimé.
Quand le prêtre – à ce que rapportent ceux qui virent le malheureux à ses derniers moments – essaya de faire jaillir une suprême lueur de raison de ce cerveau depuis si longtemps éteint, il ne put obtenir du mourant d’autres paroles que les syllabes du vieux refrain des Ardennes, vaguement balbutiées à travers les hoquets de l’agonie :
À cheval, gens d’armes !
À pied, Bourguignons !
Montons en Champagne,
Les Anglais y sont !...
IV. Chouinard
I
En ce temps-là – je parle de 1848, pas d’hier, comme vous voyez – l’église de Saint-Joseph de la Pointe-Lévis possédait, entre autres ornements, un chantre du nom de Picard.
Je mets Picard parmi les ornements, non pas qu’il fût beau – ô mon Dieu, non ! – mais parce qu’il y avait en lui quelque chose de monumental.
Sa voix d’abord, dont les éclats de trompette faisaient tinter les grands vitraux de l’église.
Et puis son nez.
Picard avait de grandes jambes, de grands pieds, de grandes mains, de grands yeux, de grandes dents, un grand cou.
Quant à son nez, il n’était pas grand.
Il était monstrueux.
Je me dispenserai de le décrire, car il n’apparaît qu’incidentellement dans mon récit.
Qu’il me suffise de rapporter les paroles dont le vicaire, M. l’abbé Jean, se servait pour en donner une idée :
– Quand Picard entre au choeur, disait-il, ce n’est pas un homme avec un nez, c’est un nez avec un homme !
Or, un beau dimanche – à vêpres – Picard chantait au lutrin ; il « faisait chantre », pour me servir d’une expression aussi baroque que consacrée. Je m’en souviens comme si c’était hier.
Le temps était délicieux – un temps écho, comme disent les Canadiens, pour indiquer la sonorité de l’atmosphère.
Le chant des psaumes roulait majestueux sous la grande voûte, et, par les fenêtres ouvertes, s’épandait au dehors en larges ondes vibrantes.
À un moment donné, dans l’intervalle d’un psaume à l’autre, ce fut au tour de Picard à entonner l’antienne.
Le long chantre mouche hâtivement son long appendice, se lève, ou plutôt se déplie avec solennité, tousse un peu pour s’astiquer le larynz, et puis lance, de sa voix de stentor et sur un diapason triomphant, ces quatre syllabes suggestives.
– Serve bone.
Beau nez !
Le calembour s’imposait à l’esprit le plus sérieux, et ne pouvait manquer de faire sourire.
Il fit plus.
La dernière note de l’intonation s’éteignait à peine, et le choeur n’avait pas encore eu le temps de reprendre la continuation de l’antienne, qu’une autre voix tout aussi retentissante que la première éclata dans le bas de l’église :
– Hourra pour Picard !
On voit d’ici le scandale : brouhaha extraordinaire, toutes les têtes tournées, fou rire partout.
Quel était l’individu assez irrévérencieux pour oser troubler l’office divin par une farce de ce calibre ?
On le sut bientôt.
Du reste, la voix n’était pas inconnue.
Elle appartenait à un pauvre innocent de bon garçon qui fut, durant des années, universellement connu dans toutes les campagnes échelonnées sur la rive sud du Saint-Laurent, depuis Québec jusqu’à Gaspé. Ce n’était pas une farce qu’il avait voulu faire. Oh non !
L’exclamation intempestive lui avait échappé.
Son esprit jovial, frappé soudainement par le comique de la situation, n’avait pas eu le temps de réfléchir ; et c’est on ne peut plus involontairement que le pauvre diable avait troublé le recueillement des fidèles par sa sortie burlesque.
Du reste, on lui aurait pardonné bien autre chose, à ce brave Chouinard. Car il s’appelait Chouinard.
Olivier, de son prénom, – qu’il prononçait Livier.
C’était sa manière de dire moi, car il parlait toujours de lui-même à la troisième personne.
II
Bien qu'appartenant à la classe des pauvres diables, Chouinard n'était pas précisément un mendiant, car il ne mendiait pas.
Il se contentait d'accepter l'hospitalité qu'on lui offrait sur la route.
Et comme il passa toute sa vie à faire la navette entre Québec et Gaspé, et que cette hospitalité ne lui faisait jamais défaut, il n'eut jamais besoin d'autre domicile.
Quand au reste, ses goûts n'étaient rien moins que luxueux, et, son ambition se bornant à peu de chose, il se tirait parfaitement d'affaires, et ne manquait jamais de rien.
Était-il suivi par un bon ange chargé de glisser chaque jour dans sa poche les cinq sous du Juif-Errant?
Non pas.
Ses cinq sous, il les gagnait bel et bien.
Et jamais peut-être millions n'ont été mieux ni plus honnêtement gagnés. Les lois de l'État s'en trouvaient bien quelque peu enfreintes.
Le ministère des Postes aurait peut-être pu le poursuivre en contravention.
Mais la pécadille n'en valait pas la peine; et tant pis pour qui aurait voulu molester l'ami Chouinard, car il était populaire. Voici en quoi consistait sa petite industrie.
Il s'était constitué courrier privé et indépendant.
Et pour six sous – cinq cents, ce qui était dans le temps le port d'une lettre à la poste – il portait à pied cette lettre à Kamouraska, à Rimouski, au Bic, à Matane, et, naturellement, à n'importe quel point intermédiaire, la livrant en mains propres ou à domicile, sans jamais exiger d'autre rénumération.
S'il avait dix, vingt, trente lettres, tant mieux.
S'il n'en avait qu'une, il faisait le voyage tout de même, et avec une rapidité... Ses courses étaient quelques fois étonnantes.
Nul froid, nulle tempête, nuls chemins effondrés ne l'arrêtaient.
Pendant quelqu'une de ces terribles journées d'hiver, où les voyageurs les plus hardis osent à peine s'aventurer sur la route enveloppés dans leurs habits de fourrure et les peaux d'ours de leurs traînaux, on entendait parfois un son de trompe éclater au loin, puis on voyait déboucher à l'entrée du village un piéton maigrement vêtu, une casquette en peau de chat sur les yeux, blanc de givre, enfonçant jusqu'aux genoux dans la neige mouvante, les doigts à demi gelés sur un cornet à bouquin, le dos courbé, luttant ferme contre la « poudrerie » qui lui cinglait la figure, et jetant à toutes les portes sa fanfare dans la bourrasque.
C'était Chouinard.
À la brume, il entrait - n'importe où.
Chez le riche comme chez le pauvre.
Avec cette différence que dans les maisons un peu cossues, il se présentait à la porte de service.
On ne le rebutait nulle part.
Haletant, geignant, épuisé, il secouait dans le tambour la neige dont il était couvert, essuyait ses bottes glacées au paillasson, faisait son entrée en souriant, détachait les glaçons de sa barbe et de ses cheveux incultes, s'approchait du poêle - les calorifères étaient alors inconnus dans ces parages - grelottait quelques instants, les mains dans le « fourneau », puis jetant un long regard autour de lui avec une expression de contentement naïf, il lâchait un gros rire enfantin, hi hi hi!... puis il ajoutait :
- Mauvais temps.
- Tiens, c'est ce brave Chouinard! disait-on. Quel bon vent t'amène? - Bon vent, mais mauvais côté, hi hi hi!...
- D'où viens-tu comme ça?
- Québec.
- Et où vas-tu?
- Rivière-du-Loup.
- Porter une lettre?
- Te cré !
- À qui donc?
- M. Pouliot.
- Montre voir.
- Tiens... Non, pas celle-là! M. Verreau, celle-là, Saint-Jean-Port-Joli.
Ou M. Dupuis, Saint-Roch-des-Aulnaies.
Ou quelque autre encore.
On lui faisait généralement ces questions non par pure curiosité, mais pour mettre son étrange mémoire à l'épreuve.
Il avait souvent quinze, vingt lettres dans son sac.
Or il ne savait pas lire, et jamais il ne se trompait dans la distribution. Pas une erreur!
Une lettre qui lui était une fois confiée arrivait droit à son adresse, avec autant de sûreté – et même plus – que si elle eût été mise entre les mains du ministre des Postes lui-même.
Un chef de bureau reçoit une lettre, lit l'adresse, et se trompe quelques fois de case.
Chouinard, lui, ne s'en rapportait qu'à l'apparence extérieure de l'enveloppe, mais son coup d'oeil était infaillible.
On ne l'a jamais pris en défaut.
III
Étant donné ce qui précède, Chouinard ne pouvait manquer d'être un favori au collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, dont la masse des élèves avaient leurs parents disséminés sur l'itinéraire habituel de l'extraordinaire courrier.
Son arrivée était une fête.
Grâce à sa prodigieuse mémoire, Chouinard connaissait – il s'en informait naturellement avec le plus grand soin – toutes les familles qui avaient un fils ou deux au collège de Sainte-Anne, et, au point de vue de la clientèle, il n'avait garde de négliger ce détail.
Il s'arrêtait au collège d'abord.
C'était une station de rigueur.
Puis il se rendait chez les parents, et donnait des nouvelles du « petit ». Il était naturellement le bienvenu. On l'entourait: – Vous l'avez vu, ce cher enfant?
– Comment est-il?
– S'ennuie-t-il beaucoup?
– A-t-il grandi? etc.
Livier savait tout et répondait à tout.
La famille était enchantée – la maman surtout – et chacun s'évertuait à faire plaisir à Chouinard.
On le choyait, on le dorlotait, on le gavait de friandises.
Sans compter qu'il repartait toujours, cela va sans dire, avec une lettre et quelque petit paquet pour le retour.
La lettre ne pouvait arriver à destination que longtemps après le passage du courrier ordinaire.
On le savait ; mais qu'importe!
Avez-vous remarqué comme une lettre d'ami ou de parent vous fait plus de plaisir à recevoir quand elle vous est remise par une main qui a touché celle qui l'envoie?
C'est à ce sentiment qu'obéissaient d'instinct, il n'y a encore que quelques années, les Québecquois qui vous disaient :
– Mon cher, vous partez pour Montréal, veuillez donc vous charger de cette lettre.
Cette lettre vous coûtait d'ennui, d'embarras et même d'argent, cent fois les trois sous que ce monsieur aurait payé en mettant simplement son envoi à la poste; mais il ne réfléchissait pas à cela.
Il espérait que sa lettre serait remise personnellement; et cela doublait, par l'imagination, la satisfaction qu'il avait eue de l'écrire. Et celui qui recevait la lettre donc!
– Vraiment, c'est lui-même qui vous a confié ceci? Vous l'avez vu? Vous lui avez parlé? Comment est-il? Que chante-t-il de bon? etc.
– Vous avez vu mon père avant de partir! me disait un jour, toute tremblante d'émotion, une bonne religieuse canadienne que je retrouvais à Blois, en France. J'ai presque envie de vous embrasser.
Elle recevait des lettres de sa famille toutes les semaines, cependant. Mais quelqu'un qui avait vu son père, qui lui avait parlé, qui lui avait serré la main, ce n'était pas la même chose!
Avec cela qu'en confiant une lettre à Chouinard, on faisait une charité déguisée, – et personne n'ignore que c'est la plus agréable à faire après tout.
IV
Imaginez maintenant quelle réception nous faisions à l’ami Olivier, lorsque, par un de ces ennuyeux congés d’hiver, comme un oiseau voyageur tombant des nues, il arrivait au collège, et venait s’ébattre au milieu de nos groupes attristés, à Sainte-Anne, sur cette plage morne où l’on a d’un côté une montagne revêche qui vous bouche l’horizon, et de l’autre une plaine sans fin, plate et froide, qui vous l’escamote.
– Voilà Chouinard !
– Bonjour, Chouinard !
– Hourrah !
– Vivat !
– Ohé !
Et nous nous précipitions autour du pauvre garçon, qui ne savait bientôt plus où donner de la tête.
Tout le monde parlait à la fois :
– Des lettres ?
– Une pour moi !
– Pour moi !
– Pour moi !
– Vite donc, Livier ! vite donc !
Chacun se dressait sur le bout des pieds, trépignant d’impatience. La poste ordinaire ne comptait plus.
Nous aurions eu dans nos poches des lettres bien postérieures à celles qu’il nous apportait : elles ne valaient plus rien.
– Oui, oui, oui ! criait le bon diable tout essoufflé, et se défendant de son mieux contre les assauts de tous ces diablotins. Attendez donc !... hi hi hi...
Puis il grimpait sur un banc, et commençait la distribution. – Quins, ‘tit Pite, pour toi !
– Hourra ! merci, Chouinard !
– Quins, Couillard, lettre Saint-Thomas !
– Quins, Bernier, lettre du Cap... hi hi hi !
– Merci, Livier !
– Quins, Bacon ! quins, Gagnier ! quins, Arsène ! lettres vous autres... – Merci, merci, merci !
– Hourra !...
– Tu as passé chez nous ?
– Te cré !
– Comment vont-ils à la maison ?
– Père acheté beau cheval !
– Et chez nous ?
– Chu vous ? Soeur robe neuve neuve... Belle ! belle ! – Ah ! ah ! ah !...
– Tu connais ça, Livier ?
– Te cré !...
– Hourra !...
– Et chez nous !
– Mère mal aux dents.
– Et chez nous ?
– Fait boucherie, semaine passée ; bon boudin, va ! Livier goûté... hi hi hi !...
– Et chez nous, Livier ?
– Fait baptiser dimanche. Beau ‘tit frère...
– Bravo !
– Vive Chouinard !
– Hourra pour Livier !
– La bascule !
– La bascule !...
Ce qu’on appelait la bascule au collège de Sainte-Anne était une espèce d’ovation peu réjouissante à laquelle on soumettait les camarades qui, d’une façon ou d’une autre, avaient su provoquer quelque enthousiasme.
La cérémonie était simple et primitive.
Elle rappelait un peu le pavois des anciens Gaulois.
Aussitôt qu’on avait lâché le mot Bascule ! les plus rapprochés saisissaient le triomphateur – la victime, si vous aimez mieux – qui par un bras, qui par une jambe, qui par le collet, qui par le ceinturon. Et puis, ho !...
Un élan le hissait sur les têtes, où dix, vingt, trente poignets solides le maintenaient en équilibre, pendant qu’on lui faisait faire le tour de la salle en procession, au milieu d’une tempête de rires, de chants et d’acclamations.
Si vous aviez été longtemps absent, si vous aviez fait quelque action d’éclat, ou si c’était l’anniversaire de votre naissance, ça y était !
– La bascule, ho !
Le système des compensations.
On s’en tirait tant bien que mal ; comme on pouvait.
Un peu étourdi, un peu moulu, et surtout bien chiffonné ; mais en général sans avaries sérieuses – au moins à la peau.
Chouinard faisait bien quelques résistances d’abord, mais pour la forme seulement.
Il était habitué.
Avec son dîner à la cuisine, et le petit tour de chapeau qui se faisait entre nous à son bénéfice, la bascule était de rigueur à chacune de ses visites.
Il en prenait gaiement son parti, et se laissait trimbaler de bonne grâce. – Bande scérélats ! disait-il seulement, en feignant de se fâcher.
V
On a remarqué que notre héros avait l’habitude – comme presque tous les innocents, du reste – de s’exprimer dans une espèce de langage télégraphique, c’est-à-dire en supprimant les petits mots – articles et prépositions, par exemple – peu nécessaires au sens de la phrase.
Il avait en outre un certain défaut d’articulation ou d’oreille qui lui faisait commettre toutes sortes de contrepetteries.
Scélérats, disait-il; p’tits maruleux; êtes pires que des loups-ragous. Ferez rien que des vérolutionnaires !
Savez-vous comme il appelait le Drapeau de Carillon ? – Le Drayon de Caripeau.
Quant aux autres expressions qu’il défigurait plus ou moins, elles étaient innombrables.
Pour lui le pain killer se prononçait « pain de couleuvre ».
La corne de cerf se changeait en « gomme de saffre ».
Un typographe se transformait en « p’tit pot d’grès ».
Une maison de correction devenait une maison de « corruption ». Du lemon syrup était pour lui du « limon de salope ». Il n’aimait pas à se mettre des chimaigres dans la tête. Il priait pour la « conversation » des pécheurs, etc.
– Eh bien, Chouinard, lui demandais-je un jour, chez qui as-tu couché, à la Rivière-Ouelle ?
– George Lévesque.
– Que fait-il de bon de ce temps-ci, George Lévesque ? – Pustule toujours.
Il voulait dire « spéculer ».
– As-tu bien fait ma commission, Livier ? lui demande une bonne femme de l’Islet, qui avait envoyé un sac de noisettes à son petit garçon, au collège.
– Te cré !... Mais pas gardé longtemps, va !
– Comment donc ça ?
– Eh ben, mangé la classe, mangé l’étude, mangé la « création »... constupé tout de suite.
Les noisettes avaient été confisquées, voilà tout.
Un jour, il racontait que le curé de Saint-Alexandre était allé à Québec pour se faire ôter une « cathédrale » dans l’œil.
La cataracte probablement.
Une autre fois, il demandait au docteur Guay, de Lévis, s’il avait des pilunes pour le ver Saint-Hilaire.
Le docteur supposa qu’il voulait parler du ver solitaire. Et ainsi de suite, à n’en plus finir.
Les résipères, les maladies de longueur, les enflammations de père Antoine, les enfants morts de conclusions, les vieux morts aux tropiques, les actes de contorsion, les rumeurs dans le ventre qui pourraient bien se changer en concerts, tout cela ne comptait pas.
C’était pour lui l’alphabet du genre.
Il faudrait un miracle de mémoire pour se rappeler la vingtième partie des coq-à-l’âne et des transfigurations de mots dont il émaillait sa conversation.
Mais revenons au collège.
La cérémonie de la bascule terminée, ce n’était pas tout.
– Maintenant, Chouinard, lui disions-nous, tu vas nous chanter quelque chose, n’est-ce pas ?
– Livier fatigué.
– Eh bien, prie le bon Dieu alors, tu chanteras après.
VI
Il faut vous dire que l’ami Olivier avait une manière à lui de prier le bon Dieu.
Mais une manière à lui !
Impossible de rêver pareil salmigondis de latin et de français mélangé à la diable, sans queue ni tête, ni sens ni logique.
Toutes les expressions du catéchisme et du rituel s’y rencontraient, s’y heurtaient dans un pêle-mêle sans nom et dans les combinaisons les plus imprévues.
Voici un échantillon de son savoir-faire sur ce point :
« Pater noster purgatoire credo in Deum l’ordre et le mariage sans exagération ni excuses, nostris infunde, péché mortel, péché véniel, christum robiscum, pauvre homme. – Ainsi soit-il !
»
Il excellait surtout à remplacer les mots latins par je ne sais quel français incohérent qu’il trouvait moyen d’extraire des phrases latines mal prononcées.
J’ai écouté prier bien des vieilles.
J’ai entendu des chantres d’une force rare.
Je n’ai jamais rien vu qui, sous ce rapport, pût être comparé à Chouinard.
Ses prières n’étaient souvent qu’une suite d’à peu près à dérouter le calembouriste le plus ingénieux des deux mondes.
Ne parlons pas de « P’tit Jésus dans la cheminée, rince l’écuelle » ; ou du « pied d’Jésus envenimé, dans la huche la cuillère », dona eis requiem. C’était là pour notre ami le premier mot du rudiment.
Il avait perfectionné tout cela à un point dont on se fera une idée quand on saura que sa Salutation angélique commençait par : Nagez, Maria, et finissait par : « La p’tite Laure à Narcisse et la grosse Philomène », et in hora mortis nostrae, amen.
Il puisait dans la messe, dans les vêpres, dans l’angélus, dans le bénédicité, partout.
Il traduisait : Et renovabit par « le traîneau va vite ». A porta inferi, par : « apportez la ferrée ».
Sedes sapientiae, par : « ses treize sapins sciés ». Mors stupebit, par : « marches-tu, bibitte » !
Benedictatu, par : « l’bom’ Baptiste Têtu ».
Vas spirituale, par : « va oùs’ tu pourras aller ».
Adjuvandum, par : « belle jument d’homme ».
C’est de lui cette traduction rajeunie par Berthelot : Mites fac et castos, « mitaines faites de castor ».
Il fallait le voir, dans le Confiteor, se frapper la poitrine en disant avec componction
:
– Racule pas ! Racule pas ! voyons, Maxime, racule pas !
Il se faisait alors dans le comté de Kamouraska – division électorale où se trouve le collège de Sainte-Anne – une lutte politique qui est restée légendaire entre Letellier de Saint-Just, depuis lieutenant-gouverneur pour la province de Québec, et Chapais, qui mourut ministre des Travaux publics au cabinet fédéral.
– Pour qui es-tu, toi, Livier ? lui demandions-nous. Es-tu rouge ? es-tu bleu ?
Il répondait invariablement :
– Livier pour zitanies. Crie pas hourra pour Tellier ni Chapais. Crie : Hourra pour Nobis.
Mais nulle part ailleurs que dans le Pater son talent de traducteur ne brillait avec autant d’éclat.
C’était un vrai tour de force.
Qui es in coelis devenait « qui est-ce qui sait lire ».
Sanctificetur nomen tuum, « son p’tit-fils Arthur ramène-ty l’homme ». Sicut in coelo et in terra, « si tu t’salis, salaud, tu t’néterrras ».
Et ainsi sans broncher jusqu’à Sed libera nos a malo, qui devenait, en passant par je ne sais quelle filière : « de Saint-Morissette à Saint-Malo ».
VII
Va sans dire que toute cette phraséologie burlesque se retrouvait aussi bien dans son chant que dans ses prières.
Car Chouinard chantait – je l’ai déjà laissé entendre – et avec une voix assez passable, ma foi.
– Allons, lui disions-nous, sitôt la kyrielle de prières défilée jusqu’au bout, chante-nous quelque chose maintenant.
– Livier ben fatigué.
– N’importe !
– Eh ben, Livier va chanter chanson major Jean Doguier, bataille Vous-salue-Marie.
Cela voulait dire : La chanson du major de Salaberry à la bataille de Châteauguay.
Et il entonnait à tue-tête :
Papineau, ce bon père,
Disait à ses enfants:
Nous gagn’rons la bataille Si vous êtes pas peureux.
On voit que le brave Livier n’était guère plus fort sur la rime que sur l’histoire.
Puis venaient les cantiques.
Un surtout dont le refrain nous amusait toujours beaucoup :
C’est la sain sain sain,
C’est la te te te,
C’est la sain,
C’est la te,
C’est la sainte Vierge,
Qu’allume les cierges !
Il y avait aussi le cantique d’Adam, qui nous intéressait fort :
Adam, Adam, sors de ce bois,
Dis-moi pourquoi que tu chesses (sèches),
Dis-moi pourquoi et quelle est la saison
De ta trahison !
Cela rimait... comme la chanson de Papineau, à temps perdu. Mais le plus défiguré, c’était le cantique du Jugement dernier. Tout le monde connaît le refrain à grand effet :
J’entends la trompette effrayante
Qui crie : O morts, levez-vous !
Voici comment Chouinard le chantait :
J’attends la tempête effrayante,
P’tit christ, gros homards, rêvez-vous ?
Il nous chantait aussi ce qu’il appelait la messe des vieilles filles :
Kyrie,
J’veux m’marier; Eleison,
La grain’ me sonne !
Et cela continuait ainsi : le Gloria, le Credo, la Préface, le Sanctus, et l’Agnus Dei, tout y passait.
Une des choses qui le portaient à modifier les textes – on pourrait dire à massacrer les mots – c’était son scrupule à l’endroit de tout ce qui pouvait ressembler de près ou de loin à un juron.
La moindre interjection un peu vive l’effrayait.
Toute consonance trop crue répugnait à sa délicatesse, et il l’évitait avec soin. Ou bien il l’adoucissait de son mieux à l’aide d’une variante, en passant une consonne au rabot, en glissant l’huile d’une cédille habilement introduite sous l’ossature d’une syllabe un peu raide.
Par exemple, vous ne l’auriez jamais fait dire : tomber sur... la dix-septième lettre de l’alphabet.
Il tournait la difficulté en disant : tomber sur le sud. Il n’osait seulement pas prononcer le mot « queue ». Il disait le manche d’un chien.
Tout au plus hasardait-il la tieue du chat, mais dans l’intimité seulement, quand il se permettait une légère incursion sur le domaine de la familiarité. Il avait même des scrupules à prononcer le mot mort. Un jour, le curé de la Rivière-Ouelle lui demandait :
– Est-ce que M. Dionne ne t’a pas donné un petit cochon de lait pour moi ?
Chouinard répondit :
– Vot’ petit cochon, monsieur le curé, il est devant le bon Dieu !
Dans ses chants surtout, la moindre apparence de jurement était invariablement évitée à l’aide de quelque pieux euphémisme. Ainsi, dans le cantique bien connu qui commence par ces vers :
Oh ! l’auguste sacrement
Où Dieu nous sert d’aliment,
le mot sacrement lui semblait être ce que les Anglais appellent profane. Et il chantait :
Oh ! la yous’ qu’est l’z’agréments,
Beaulieu nous sert d’élément.
« Autour de nos sacrés autels » était pour le bon Chouinard un mot sacrilège. Il chantait :
Autour de nos saprés autels !
VIII
Après tout ce que je viens de dire, il est facile de conclure que, si le serve bone de Picard avait fait commettre au brave Livier une pareille incongruité dans l'église de Saint-Joseph, ce dimanche-là, il ne faut en accuser ni ses sentiments chrétiens ni son respect pour les choses saintes.
Au physique, notre original n'avait rien de particulièrement remarquable.
A part son gros rire naïf et ses petits yeux toujours émerillonnés de gaieté enfantine, c'était le premier venu.
Quand au costume, la casquette en peau de chat, à laquelle j'ai déjà fait allusion, constituait ce qu'il avait de plus saillant, si l'on en excepte cinq ou six peaux de lièvres dont il bourrait son pantalon dans les grands froids.
Un jour, pendant l'opération de la bascule, il arriva un accident.
Comme le pantalon était un peu mûr, une malencontreuse solution de continuité s'y produisit tout à coup, et les peaux de lièvres mirent le nez à la fenêtre.
Inutile d'insister sur le reste de la scène.
Il fut un temps, cependant, où notre ami put faire ses voyages avec plus de confort et sans prendre tant de précautions.
Chaudement enveloppé d'une grande casaque bleu-clair, avec pantalon en pinchina, képi bordé de jaune et bottes d'ordonnance - enfin en uniforme militaire complet - tel apparut Chouinard aux environs de Rimouski, un matin de novembre 1863, par une de ces journées pluvieuses et glaciales dont le vent de nord-est ne manque jamais de favoriser ces parages, à pareille saison.
- Comment, c'est toi, Olivier ! lui dit un avocat bien connu qui le rencontra, arpentant la grande route, la main devant les yeux. - Oui, hi hi ! c'est Livier !
- D'où viens-tu dans cet accoutrement ?
- Viens de la guerre !
- Aux États ?
-Te cré !
C’était justement pendant la guerre de Sécession, et le pauvre diable était tombé dans les filets des nombreux embaucheurs qui parcouraient nos campagnes en quête de recrues.
– Quand es-tu parti ?
– Trois mois ! gros paquet d’argent... hi hi !... – Et tu t’es battu ?
– Te cré !... Canons, fusils, pif ! paf !... Tombais, relevais, parlais anglais... Pas drôle, va !
– Tu n’avais pas peur !
– Non, Livier brave !... Les autres tuaient Livier, mais Livier tuait les autres étout... hi !
– Et puis ?
– Livier ennuyé... Livier sauvé.
Cette expédition avait donné à Chouinard le goût de l’uniforme, à ce qu’il paraît, car un jour, en remontant le fleuve, le capitaine Mormon du Druid – l’un des steamers du gouvernement – l’aperçut sur la grève, un peu en bas de Rimouski, qui faisait des signaux avec une tunique rouge de volontaire au bout d’une perche.
Ne reconnaissant pas l’individu à cette distance, et passablement intrigué, le capitaine donne ordre de stopper, met en panne et dépêche un canot à terre.
– Tiens, c’est Chouinard ! s’écrient les matelots en sautant sur le rivage. La farce est bonne ! Dis donc, espèce de feignant, pourquoi nous fais-tu arrêter comme ça ?
– Lettre pressée pour Québec, veux embarquer. Histoire de rire, on l’embarqua.
Le capitaine grommela bien un peu pour la forme ; mais il finit par pouffer de rire avec les autres.
Surtout quand Chouinard, rendu en face du quai de la Rivière-du-Loup, lui demanda de relâcher un instant pour lui permettre d’aller porter une lettre à un de ses cousins.
Cette fois-là, Livier dut forfaire à sa réputation de postillon sans reproche ; mais en cela il n’était pas plus coupable que le gouvernement de Sa Majesté, qui, cette fois-là aussi, conspirait contre lui-même, le département de la Marine faisant concurrence à celui des Postes.
Chouinard fut trouvé un matin, gelé à mort sur les côtes de Matane.
Je ne sais où repose sa dépouille terrestre ; mais si jamais Dieu me fait la grâce d’une petite place au paradis parmi les honnêtes gens et les bons garçons, je suis bien sûr de le rencontrer là.
V. Cotton I
Le touriste qui, par un beau jour d’été d’il y a trente-cinq ans, arrivait à Saint-Pascal, dans le comté de Kamouraska, ne manquait pas d’apercevoir, sur le plateau culminant de la plus haute des montagnes éparpillées dans la plaine, une espèce de hutte aux pans irréguliers, qui semblait adossée à l’arbre d’une croix monumentale se détachant sur l’azur – toute radieuse au soleil.
C’était la retraite d’un ermite.
Cet ermite s’appelait Cotton.
Il habitait là depuis cinq ou six ans, complètement seul, vivant de ce que les enfants du village venaient lui vendre, ou de ce que les bonnes âmes voulaient bien lui donner pour des prières.
On ne connaissait pas trop son origine.
C’était, au dire de quelques-uns, un ancien tailleur dont la famille vivait encore du côté de Rimouski.
Il avait bâti cette demeure aérienne de ses propres mains.
Comment s’y était-il pris ? Qui lui avait fourni les outils et les mille autres choses nécessaires à cette construction ?
Personne n’en savait rien.
Durant les premiers temps de son séjour à Saint-Pascal, vêtu d’une espèce de soutanelle brune, une corde autour des reins, tête nue, et un long bâton ferré à la main, Cotton descendait de son perchoir chaque dimanche, et assistait aux offices dans le bas de l’église paroissiale, avec de grands airs de dévotion qui attiraient bien l’attention sur lui, mais qui n’imposaient pas à tout le monde, comme on va le voir.
Un jour, il cessa de venir à l’église.
Il avait, paraît-il, eu maille à partir avec le curé, qui semblait n’avoir qu’une confiance assez limitée dans la vocation cénobitique de son nouveau paroissien.
À certaines époques, Cotton s’éclipsait tout à coup, et les gamins qui, pour quelques sous, lui montaient chaque jour du lait, de la galette et autres comestibles, frappaient vainement à la porte du solitaire.
Celui-ci revenait au bout d’un mois ou deux, porteur, assurait-on, de sommes assez rondelettes, à en juger par les nombreuses petites douceurs que ses scrupules d’ermite n’allaient pas jusqu’à lui refuser.
Où allait-il ainsi ?
Comment pouvait-il ainsi paraître et disparaître subitement sans que personne s’en aperçut ?
Et puis, où prenait-il cet argent ?
Là-dessus tout le monde se perdait en conjectures.
Les uns parlaient bien, il est vrai, de déguisements, de voyages à Boston, de quêtes, que sais-je?
Mais, suivant la croyance la plus répandue, parmi les bonnes vieilles femmes surtout, Cotton était enlevé et rapporté par les anges – tout simplement.
La veille de son départ comme la veille de son arrivée, on avait plus d’une fois – c’était de notoriété publique – aperçu d’étranges lueurs envelopper tout le sommet de la montagne.
Quant à Cotton lui-même, sa discrétion sur ce point ne laissait rien à désirer.
Et non pas sur ce point seulement, car il s’était même toujours gardé de laisser connaître son vrai nom.
Les enfants lui avaient appliqué le sobriquet de Cotton, à cause de sa maigreur probablement (on sait que dans nos campagnes toute tige sans branches est un cotton), et il avait accepté cette appellation de bonne grâce, comme il en aurait accepté une autre.
II
Un jour de vacances, en compagnie de deux camarades de collège, Charles et George – ce dernier gibecière sur la hanche et fusil à l’épaule – je me dirigeais, dès le matin, vers la montagne de l’anachorète, déterminé à faire l’ascension, tâche assez facile, du reste, pour mes jarrets de seize ans.
Nous cheminions, allègres et causeurs, bien munis de tout ce qu’il nous fallait pour passer gaiement la journée.
Cette journée s’annonçait superbe.
Ce serait peut-être le moment de croquer une petite description ; mais j’ai peur de faire languir mon récit, et je craindrais, en outre, que ma peinture ne rendît pas justice entière au paysage que j’avais sous les yeux.
Imaginez une route un peu sablonneuse, bordée de beaux arbres fruitiers, des rangées de longs peupliers verts émergeant ci et là des massifs, de jolies maisonnettes toutes blanches, de grosses fermes respirant le confort et l’aisance, des granges lointaines où retentissait le clairon des coqs matineux, de la verdure à perte de vue, l’horizon coupé à différents endroits par des rochers isolés, et des montagnes bleuâtres se dressant à pic du niveau de la plaine ; et nous, marchant gaillardement vers la plus haute d’entre elles, le rire aux dents, humant la brise, buvant le soleil, sifflant avec les merles et turlutant avec les pinsons.
Voilà tous les matériaux ; que le lecteur fasse la description lui-même.
Ils se comptent par milliers ceux qui se sont condamnés volontairement à une vie de solitude perpétuelle, depuis saint Paul l’Ermite, qui, le premier, en l’an 250 de l’ère chrétienne, s’enfonça dans les déserts de la Thébaïde ; depuis saint Siméon Stylite, qui passa son existence sur le haut d’une colonne, en plein air ; depuis saint Antoine, saint Macaire et saint Pacôme, qui s’enfermèrent dans des grottes sauvages, ne vivant que d’eau et de racines jusqu’aux pieux cénobites qui se réfugient encore au fond des monastères pour s’y livrer aux jeûnes, à la prière et à toutes les mortifications de la carrière ascétique.
J’avais lu la Vie des Saints, toute remplie des miracles et des prodigieuses austérités de ces grands serviteurs de Dieu.
Mais, malgré mon âge avide de merveilles, j’avais toutes les peines du monde à me persuader que j’allais voir, là-haut, en plein dix-neuvième siècle, au centre d’un comté célèbre pour ses luttes politiques entre rouges et bleus, un vénérable successeur, en chair et en os, de ces mystérieux personnages dont l'existence extraordinaire a laissé de si vivants souvenirs dans la chrétienté.
Et, les remarques sarcastiques de mes amis aidant - eux étaient de la paroisse, - ce fut, je l'avoue, sans la moindre pensée de recueillement, qu'à la suite de mes deux guides, je me mis à gravir le sentier étroit et escarpé, qui, à travers les noisetiers et mille autres arbustes rachitiques, accrochait ses sinuosités au flanc de la montagne.
Quelques sapins déchiquetés par le vent du nord-est, si violent dans cet endroit du pays, quelques bouleaux transis, à moitié dépouillés par le couteau des passants, de petits frênes souffreteux, des érables nains, jetaient çà et là des lambeaux d'ombrages que nous recherchions avec avidité.
Parfois cette ombre tombait heureusement sur quelque roche saillante, où des restes de repas, dispersés sur la surface aplatie de la mousse, indiquaient un point de repos fréquenté.
À la bonne heure, alors !
Comme l'ascension était raide, on se sentait plus ou moins en nage ; et, n'étant pas pressés, nous faisions halte.
Nous détachions quelques baies sauvages oubliées sur le bord d'une crevasse ; nous improvisions quelque éventail découpé dans un rameau un peu plus touffu que les autres ; nous vidions un gobelet de cidre frais ; et, les jambes allongées sur le tapis vert, nous allumions nos pipes, ce vade mecum de rigueur pour tout potache en vacances.
Et, après un instant de causerie, rafraîchis et ragaillardis, nous nous remettions en route.
Oh ! ces promenades d'écoliers ! ces premières bribes de liberté ! comme le coeur s'y dilate, comme le corps s'y fortifie, comme l'intelligence s'y retrempe.
Exempt de tous soucis, sans regrets du passé et sans inquiétudes pour l'avenir, on s'y abandonne avec indolence au plaisir du moment, comme si la vie n'avait pas d'autre but ni d'autres exigences.
Oh ! les heureux instants qui passent si vite, et qui, hélas ! ne reviennent jamais !
III
Après nombre d’étapes plus ou moins prolongées, nous commencions à apercevoir le terme de notre excursion, c’est-à-dire que nous touchions au dernier épaulement de la montagne, quand George, qui depuis un instant nous priait de parler moins haut, nous fit tout à coup impérieusement signe de nous taire.
– Qu’y a-t-il ? demandai-je à voix basse.
– Pas un mot ! répondit George sur le même ton ; vous allez voir.
Puis, nous poussant dans un pli de terrain masqué par un fouillis de broussailles :
– Ne bougez pas, ajouta-t-il, et regardez bien là-haut, à cette pointe de roc qui surplombe à gauche.
Quand nous fûmes installés dans notre cachette, George épaula son fusil.
– Attention ! fit-il.
Puis, le dos tourné à l’endroit qu’il nous avait dit d’observer, et comme s’il eût fait mine d’ajuster une hirondelle, il pressa la détente.
Le coup résonna clair et sec ; puis on l’entendit, plus long et plus sonore, se répercuter plusieurs fois sur les rochers et dans les ravines, en faisant sortir de leurs retraites des foules d’oiseaux effarouchés. – Regardez bien, nous dit George toujours à demi-voix. Nous fixions avec le plus vif intérêt l’arête de l’escarpement. – Eh bien, avez-vous vu ?
– Oui, une tête.
– Coiffée d’un béret bleu ?
– Oui ; elle s’est avancée un instant, puis reculée tout à coup.
– C’est bien cela ; nous pouvons monter maintenant.
– Pourquoi cette cérémonie ? demandai-je en sortant de l’enfoncement malpropre où Charles et moi nous nous étions blottis.
– Tu vas voir, répondit George ; ça te fera mieux juger de l’homme. Et nous reprîmes notre ascension.
En quelques enjambées, nous eûmes mis le pied sur le dernier plateau. Jamais je n’oublierai le spectacle qui nous y attendait.
Nous nous arrêtâmes stupéfaits d'admiration.
L'atmosphère, d'une merveilleuse transparence, semblait flamboyer comme le décor d'une féerie incandescente.
Dans ce milieu limpide et diaphane, le regard atteignait des distances extraordinaires.
Tout semblait flotter dans la clarté ; et pourtant les maisons, les clochers, les arbres, les routes, tous les mille accidents du paysage, et jusqu'à la ligne réverbérescente du Saint-Laurent, là-bas, coupant l'horizon, tout droit, comme pour accentuer les tons bleuâtres des lointaines Laurentides, tout se dessinait, ou plutôt se détachait en relief, clair, net, lumineux, et comme miroitant sous les effluves d'un soleil splendide.
Le plateau semblait désert.
La hutte était là, solidement assise sur ses quatre pans en épaisse maçonnerie, s'élargissant par la base, et béante.
Mais pas un signe de vie.
Nous jetons un regard à l'intérieur.
Personne.
- Suivez-moi, dit George, et du silence !
Nous fîmes le tour de la cabane, gravîmes quelques marches, et, au pied du léger talus sur lequel se dressait le piédestal d'une immense croix toute bardée de fer-blanc, nous aperçûmes, à genoux et nous tournant le dos, un être singulier, les bras étendus, dans l'attitude de la plus profonde contemplation.
Il ne bougeait pas.
George toussa.
Même immobilité.
Nous toussâmes à notre tour, et consciencieusement.
Alors l'homme eut un soubresaut, se leva, fit un grand signe de croix, se retourna vers nous comme un automate, puis, simulant la plus vive surprise, et prenant tout à coup les manières les plus obséquieuses :
- Ah ! pardon, mes frères ! dit-il d'une voix traînante et nasillarde qu'il s'efforçait de rendre aussi onctueuse que possible en affectant des intonations féminines, pardon de ne pas vous avoir entendus plus tôt. J'étais dans le Seigneur.
– Et quand vous êtes dans le Seigneur comme ça, dit Charles, c’est sans doute ennuyeux pour vous d’être dérangé ?
– Pas du tout, mon frère, pas du tout ! Je suis un solitaire, mais j’aime ceux que le Seigneur m’envoie.
– Du reste, fis-je avec une intuition dont je n’essaierai pas de dissimuler la perfidie, le saint ermite est peut-être en prière depuis longtemps.
– Depuis trois heures ce matin, mon frère ; j’y ai vu levé l’aurore. – Ah !... Et vous ne vous dérangez jamais dans vos dévotions ? – Jamais, mon frère.
J’étais fixé.
– Sapristi ! exclama George, vous devez être bien fatigué alors. Depuis trois heures du matin !
– Mâtin ! fit Charles qui aimait le calembour.
– Tiens, c’est vous, monsieur George ! fit l’ermite, comme par distraction. La santé va bien ?
– Comme vous voyez, merci.
– Oh non ! continua notre interlocuteur en revenant à la question qui lui avait été posée, cela ne me fatigue pas trop ; le joug du Seigneur est doux et léger...
IV
Je l’ai dit plus haut, l’homme que nous avions devant nous était un être singulier.
Il semblait osciller dans sa charpente osseuse et grêle.
Le dos voûté, le cou long, mince et fortement sillonné par la protubérance des tendons, l’œil chassieux et fuyant, la démarche hésitante, il paraissait avoir vieilli avant le temps ; et cependant, dans sa chevelure claire et filandreuse, comme dans sa barbe rare et mal peignée – toutes deux d’un roux jaunâtre et sale – pas un poil ne faisait mine de grisonner.
Rien d’animé dans cette figure aplatie et blafarde.
Le sang extravasé par-ci par-là dans les tissus cutanés, surtout aux pommettes, faisait contraste avec la pâleur des lèvres et l’entourage de bistre qui cerclait ses yeux éteints.
Les cheveux séparés par une raie au milieu du front - mode tout à fait inusitée à cette époque - se collaient sur les tempes et derrière les oreilles, s'allongeant en maigres mèches plates et se relevant un peu aux extrémités, sur le collet d'un vêtement de cotonnade brune, moitié blouse, moitié soutanelle.
Une façon de pantalon chinois en serge noire, qui lui tombait à peine à la cheville, des chaussettes de laine blanche, des pantoufles en cuir jaune, deux doigts de flanelle autour du cou, des tampons d'ouate dans les oreilles, complétaient l'accoutrement.
Le béret bleu avait disparu.
L'homme marchait la tête un peu inclinée sur l'épaule gauche, à petits pas, les genoux serrés, saluant à chaque parole, et frottant sans cesse l'une contre l'autre ses mains aux jointures noueuses, quand il ne les tenait pas dévotement croisées sur sa poitrine rentrante.
En somme, une tournure de papelard de haut grade.
Mais, en revanche, aussi hospitalier que possible.
Quand il eut compris à quels gais lurons il avait affaire, notre ermite ne tarda pas à mettre un peu de côté ses mômeries de commande, pour risquer un coude sur la nappe.
Et je ne parle pas ici au figuré, car le bonhomme nous avait fait mettre à table, s'il vous plaît.
L'intérieur de la cellule - si cela peut s'appeler une cellule - était d'une propreté exquise.
Je me demande comment il s'y prenait, dans sa solitude, pour entretenir son intérieur en pareil état ; car tout y était d'une blancheur immaculée.
La table, qui remplissait à elle seule presque entièrement l'unique pièce de la hutte, était recouverte d'une nappe très fine ayant l'air de sortir des mains de la blanchisseuse.
Les sièges même - de rustiques bancs de bois - se dissimulaient sous des housses en coton blanc d'une fraîcheur à nous faire hésiter d'en approcher nos nippes de collégiens, plus ou moins souillées par la poussière de la route et en particulier par notre embuscade dans les fougères.
Nous devions d'ailleurs aller de surprise en surprise.
À peine étions-nous installés, que l'ermite ouvrit un placard, en tira d'abord des couteaux, des fourchettes et des cuillers, puis de larges jattes de lait sur lequel une mince couche de crème commençait à se former, et enfin un de ces énormes gâteaux appétissants qu’on appelle, dans nos campagnes, galettes à pain bénit.
– Tenez, mes frères, disait-il, vous devez avoir faim, régalez-vous. Les saints anges du bon Dieu m’ont apporté cela ce matin. Et encore ceci, tenez !
Et nous vîmes apparaître un succulent pâté d’airelles, ou, pour me servir de la langue du pays, un succulent pâté aux bleuets, qui fut accueilli par des bravos enthousiastes.
Décidément l’anachorète Cotton faisait une invasion à fond de train dans notre estime.
Il grandissait à nos yeux dans des proportions inattendues.
Et, merveilleux effet de l’appétit sur certaines pratiques dévotes, nous faillîmes nous jeter à ses pieds pour lui demander sa bénédiction.
Réflexion faite, cependant, on se borna à porter un toast échevelé à cet étrange amphitryon qui semblait n’avoir qu’à dire : Sésame, ouvre-toi ! pour voir les parois de son mystérieux logis révéler des cachettes miraculeuses toutes pleines de trésors.
Le voyage nous avait préparé l’estomac ; nous fîmes royalement honneur à ce festin d’un nouveau genre.
Notre hôte nous regardait faire en souriant.
– Mais sapristi, qu’est-ce que cela veut dire ? vous ne mangez pas, vous ! s’écria George.
L’ermite, qui depuis un instant semblait avoir quelque peu oublié son rôle, rentra son sourire, et levant les yeux au ciel :
– Veuillez m’excuser, mes frères, dit-il ; jamais je ne mange avant six heures du soir.
Le cénobite reprenait le dessus.
– Six heures du soir, allons donc ! ce n’est pas possible.
– Oui, mes frères, il faut bien faire quelques petites pénitences pour gagner le ciel, voyez-vous.
– Pas de blague ! dit Charles ; si vous ne mangez pas, moi je ne mange pas non plus.
– Ni moi, appuya George.
– Ni moi, balbutiai-je en jetant un regard ému au provocant pâté aux bleuets, dont on n'avait encore qu'enlevé la couverture croustillante et dorée.
– Allons, mes frères, puisque vous le voulez absolument, je prendrai, pour ne pas vous désobliger, une tasse de lait. Fullum riquidum trumpit bijunium.
Et en apparence tout réjoui d'avoir pu glisser dans la conversation ce qu'il croyait être une citation latine, il se versa un demi-bol de lait, qu'il se mit à avaler à petites gorgées.
Notre ultimatum s'arrêta devant ce moyen terme souligné par une telle preuve d'érudition cléricale.
Et pour ma part, autant par satisfaction d'avoir échappé au danger que par admiration pour ce latin aussi ingénieux qu'original, je sentis se dissiper le nuage que l'imprudente susceptibilité de mes camarades avait amassé sur mon front, et le sourire me revint aux lèvres.
La concession nous parut suffisante et le compromis acceptable.
Rien ne vaut les concessions et les compromis pour mettre les gens d'accord.
Ce devrait être la base de toutes les politiques.
Le fait est que George avait été trop loin ; il le reconnut plus tard.
En tout cas, nous reprîmes les couteaux et les fourchettes, et notre consommation recommença, pantagruélique.
Le repas tirait à sa fin, et nous avions déjà passablement oublié que nous étions chez un ermite, lorsqu'un de nous - je n'oserais affirmer que ce fût Cotton lui-même - s'avisa de nous le rappeler en nous proposant de visiter la chapelle.
Cette chapelle consistait en un certain enfoncement triangulaire, ménagé dans les irrégularités de la construction, et s'ouvrait du côté de l'ouest.
Tout l'intérieur en était rempli par un petit autel très coquet, garni de candélabres, de cierges, d'images coloriées, de dorures et de fleurs artificielles, disposées avec beaucoup de symétrie et de goût.
La porte de cette chapelle minuscule était traversée par une tablette sur un bout de laquelle reposait, comme par hasard, une soucoupe où brillaient quelques pièces d'argent.
L'invitation était transparente, et non moins légitime à dire le vrai.
Nous fîmes un appel sérieux à nos pauvres goussets de collégiens, et nous en laissâmes de grand cœur tomber quelque menue monnaie – compensation à peine suffisante pour la généreuse hospitalité de l’anachorète.
Le saint homme nous parut parfaitement satisfait.
Nous rallumâmes donc les pipes, et la conversation tomba sur ce curieux mode d’existence.
En général, notre hôte répondait à nos questions assez volontiers, mais parfois aussi avec une répugnance visible.
D’après ce que je pus voir, ce n’était pas un contemplateur.
Il semblait peu sensible aux beautés pittoresques qui entouraient l’étrange demeure qu’il avait prise pour domicile.
Le spectacle de la grande nature, les merveilles de la création ne paraissaient pas avoir le don de l’émouvoir.
Cette éclatante journée même, qui répandait autour de nous une telle profusion de splendeurs lumineuses, le laissait froid et sans enthousiasme. – Il fait beau, disait-il.
Et là se bornait son admiration.
Pour lui, tout ce qui concernait le bon ou le mauvais côté de son installation semblait se résumer en une question de beau ou de mauvais temps.
– C’est le vent du nord-est qui n’est pas gai ici, ajoutait-il. Les pluies battantes qu’il amène sont excessivement désagréables. L’automne surtout, c’est glacial. Et, à cette hauteur, pas besoin de vous dire si ça souffle. Souvent j’ai peine à me tenir à genoux pour faire mes prières.
Avions-nous affaire à un fou ?
Je le crois.
En tout cas, sa manie était inoffensive : nous la respectâmes.
L’après-midi était déjà avancé ; après avoir jeté un dernier coup d’œil au paysage et quelques coups de fusil aux échos des rochers que nous dominions, nous serrâmes la main de l’hospitalier Cotton, et nous reprîmes le chemin de la descente, pendant que, les bras étendus et les yeux levés au ciel, l’ermite nous criait de sa voix nasillarde :
– Que la bonne Sainte-Vierge et les anges du Seigneur vous accompagnent !
Maintenant, si, en voyageant sur le chemin de fer Intercolonial, il vous arrive de descendre à Saint-Pascal, et de vous diriger du côté de Kamouraska, vous apercevrez, à votre droite, à quelque deux milles de la gare, une montagne isolée, de forme oblongue, aux flancs très escarpés, surtout du côté du nord.
Cette montagne, beaucoup plus élevée que ses voisines, a ceci de particulier qu’on distingue, à son sommet, qui semble inaccessible, les vestiges délabrés d’une masure quelconque.
Demandez au premier gamin que vous rencontrerez sur la route quelle est cette montagne, il vous répondra invariablement, en ôtant son chapeau avec la politesse qu’on remarque chez tous les habitants de l’endroit
:
– C’est la montagne à Cotton, Monsieur.
Mais personne ne pourra vous dire ce qu’est devenu l’ermite. Espérons que les anges l’auront enfin emporté pour tout de bon.
VI. Dupil
I
La ville de Lévis est loin d’avoir toujours présenté l’aspect pittoresque qui la distingue aujourd’hui.
À l’époque dont je vais parler, l’église de Notre-Dame était presque isolée sur son immense plateau.
Et de là, en descendant jusqu’à la falaise qui borde le fleuve, c’était la Commune, avec ses ravins et ses broussailles ; tandis que vers l’est s’étendaient, jusque sur les hauteurs de Lauzon, une suite de prairies coupées de fossés le long desquels s’allongeaient de maigres clôtures de cèdre à moitié masquées par des fouillis d’arbustes et de plantes herbacées.
Après la fenaison, ces prairies étaient pour les gamins du voisinage un préau à perte de vue.
Et Dieu sait s’ils en profitaient !
Je me souviens avoir connu là une escouade de lurons qui ne se laissaient pas marcher sur les pieds, lorsqu’il s’agissait d’y aller gaiement.
Un soir que la petite troupe s’ébattait dans le champ le plus voisin de l’église, elle vit venir, longeant ce qui aurait pu être un trottoir, mais qui n’était encore qu’une rigole, un personnage dont l’apparition provoqua chez elle un intérêt soudain.
C’était un vieillard maigre et hâve, au dos voûté, mais d’apparence robuste, avec des cheveux poivre et sel qui s’échappaient en désordre d’un vieux feutre dégommé, et retombaient en mèches longues et sales sur le collet d’un paletot dont l’aspect débraillé accusait de nombreuses années de service et d’usure.
Une large ceinture de cuir retenait à sa hanche un pantalon jadis noir, dont les tiges effiloquées n’étaient pas faites pour dissimuler l’inquiétante maturité de l’ensemble.
Une chemise de flanelle en lambeaux, une paire de bottes outrageusement éculées complétaient le costume.
En somme, malgré la pacotille de ferblanterie qu'il portait sur son dos, le nouveau venu avait tous les dehors d'un vagabond ; et la canne ferrée qu'il tenait à la main n'était, ni par la taille ni par le poids, de nature à tranquilliser outre mesure bêtes et gens sur ses dispositions plus ou moins pacifiques.
Appuyé sur cette espèce d'épieu, il s'avançait lentement du côté de l'église, peinant dans la montée, faisant halte de temps à autre pour s'essuyer le front du revers de sa manche, tout en jetant du côté des moutards un regard oblique et défiant.
La rencontre ne paraissait pas lui sourire ; et l'on va voir que son instinct, ou plutôt son expérience, ne le trompait guère. En l'apercevant, la marmaille eut un cri de joie - Dupil !
Et, le temps de le dire, toute la bande fut sur la clôture, rangée en batterie d'un nouveau genre, sous le feu de laquelle force était au vieux mendiant de passer, s'il tenait à continuer sa route.
Celui-ci, le sourcil froncé, se mit à promener alternativement sur chacun des jeunes espiègles un oeil qui aurait pu troubler les plus hardis, s'ils n'eussent eu la clôture et le fossé pour protection naturelle.
Mais, comme rien ne bougeait, le vieillard poursuivit son chemin.
Quand il fut à quelques pas du groupe, un des enfants lui adressa la parole :
- Bonjour, père Dupil !
- Ah ! mes crapauds, s'écria le bonhomme ; vous savez ben que j'suis pas père. C'est vos serpents verts de parents qui vous montrent ça l... Et il se mit à menacer les gamins de sa canne, en répétant - J'suis pas père, million de tempêtes ! vous le savez ben. - Vous dites ça pour rire, père Dupil !
Cette fois, il fallut décamper, et prestement.
- Attendez voir, mes petits pendards, j'vais vous montrer, moi, si j'suis père !
Et voilà le bonhomme en train d'escalader la clôture avec son cliquetis d'ustensiles sur les épaules.
Pas besoin de se demander si les gamins détalaient.
En un clin d' oeil, ils avaient franchi la largeur du champ, et mis leur peau en sûreté derrière une deuxième clôture.
L'homme les suivit en proférant une interminable kyrielle de jurons. Quand il faisait mine de s'arrêter, les garnements n'avaient qu'à crier Père Dupil ! et la poursuite recommençait.
Le vieux courait en titubant dans l'herbe nouvellement fauchée, harassé, la sueur au front, l'écume à la bouche, brandissant toujours sa redoutable canne, et crachant à pleine gorge tout ce que sa colère impuissante pouvait lui inspirer de menaces et de gros mots :
- Bande de malvats ! criait-il.
- Père ! répondait-on.
- J'suis pas père, canailles !
- Oui, vous êtes père.
- C'est pas vrai !
- Oui, c'est vrai !
- Non, non, non, non !
- Oui, oui, oui, oui !
- Non!...
- Vous blaguez, père.
- J'suis pas père !... crasse des crasses, c'est-y possible ! Et il reprenait sa course.
Mais il avait beau courir, les polissons, plus agiles du jarret, se tenaient facilement à distance en passant d'un champ dans un autre, et réussissaient toujours à mettre à temps une nouvelle barrière entre eux et lui.
Au sixième clos, le vieillard, épuisé, put sauter encore le fossé, brisa une perche de la clôture, enjamba le reste en blasphémant...
Mais il ne put aller plus loin...
Il s'affaissa sur le revers du talus, la tête dans ses mains, s'arrachant les cheveux à poignées, et grommelant toujours dans des hoquets étouffés - J'suis pas père, tas de rapaces! j'suis pas père!...
II
Les enfants s’en revinrent par un autre chemin – contents d’eux-mêmes. Ils avaient tant ri !
Hélas ! j’en étais malheureusement.
Et maintenant que, devenu vieux, je me prends à songer à tout ce qui a dû remuer au fond de cette existence bouffonne, avant de lui donner le pli tragique qu’elle a conservé jusqu’aux derniers moments, toutes les agaceries dont le pauvre traîne-misère a été l’objet de notre part me semblent autant de sacrilèges ; et je me sens porté à demander pardon à Dieu d’avoir peut-être versé une goutte amère de plus sur ce cœur déjà si profondément saturé de fiel et de vinaigre.
Les données manquent pour raconter la vie de Dupil.
Cette hostilité constante, qu’il voyait ou croyait voir fermenter autour de lui, l’avait rendu très défiant, très concentré.
Ce n’est que dans ses moments de colère et d’imprécations qu’il soulevait un peu le couvercle de son passé, et laissait entrevoir la source de ses griefs.
Car griefs il y avait.
Dupil était une victime.
De qui ?
De tous peut-être.
La Beauce était son pays natal.
Tout jeune, la mort de ses parents l’avait fait héritier d’une aisance au-dessus de la moyenne.
Il avait commencé par exploiter avec assez de succès un joli patrimoine, et l’avenir s’annonçait à lui, sinon très brillant, du moins sous d’excellentes couleurs, lorsque des difficultés survinrent.
Sir John Caldwell – un homme politique qui a laissé dans le pays des souvenirs peu enviables – le « maudit Carouel », comme il l’appelait, était alors propriétaire de la seigneurie de Lauzon, dans les limites de laquelle se trouvait enclavé l’héritage de Dupil.
Cela date de loin, comme on voit.
Or, à propos de quelque chose ou à propos de rien, sur un point ou sur un autre, réclamation légitime ou chicane d’Allemand, un différend s’éleva entre le gentilhomme puissant et l’humble roturier.
Une mesquine persécution d’intendant peut-être.
Il en résulta un procès.
Un de ces procès envenimés, interminables - instance sur instance - où demandeur et défendeur, appelant et intimé, gagnant ou perdant, tout le monde s'appauvrit - excepté les avocats.
Ce fut l'histoire du pot de terre et du pot de fer.
Dupil devait être condamné ; on le comdamna. Pour le grand seigneur, c'eût été une plaisanterie.
Pour le petit propriétaire, c'était la ruine, ou peu s'en faut.
Perte de temps, relâchement dans les habitudes, affaires négligés, culture interrompue, mémoires de frais à payer, tout cela amena la gêne, les emprunts à usure, les hypothèques, et enfin les huissiers.
On vit une de ces dégringolades dont nos campagnes - peuplées de Bretons têtus et de plaideurs normands - nous offrent tant d'exemples.
Ce procès - où Dupil n'avait vu qu'une molestation criante - l'avait exaspéré ; les désastreuses conséquences qui s'ensuivirent le blessèrent profondément dans son sens intime de la justice.
III
Cette blessure, qui devait saigner toujours, fut en plus aggravée par une circonstance malheureuse.
Un prêtre - le curé de l'endroit, si mes renseignements sont exacts - avait, à ce qu'on disait, joué un rôle, involontaire sans doute, dans le malheur de Dupil.
Appelé à la barre des témoins, il avait dû prêter, dit-on, un serment aussi décisif que contraire aux intérêts de son paroissien.
De là, dans l'esprit de celui-ci, l'impression que le prêtre et l'Anglais - la « canaille de curé » et le « maudit Carouel » - s'étaient conjurés pour le ruiner.
De là aussi la haine féroce dont le malheureux enveloppait non seulement le clergé tout entier, mais encore tout ce qui de près ou de loin touchait au culte et à la religion.
En outre, tout cela se compliquait, paraît-il, d'une affaire romanesque.
Vers l’époque du fameux procès, autant qu’on pouvait en juger, un chagrin d’amour semblait être venu ajouter sa cuisante brûlure aux plaies déjà envenimées du pauvre homme.
– Elle ! elle !... murmurait-il quelquefois avec un de ces soupirs qui déchirent la poitrine. Elle aussi !... elle en était !... Ils l’ont tournée contre moi. C’est la faute au curé ; c’est la faute au bon Dieu !...
Et ses doigts se crispaient de rage, tandis qu’une grosse larme traçait un sillon malpropre sur sa joue noircie par le soleil et la poussière des routes.
Un jour, après une des scènes dont j’ai donné un pâle échantillon au début de cette histoire – scènes qui se renouvelaient toutes les fois que le vieux se risquait à clabauder à travers les rues de Lévis – il se laissa tomber tout en nage sur un coin de trottoir, et quelqu’un l’entendit qui disait avec des sanglots dans la gorge :
– Oh !... Rose !... Rose !... si t’avais voulu, le bon Dieu m’aurait pas fait tout ça !...
Quoi qu’il en soit des détails, Dupil dut quitter la Beauce.
Le cœur débordant d’amertume et de ressentiment, il était venu s’établir à Québec, et, avec les débris de son avoir, s’était monté un petit magasin dans le faubourg Saint-Jean.
Trois mois après, un incendie rasait la maison, et, comme à cette époque on ne parlait guère d’assurances à Québec, Dupil était jeté sur le pavé, presque nu et sans un sou vaillant.
Alors sa pauvre cervelle, n’en pouvant supporter davantage, se détraqua complètement.
Il avait maudit le prêtre : il fit plus.
Il montra le poing au ciel, et se repliant sur lui-même dans un désespoir sourd, il accepta une existence de proscrit, de lépreux, jurant à Dieu une haine qu’il devait emporter au tombeau, après plus de soixante années de misère et d’isolement sauvage.
IV
Quand j’ai connu Dupil – vers 1848 – il était déjà tout cassé.
Je crois le voir encore, sale et terreux, déguenillé, l’œil torve et la bouche amère, son brûle-gueule aux dents, chambouler à travers les rues, bâton en mains et ferblanterie en bandoulière.
Il fabriquait cette ferblanterie lui-même.
Où ? je n’en sais rien.
Il devait bien avoir un taudis quelque part, – le domicile légal réduit à sa plus simple expression sans doute, – mais dans quelle direction ? dans quel coin ?
C’était un mystère.
Il portait sa marchandise, enfilée comme des grains de chapelets, dans une tige de fer courbée en cercle ; et, pour mieux se prêter à cette opération, de même que pour moins tenter les voleurs, je suppose, ses plats, ses écuelles et ses tasses n’avaient point de fond.
Quand il faisait une vente, le fond se taillait et se soudait séance tenante, après marché conclu.
Une femme du peuple eut un jour la malencontreuse inspiration de lui faire cette remarque :
– Mais ils n’ont pas de fond vos gobelets, père Dupil.
– J’suis pas père ! répondit-il furieux ; mais j’peux leur en mettre, des fonds, à mes gobelets, – et à toi aussi, espèce de bourrique !
Va sans dire que j’atténue considérablement les expressions ; on a déjà compris que Dupil ne se piquait guère de langage académique.
Il ne faisait pas bon, aux femmes moins qu’aux autres, de le taquiner, car il ne se gênait guère pour appliquer aux plus irréprochables la rime riche dont Vert-Vert abusa un jour si effrontément à l’adresse des bonnes visitandines de Nevers.
Comme le lecteur a pu en juger aussi, un des principaux traits caractéristiques de la folie de Dupil, c’était une répulsion non moins rageuse qu’incompréhensible pour le mot père accolé à son nom.
Le nom de Père Dupil l’exaspérait hors de toute expression.
Cela se rattachait-il au désappointement de cœur éprouvé dans sa jeunesse ?
Ce mot réveillait-il au fond de sa pensée un pauvre rêve encore saignant et mal enterré ?
Je l'ignore ; mais il suffisait de lui dire : Bonjour, père ! pour le mettre en fureur.
- J'suis pas père ! criait-il en grinçant des dents. J'suis pas père ! J'ai jamais été père !... Laissez-moi tranquille, passez vot' chemin, rognes de vauriens !
Et il se précipitait sur les gens avec son bâton.
Quelquefois même, il lui arrivait de tomber sur des personnes inoffensives qui, ne le connaissant pas, lui avaient adressé la parole de la façon la plus innocente du monde.
Sur la route solitaire, n'est-ce pas ? vous rencontrer un vieux mendiant, comment ne pas lui dire un petit bonjour en passant ?
Et, si vous ne connaissez pas l'individu par son nom, vous lui dites tout naturellement
- Bonjour, père !
Alors il fallait voir la colère de Dupil et la stupéfaction de l'interlocuteur devant l'accueil fait à sa politesse.
Mais c'est lorsqu'il se rencontrait avec les enfants de l'école - j'en ai donné une idée plus haut - que le chahut était beau à voir et à entendre - V'là le père Dupil !
- Ohé, père Dupil !
- Hourra pour le père Dupil !
- D'où venez-vous donc, père Dupil ?
- Combien les plats, père Dupil ?
- J'suis pas père, race d'assassins ! criait le bonhomme, furibond. J'suis pas père, enfants de potence !...
Les cris redoublaient naturellement.
Alors le vieillard devenait affolé.
- Justice ! hurlait-il ; justice !... justice du diable, si y a pas d'justice du bon Dieu !... Y a donc pas d'maire par ici !...
Et il s'élançait dans le tas des diablotins, qui s'éparpillaient en criaillant comme une volée de moineaux surpris par un chat.
Quelquefois un retardaire malchanceux se faisait harponner au passage ; et alors, malheur à lui !
Il rentrait au logis étrillé d'importance.
L’exemple ne servait pas à grand’chose cependant. C’était toujours à recommencer.
Aussitôt que Dupil émergeait à l’horizon, en avant le charivari !
V
Il y avait parmi nous un loustic numéro un, qui s’appelait Onésime Bégin – bon garçon, au fond, mais agaçant à faire damner un saint.
Il avait parié de mettre ce pauvre Dupil sur le gril, et de l’y faire rôtir à petit feu, sans s’attirer de représailles.
En d’autres termes, il devait lui crier : Père Dupil ! dans les oreilles à satiété, sans le fâcher.
Le pari fut bientôt décidé, car le soir même, Dupil faisait son apparition dans le quartier.
Il y a de cela plus de quarante ans, et je crois y être encore. Maître Onésime était prêt ; il n’hésite pas, et aborde le vieux :
– Bonjour, monsieur Dupil, fait-il poliment, sa casquette à la main. Dupil, peu habitué à ces manières, s’arrête et regarde de travers. – Bonjour, monsieur Dupil, répète Onésime.
– Qu’est-ce que tu veux, toi ? fait le bonhomme sur un ton rogue et d’un air soupçonneux.
– Je veux vous parler de ces individus-là qui sont toujours à vous appeler père.
– Fiche-moi la paix !
– Voyons, monsieur Dupil, pas besoin de vous fâcher : je vous appelle pas père, moi. J’sais bien que vous êtes pas père. Vous faites bien de pas vous laisser appeler père. A-t-on jamais vu ?... Est-ce un nom ça, père ?... Pourquoi père, quand on ne l’est pas ?... C’est pas moi qui me laisserais appeler père ! Ils sont toujours là à crier père, père par-ci, père par-là... On n’entend que ça : père, père, père !... Père Dupil, père Dupil, père Dupil, père Dupil !...
Et l’abominable galopin allait, allait, allait, avec un volubilité infernale, – ironique, provocant, répétant le mot chatouilleux à tue-tête, avec une insistance diabolique et des intonations à exaspérer une borne.
Pas besoin de se demander si le vieux était dans l’eau bouillante. La canne lui frétillait dans les doigts comme une anguille. Il se tenait à quatre, cela se voyait.
Nous nous attendions à une explosion : elle eut lieu. Bonté divine, quelle râclée !
Jamais je n’ai vu pareille série d’entrechats et de sauts croches exécutés avec un entrain plus consciencieux et des torsions de corps plus dégingandées.
Dupil tenait mon Onésime par l’oreille, et vli ! vlan ! vlon ! sur le long et sur le large, de droite et de gauche, sur les bras, sur les jambes... une grêle, quoi !
Le pauvre diable d’Onésime hurlait comme un possédé.
Il avait perdu sa gageure... mais en revanche il pouvait se vanter d’avoir gagné un fameux savon.
Un dimanche après-midi, ne voilà-t-il pas que la marmaille découvre le vieux Dupil endormi sur une pile de planches, auprès d’une maison en construction.
Il avait probablement caressé quelque peu la dive bouteille – cela lui arrivait – et, sur le dos, la face au soleil, il dormait comme un loir et ronflait comme un orgue.
La fumisterie ne fut pas longue à organiser.
Vite, les chenapans se procurent des broquettes, et des fers à repasser pour pouvoir enfoncer celles-ci sans bruit ; et, cinq minutes après, mon Dupil était cloué au bois, de la tête aux pieds, par toutes les bribes et toutes les franges de ses haillons, – paralysé des bras et des jambes, fixe, immobile, incapable de remuer autre chose que les yeux.
Dupil dormait et ronflait toujours.
Alors un cri formidable retentit dans ses oreilles :
– Père !...
– Père Dupil !...
– Père ! père ! père !...
Je n’essaierai pas de peindre la scène du réveil.
Les farceurs faillirent avoir un meurtre sur la conscience.
Quand le docteur Goulet vint délivrer le malheureux, il le trouva évanoui, la figure noire et congestionnée comme un noyé sortant de l’eau.
Le pauvre vieux fut longtemps, paraît-il, entre la vie et la mort.
VI
Devenu homme – quand les circonstances m’eurent entraîné loin de Lévis – je perdis tout naturellement de vue le vieil original.
À mon retour, je le croyais au cimetière depuis longtemps, lorsqu’un beau matin je vois entrer dans mon bureau un mendiant tout courbé, tout hésitant, l’air humble et la figure accablée.
Je n’eus pas le temps de manifester ma surprise par une seule parole.
– J’suis pas père, dit-il sans lever les yeux, et avec un accent de tristesse qui me fit mal ; j’suis pas père ; la charité, s’il vous plaît.
Alors il me passa dans le cœur un remords dont je sens encore la piqûre d’épine.
– Avec plaisir, mon pauvre brave homme, lui dis-je en lui offrant une pièce de monnaie ; tenez, prenez, et pardonnez-moi de vous avoir fait de la peine quand j’étais petit.
– J’suis pas père ! me répondit-il sur le même ton de désolation inconsciente.
Le pauvre vieux ne savait presque plus dire autre chose.
Le mot était passé chez lui à l’état d’épiphonème machinal, qu’il répétait à chaque instant, à tort ou à raison, sans y songer.
Son irascibilité avait fait place à un apaisement morne et résigné.
Plus de colères folles, plus de jurements effrénés.
Si quelqu’un le taquinait encore en l’appelant père, il se contentait de protester, sans les emportements d’autrefois.
Il protestait toujours, par exemple.
– Combien vendez-vous vos théières, père Dupil ? lui demande un jour
une petite fille qui est maintenant une sage mère de famille.
– J’suis pas père, répondit-il les yeux baissés ; mais je les vends dix-huit
sous.
Il protestait même – comme on l’a vu – sans prétexte aucun.
Il lui fallait dire à tout le monde qu’il n’était pas père ; une idée fixe, un besoin. C’était là le côté plaisant des manies du pauvre Dupil.
Hélas ! elles en avaient un autre beaucoup plus sérieux et d’un caractère bien plus pénible.
C’était sa rancune persistante contre la Providence.
– Pourquoi détestez-vous donc tant le bon Dieu ? lui demandait quelqu’un.
– Parce qu’il est comme les prêtres ; il est pas juste !
– Allons donc, comment pouvez-vous parler ainsi ?
– Parce que je le sais ; tenez, vot’ bon Dieu, c’est le maître, c’pas ? – Sans doute.
– Eh ben, s’il est le maître, pourquoi qu’il laisse faire toutes les crasseries qu’y a dans le monde ? Il est pas juste !
– Mais il y a le ciel, mon ami.
– Le ciel ? ah ! ben ouiche !... Toujours le même maître, pas vrai ? – Naturellement.
– Eh ben, si c’est le même maître, c’est comme par icitte : le plus gros mange l’autre.
Impossible de le faire sortir de là.
Aussi, quand il demandait l’aumône, ne se servait-il jamais de la formule « pour l’amour de Dieu ».
Dans les premiers temps, quand on lui mettait un sou dans la main en disant : « Pour l’amour de Dieu ! » il le rejetait avec indignation et blasphème.
Plus tard, il se contentait de le remettre en balbutiant sur un ton très doux :
– Non, merci ; si vous l’donnez pas par charité, gardez-le.
Une fois, en ma présence, un marchand de Lévis lui mit entre les mains un billet de banque de dix dollars en lui disant de le garder, s’il l’acceptait pour l’amour de Dieu.
Et le misérable, pâle de faim et grelottant sous ses guenilles, remit tranquillement l’argent, sans même avoir l’air de le regretter.
Depuis que le pauvre diable ne se servait plus de son gourdin que pour se défendre des chiens hargneux, il était devenu très timide, très peureux.
Si quelque femme, effrayée par sa présence peu rassurante, lui montrait un manche à balai, il détalait aussitôt en criant :
– Tirez pas ! tirez pas !
C’était l’enfance sénile, après la monomanie rageuse.
Le vieux Dupil est mort, recueilli par un de ces prêtres qu’il haïssait d’une haine si intense ; et durant ses quinze derniers jours sur la terre, il a vu, au chevet qui avait remplacé son sordide grabat, flotter, charitable et consolante, cette robe noire qu’il avait tant maudite.
Il s’attendrit.
Il pleura même.
Il baisa la main qui lui montrait du doigt une vie future toute de justice et de réparation.
Mais ce fut tout ; il resta jusqu’au bout inexpugnable dans le dernier retranchement de sa conscience.
Au seuil même de l’éternité, quand l’âme la plus endurcie se retourne pour demander à n’importe qui une consolation suprême, la charité sacerdotale penchée sur son agonie ne put lui faire retirer son anathème. Il pardonna à tous, excepté à Dieu.
Mais la grande miséricorde éternelle a eu sans doute pitié de cette âme dont tant de rudes secousses avaient éteint le flambeau, sans malheureusement y effacer la lueur des souvenirs tragiques. |
|
 |
|
|
 |
|
|
|
 |
 |
 |
 | Autres documents associés au dossier Inaptitude |
 |  |
|
 |
|
|
|
| | L'autiste show de Blainville |
| | L'autiste show | | | Difficile de passer sous silence cette joyeuse initiative: les Autiste Show, qui ont lieu dans diverses régions du Québec, entre autres, Ville Lorraine et Repentigny, au printemps. Nous présentons celui qui a eu lieu le 22 mai 2010 au manège du Parc équestre de Blainville, à l'initiative de la ,
|  | | | Régime enregristré d'épargne invalidité |
| | Assouplissement de l'admissibilité au REEI | | | Pour être admis au REEI, il faut déjà être admis au régime de crédit d'impôt, ce qui suppose qu'on ait de l'argent dans un compte en banque. Jusqu'à ce jour, il n'était pas possible d'en appeler de cette règle. La procédure ayant récemment été simplifiée, les plus pauvres auront plus facilement droit au REEI. |  | | | Ce 3 décembre 2010, Journée Internationale des personnes handicapées |
| | Vivre, peindre et écrire avec le syndrome de Down | | | La video est en anglais, mais comme d'une part le son n'y est pas très clair et comme d'autre part le langage de la personne en cause est la peinture, vous ne perdrez rien si vous vous limitez à regarder attentivement les visages et les tableaux. Elisabeth Etmanski, née il y a trente-deux ans avec le syndrome de Down, mène une vie autonome depuis longtemps. Ne soyez pas étonnés, si jamais vous la rencontrez, qu'elle vous salue en écrivant ou en disant un poème à votre sujet. Votre sensibilité est peut-être reléguée à l'arrière plan de votre être, la sienne imprègne tout sa personne y compris la surface. Vous comprendrez à son contact comment le réenchantement du monde peut s'opérer. Quelles sont ses aspirations en tant que peintre? On lui pose la question à la fin de la video. Sa réponse est à l'image de sa personne, naïve: «Je veux être la prochaine Emily Carr.» |  |
|
 |
|
|
 |
 |
 |
|
 |  |
|