 |
|
 |
|
|
 | | Revue Le partenaire |  | | Créée en 1992, la revue le partenaire est devenue au Québec une voix importante pour les personnes utilisatrices de services en santé mentale et pour tous les acteurs concernés par la réadaptation psychosociale, le rétablissement et la problématique de la santé mentale. Ses éditoriaux, ses articles, ses dossiers proposent une information à la fine pointe des connaissances dans le champ de la réadaptation psychosociale. Ils contribuent à enrichir la pratique dans ce domaine et à stimuler le débat entre ses membres. | |
| Destination El Paradiso | 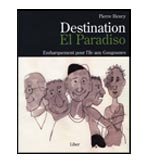 | | El Paradiso n’est pas une maison de retraite comme les autres. Située dans une île enchanteresse qui est réservée à son usage, elle accueille des pensionnaires bien particuliers. Ce sont, par un aspect ou l’autre de leur vie, par ailleurs tout à fait honorable, des originaux, des excentriques, habités par une douce folie, qui n’a sans doute d’égal que la simplicité de leur bonheur. C’est une galerie de personnages un peu fantasques que nous fait rencontrer cet ouvrage tout empreint de tendresse, d’humour et d’humanité. Voici donc les premiers douze membres de ce club très spécial:
Perry Bedbrook, Guy Joussemet, Édouard Lachapelle, Andrée Laliberté,
Céline Lamontagne, Guy Mercier, Avrum Morrow, Lorraine Palardy,
Antoine Poirier, Michel Pouliot, Charles Renaud, Peter Rochester.
| |
| Le Guérisseur blessé |  | | Le Guérisseur blessé de Jean Monbourquette est paru au moment où l’humanité entière, devant la catastrophe d’Haïti, s’est sentie blessée et a désiré contribuer de toutes sortes de façons à guérir les victimes de ce grand malheur. Bénéfique coïncidence, occasion pour l’ensemble des soignants du corps et de l’âme de s’alimenter à une source remarquable.
Dans ce livre qui fut précédé de plusieurs autres traitant des domaines de la psychologie et du développement personnel , l’auteur pose une question essentielle à tous ceux qui veulent soigner et guérir : « Que se cache-t-il derrière cette motivation intime à vouloir prendre soin d’autrui? Se pourrait-il que la majorité de ceux et celles qui sont naturellement attirés par la formation de soignants espèrent d’abord y trouver des solutions à leurs propres problèmes et guérir leurs propres blessures? » Une question qui ne s’adresse évidemment pas à ceux qui doivent pratiquer une médecine de guerre dans des situations d’urgence! | |
| Mémoire et cerveau |  | | Dans ce numéro de La Recherche, on se limite à étudier la mémoire dans la direction indiquée par le psychologue torontois Endel Tulving, reconnu en en ce moment comme l'un des grands maîtres dans ce domaine. Cela confère au numéro un très haut degré de cohérence qui en facilite la lecture. Culving est à l'origine de la distinction désormais universellement admise entre la « mémoire épisodique » portant sur des événements vécus et la « mémoire sémantique » portant sur des concepts, des connaissances abstraites. C'est la première mémoire que je mets en œuvre quand je m'efforce d'associer des mots à un événement passé, un voyage par exemple; je m'en remets à la seconde quand je m'efforce d'associer des mots automatiquement les uns aux autres, abstraction faite de tout événement vécu auquel ces mots pourraient se rapporter. Au cours de la décennie 1960, Tulving a constaté que les résultats obtenus grâce au premier exercice étaient beaucoup moins bons que ceux obtenus par le second exercice, ce qui l'a incité à faire l'hypothèse qu'il existe deux mémoires distinctes. | |
| Spécial Mémoire |  | | Dans ce numéro de La Recherche, on se limite à étudier la mémoire dans la direction indiquée par le psychologue torontois Endel Tulving, reconnu en en ce moment comme l'un des grands maîtres dans ce domaine. Cela confère au numéro un très haut degré de cohérence qui en facilite la lecture. Culving est à l'origine de la distinction désormais universellement admise entre la « mémoire épisodique » portant sur des événements vécus et la « mémoire sémantique » portant sur des concepts, des connaissances abstraites. C'est la première mémoire que je mets en œuvre quand je m'efforce d'associer des mots à un événement passé, un voyage par exemple; je m'en remets à la seconde quand je m'efforce d'associer des mots automatiquement les uns aux autres, abstraction faite de tout événement vécu auquel ces mots pourraient se rapporter. Au cours de la décennie 1960, Tulving a constaté que les résultats obtenus grâce au premier exercice étaient beaucoup moins bons que ceux obtenus par le second exercice, ce qui l'a incité à faire l'hypothèse qu'il existe deux mémoires distinctes.
| |
| L'itinérance au Québec |  | | La personne en situation d’itinérance est celle :
[…] qui n’a pas d’adresse fixe, de logement stable, sécuritaire et salubre, à très faible revenu, avec une accessibilité discriminatoire à son égard de la part des services, avec des problèmes de santé physique, de santé mentale, de toxicomanie, de violence familiale ou de désorganisation sociale et
dépourvue de groupe d’appartenance stable.
Cette définition met en évidence la complexité du phénomène et l’importance de l’aspect multifactoriel des éléments déclencheurs tels que la précarité résidentielle et financière, les ruptures sociales, l’accumulation de problèmes divers (santé mentale, santé physique, toxicomanie, etc.). L’itinérance n’est pas un phénomène dont les éléments forment un ensemble rigide et homogène et elle ne se limite pas exclusivement au passage à la rue.L’itinérance est un phénomène dynamique dont les processus d’exclusion, de marginalisation et de désaffiliation
en constituent le coeur. | |
| L’habitation comme vecteur de lien social |  | | Evelyne Baillergeau et Paul Morin (2008). L’habitation comme vecteur de lien social, Québec, Collection
Problèmes sociaux et intervention, PUQ, 301 p.
Quel est le rôle de l’habitation dans la constitution d’un vivre ensemble entre les habitants d’un immeuble, d’un ensemble d’habitations ou même d’un quartier ? Quelles sont les répercussions des conditions de logement sur l’organisation de la vie quotidienne des individus et des familles et sur leurs modes d’inscription dans la société ? En s’intéressant à certaines populations socialement disqualifi ées, soit les personnes ayant des problèmes de santé mentale et les résidents en habitation à loyer modique, les auteurs étudient le logement non seulement comme l’un des déterminants de la santé et du bien-être, mais également comme un lieu d’intervention majeur dans le domaine des services sociaux. De la désinstitutionnalisation à l’intégration, des maisons de chambres aux HLM, ils décrivent et analysent des expériences ayant pour objectif le développement
individuel et collectif des habitants et les comparent ensuite à d’autres réalisées au Canada, aux Pays-Bas et en Italie.
Pour en savoir plus : http://www.puq.ca | |
| Revue Développement social |  | | On a longtemps sous-estimé l'importance du lien entre les problèmes environnementaux et la vie sociale. Nous savons tous pourtant que lorsque le ciel est assombri par le smog, on hésite à sortir de chez soi pour causer avec un voisin. Pour tous les collaborateurs de ce numéro consacré au développement durable, le côté vert du social et le côté social du vert vont de soi. La vue d'ensemble du Québec qui s'en dégage est enthousiasmante. Les Québécois semblent avoir compris qu'on peut redonner vie à la société en assainissant l'environnement et que les défits à relever pour assurer le développement durable sont des occasions à saisir pour resserrer le tissu social.
| | La réforme des tutelles: ombres et lumières. |  | | En marge de la nouvelle loi française sur la protection des majeurs, qui doit entrer en vigueur en janvier 2009.
La France comptera un million de personnes " protégées " en 2010. Le dispositif actuel de protection juridique n'est plus adapté. Ce " livre blanc " est un plaidoyer pour une mise en œuvre urgente de sa réforme. Les enjeux sont clairs lutter contre les abus, placer la protection de la personne, non plus seulement son patrimoine, au cœur des préoccupations, associer les familles en les informant mieux, protéger tout en respectant la dignité et la liberté individuelle. Le but est pluriel. Tout d'abord, rendre compte des difficultés, des souffrances côtoyées, assumer les ombres, et faire la lumière sur la pratique judiciaire, familiale et sociale ; Ensuite, expliquer le régime juridique de la protection des majeurs, et décrire le fonctionnement, les bienfaits, et les insuffisances ; Enfin, poser les jalons d'une réforme annoncée comme inéluctable et imminente mais systématiquement renvoyée à plus tard.
Les auteurs: Michel Bauer, directeur général de l'Udaf du Finistère, l'une des plus grandes associations tutélaires de France, anime des groupes de réflexion sur le sujet et œuvre avec le laboratoire spécialisé de la faculté de droit de Brest. II est l'auteur d'ouvrages sur les tutelles et les curatelles. Thierry Fossier est président de chambre à la cour d'appel de Douai et professeur à l'Université d'Auvergne, où il codirige un master et l'IEJ. II est fondateur de l'Association nationale des juges d'instance, qui regroupe la grande majorité des juges des tutelles. II est l'auteur de nombreuses publications en droit de la famille et en droit des tutelles. Laurence Pécaut-Rivolier, docteur en droit, est magistrate à la Cour de cassation. Juge des tutelles pendant seize ans elle préside l'Association nationale des juges d'instance depuis plusieurs années. | |
| Puzzle, Journal d'une Alzheimer |  | | Ce livre, paru aux Éditions Josette de Lyon en 2004, a fait l'objet d'une émission d'une heure à Radio-France le 21 février 2008. Il est cité dans le préambule du rapport de la COMMISSION NATIONALE CHARGÉE DE L’ÉLABORATION DE PROPOSITIONS POUR UN PLAN NATIONAL CONCERNANT
LA MALADIE D’ALZHEIMER ET LES MALADIES APPARENTÉES. Ce rapport fut remis au Président de la République française le 8 novembre 2007.
«Je crois savoir où partent mes pensées perdues : elles s’évadent dans mon coeur…. Au fur et à mesure que mon cerveau se vide, mon coeur doit se remplir car j’éprouve des sensations et des sentiments extrêmement forts… Je voudrais pouvoir vivre le présent sans être un fardeau pour les autres et que l’on continue à me traiter avec amour et respect, comme toute personne humaine qui a des émotions et des pensées,même lorsque je semble «ailleurs »1à.
| | Les inattendus (Stock) |  | | Premier roman d'Eva Kristina Mindszenti, jeune artiste peintre née d’un père hongrois et d’une mère norvégienne, qui vit à Toulouse. Le cadre de l'oeuvre: un hôpital pour enfants, en Hongrie. «Là gisent les "inattendus", des enfants monstrueux, frappés de maladies neurologiques et de malformations héritées de Tchernobyl, que leurs parents ont abandonné. Ils gémissent, bavent, sourient, râlent, mordent parfois. Il y a des visages "toujours en souffrance" comme celui de Ferenc évoquant "le Christ à la descente de la croix". Tout est figé, tout semble mort. Pourtant, la vie palpite et la beauté s’est cachée aussi au tréfonds de ces corps suppliciés. » (Christian Authier, Eva Kristina Mindszenti : une voix inattendue, «L'Opinion indépendante», n° 2754, 12 janvier 2007) | |
| En toute sécurité |  | | Cet ouvrage est l'adaptation québécoise de Safe and secure, publié par les fondateurs du réseau PLAN (Planned Lifetime Advocacy Network) et diffusé au Québec par un groupe affilié à PLAN, Réseaux pour l'avenir. Il s'agit d'un guide pratique dont le but est d'aider à les familles à planifier l'avenir "en toute sécurité" des membres de leur famille aux prises avec un handicap. | |
| "Il faut rester dans la parade ! " - Comment vieillir sans devenir vieux |  | | Auteur : Catherine Bergman. Éditeur : Flammarion Québec, 2005. "Dominique Michel, Jacques Languirand, Jean Béliveau, Antonine Maillet, Jean Coutu, Gilles Vigneault, Hubert Reeves, ils sont une trentaine de personnalités qui, ayant dépassé l’âge de la retraite, sont restés actives et passionnées. Ils n’ont pas la prétention de donner des conseils ni de s’ériger en modèles, mais leur parcours exceptionnel donne à leur parole une valeur inestimable. Journaliste d’expérience, Catherine Bergman les interroge sur le plaisir qu’ils trouvent dans ce qu’ils font, leur militantisme et leur vision de la société ; sur leur corps, ses douleurs et la façon dont ils en prennent soin ; sur leur rapport aux autres générations, ce qu’ils ont encore à apprendre et l’héritage qu’ils souhaitent transmettre ; sur leur perception du temps et leur peur de la mort. Son livre est un petit bijou, une réflexion inspirante sur la vieillesse et l’art d’être vivant." (présentation de l'éditeur). | |
| Le temps des rites. Handicaps et handicapés |  | | Auteur : Jean-François Gomez.
Édition : Presses de l'Université Laval, 2005, 192 p.
"Il est temps aujourd’hui de modifier profondément notre regard sur les personnes handicapées et sur les « exclus » de toute catégorie, qu’ils soient ou non dans les institutions. Pour l’auteur du Temps des rites, l’occultation du symbolique, ou son déplacement en une société de « signes » qui perd peu à peu toutes formes de socialités repérable et transmissible produit des dégâts incalculables, que les travailleurs sociaux, plus que quiconque doivent intégrer dans leur réflexion.
Il faudrait s’intéresser aux rituels et aux « rites de passage » qui accompagnaient jusque là les parcours de toute vie humaine, débusquer l’existence d’une culture qui s’exprime et s’insinue dans toutes les étapes de vie. On découvrira avec étonnement que ces modèles anciens qui ont de plus en plus de la peine à se frayer une voie dans les méandres d’une société technicienne sont d’une terrible efficacité." | |
| Dépendances et protection (2006) |  | | Textes des conférences du colloque tenu le 27 janvier 2006 à l'Île Charron. Formation permanente du Barreau du Québec. Volume 238. 2006 | |  |
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
|
|
| Originaux et détraqués - Douze types québecquois 4 |
 |
| Louis Fréchette |
  |
 |
 |
 |
| Texte |
X. Dominique
I
La première fois que, tout petit enfant, je mis le pied dans l’église de Saint- Joseph-de-Lévis, j’éprouvai une émotion dont le souvenir me rend encore tout songeur.
Je ne connaissais encore, en fait d’églises, que les lointains clochers de Québec, vagues silhouettes dressées dans le ciel, ayant pour moi tout le mystérieux des nuages avec lesquels ils se confondaient souvent.
À Saint-Joseph, ces cloches sonnant à toute volée, ces hautes voûtes, ces échos solennels, cette odeur d’encens, tout m’impressionna jusqu’au ravissement.
Mais ce qui attira mon attention particulière – non seulement dans cette circonstance, mais encore chaque fois que, par la suite, j’entrai jeune encore dans la vieille église – ce n’étaient ni les sculptures du sanctuaire, ni la lampe argentée suspendue au-dessus des balustres, ni les anges joufflus copiés de Murillo qu’on voit encore dans la chapelle de la Vierge, ni le pain-bénit tout étoilé et enrubanné, ni les longues files d’enfants de choeur en surplis blancs, ni les chasubles ou les lourdes chapes rutilant au soleil, ni les hauts chandeliers de l’autel alternant avec de grands bouquets de fleurs artificielles, ni les cierges allumés, ni l’encensoir au cliquetis argentin, ni même les lustres de Noël remontés à fleur de voûte, et dont les bobèches de cuivre semblaient de loin autant de pommes d’or aussi inaccessibles que celles du jardin des Hespérides.
C’était un bijou de frégate en bois des Îles, admirablement gréée, et d’un gabarit superbe, qui, pavillon déployé, se balançait à l’une des archivoltes de la nef, cinglant, lofant, boulinant, virant à pic ou louvoyant à larges bordées, ses petites voiles blanches – ainsi que des ailes d’oiseau de neiges – se gonflant ou faisant à la brise que soulevaient les lourds vantaux ou qui se glissait par les grandes fenêtres ouvertes.
Ce que m’a fait rêver cette frégate lilliputienne!
Ce que j’ai fait de voyages à son bord aux pays bleus de l’imagination! Ce que je me suis endormi de fois dans les doux bercements de son tangage rythmique, alors que nous voguions tous deux sur les beaux lacs
d’opale qui baignent le royaume des fées!
Ce que je l’aimais, la petite frégate!
Si j’avais eu à choisir entre une couronne d’empereur, les palmes de grand poète, la fortune des Rothschild d’un côté, et la petite frégate de l’autre, j’aurais certainement choisi la petite frégate.
Cependant quelqu’un l’aimait encore plus que moi, paraît-il. C’était Dominique Guénard.
Remontons nombre d’années en arrière; à la fin du dernier siècle, si vous voulez bien.
Un jour, un Italien, échappé d’un naufrage pour ainsi dire miraculeusement, avait mis pied à terre à la Pointe-Lévi, et, reconnaissant de la protection divine à laquelle il attribuait son salut, avait offert en ex-voto, à l’église de Saint-Joseph, cette petite frégate qu’il avait fabriquée lui-même, et qui était un chef-d’oeuvre.
Cet Italien se fixa à Lévis.
Il était marin, il se fit pilote.
Marié à une jeune fille de l’endroit, il devint bientôt l’un des nôtres, – au point que, son nom de Gennaro s’étant francisé de lui-même, ses enfants s’appelèrent Guénard.
Dominique était le petit-fils de l’Italien Gennaro.
II
Comme on le pense bien, l’histoire du grand père s’était transmise religieusement dans la famille; et de même que le naufrage avait pris les proportions d’une légende miraculeuse, de même l’ex-voto du naufragé était devenu pour ses descendants une espèce de patrimoine pieux, auquel ils attribuaient toutes les influences, et pour lequel ils professaient, dans le bon sens du mot, le fétichisme le plus fervent.
Dominique surtout portait la chose jusqu’au fanatisme.
Or, il n’y avait pas que lui et moi, dans l’église de Saint-Joseph, à qui la petite frégate faisait tourner la tête.
Elle était si fine, si coquette, si élégamment cambrée, et d’une allure si crâne, que bien d’autres têtes tournaient aussi pour la regarder.
Et cela, même pendant les sermons du curé, lesquels étaient, dès cette époque, beaucoup plus longs qu’intéressants.
Le fougueux prédicateur – qui recommençait ses périodes jusqu’à dix fois de suite – avait beau déployer, suivant l’expression classique, toutes les voiles de son éloquence, les voiles du petit navire “qui n’avaient jamais navigué” lui faisaient une concurrence désastreuse, au grand détriment du salut des âmes.
Cela ne pouvait pas se tolérer longtemps.
La trop gracieuse frégate fut, un bon lundi matin, descendue de la voûte, et remisée dans les combles de la sacristie, d’où quelque adroit filou l’a fait, dit-on, disparaître depuis.
On conçoit que la famille Guénard fut sensible à ce procédé du curé.
Pour Dominique surtout, c’était un acte d’hostilité contre les siens, encore plus que la profanation d’un objet sacré, et il en conserva un ressentiment profond.
Je n’irai pas jusqu’à dire que ce fut là l’origine des cascades que subit sa raison par la suite; mais il n’en est pas moins vrai que toutes les extravagances auxquelles il se livrait dans ses périodes d’aliénation mentale se rattachaient toutes plus ou moins à la trace que cet événement avait laissée dans sa pensée.
Le côté le plus original de la folie chez Dominique Guénard était l’intermittence.
Il devenait fou et recouvrait la raison à époques fixes, aussi régulières qu’un pendule d’horloge.
Il était chaloupier de son état; à Québec, on appelle chaloupiers ceux qui font le petit cabotage sur le fleuve.
Tout l’été, depuis l’ouverture de la navigation jusqu’au départ du dernier vaisseau d’outre-mer, personne n’aurait pu découvrir chez Dominique Guénard le moindre indice d’un esprit détraqué.
Il allait, venait, vaquait à ses affaires, raisonnait comme tout le monde.
Mais sitôt son dernier touage accompli, et son accoutrement de marin encoffré pour l’hiver, il se mettait à divaguer de la façon la plus burlesque, pour ne revenir à son bon sens qu’aux premiers arrivages du printemps.
Et cela recommençait chaque année, à la même date et de la même façon.
Dès le début de ses frasques, Dominique se fabriquait une longue croix, aux bras de laquelle il faisait clouer ou attacher tout ce qu’il pouvait trouver de dorures, d’enluminures, de bouquets artificiels, de franges, de sonnettes, de bimbeloteries et de rubans de toutes couleurs.
Puis il partait en pèlerinage, pour ne rentrer chez lui le plus souvent qu’à six heures du matin.
Le long de la route, il s’arrêtait ici et là – de préférence chez les dames – et demandait des ornements pour sa croix, qu’il appelait son « étendard ».
Chacun se prêtait volontiers à sa manie, et l’étendard s’enrichissait à vue d’oeil d’un jour à l’autre.
Quand il n’y avait plus de place sur les bras de la croix, il ajoutait une nouvelle barre transversale, et cela jusqu’à ce que le fameux étendard eût pris la forme et presque les proportions d’un poteau de téléphone.
Et Dominique parcourait les rues, en brandissant ce fanion d’un nouveau genre, chantant des cantiques et prêchant ce qu’il appelait la « Croisade du Jugement ».
Il avait de longues tirades en style biblique.
Il défilait des bribes de paraboles évangéliques.
Il émaillait ses discours de textes pris par-ci par-là dans le Nouveau-Testament:
« Je suis venu parmi les miens, et ils ne m’ont pas reconnu. » « J’arriverai comme un voleur. »
« Je détruirai le temple et le rebâtirai en trois jours. » « Je suis venu apporter la guerre, et non la paix. » Et ainsi de suite.
Quelquefois il montait sur un perron, sur une corde de bois, sur un traîneau renversé, sur n’importe quoi, et alors, il devenait d’une éloquence entraînante.
Comme le prophète Élie à Ninive et saint Martin à Herbauges, il objurguait ses auditeurs de se convertir, prêchait la pénitence, prédisait des catastrophes; et, après avoir fait les descriptions les plus ébouriffantes des événements futurs les plus incohérents, il s'écriait sur un ton d'exaltation fébrile:
- Alors, les yeux comme des étoiles, les cheveux comme des comètes, lançant la foudre et les éclairs, vous me verrez dans un char de feu traîné par sept coursiers ardents, m'élever en triomphe, par delà les nuages et les arcs-en-ciel, jusqu'au plus haut des airs et des espaces!
Puis, les bras étendus, la tête en l'air, le regard perdu dans les hauteurs, comme s'il se fût regardé aller, il s'arrêtait tout à coup, et puis reprenait sur un ton familier et gouailleur:
- C'est dangereux, ça; prends garde de tomber, Dominique! Parfois les farceurs lui criaient:
- Dominique, prêche donc comme M. le curé.
Et Dominique partait, débitant mille et une insanités sur les élections de marguilliers, les charlatans, la toilette des femmes, le libéralisme et Garibaldi.
Comme il n'avait jamais pardonné au vieux curé l'affaire de la petite frégate, et que cette petite frégate constituait l'une des principales préoccupations de sa folie, on conçoit que ses pastiches de sermons n'étaient pas tout ce qu'il y avait de plus flatteur pour celui qu'il parodiait.
III
Mais ce n'était pas là sa vengeance.
Il en rêvait une autre. Il voulait réhabiliter l'ex-voto de son grand-père, en l'allant tirer du réduit où on l'avait remisé, pour l'installer dans l'église de Saint-Romuald - la paroisse voisine - à la place d'honneur qu'il avait occupée dans l'église de Saint-Joseph.
Le curé de Saint-Romuald était le vénérable M. Saxe, qui a laissé des souvenirs si vivaces et si charmants dans le coeur de tous ceux qui l'ont connu.
Aux premières atteintes de sa maladie, Dominique accourait auprès de lui, et lui faisait part de ses projets.
Le bon curé, qui connaissait son homme, n'avait garde de le contrarier.
Il souscrivait à tout, et se mettait, avec sa paroisse, à la disposition du pauvre détraqué, qui s’en retournait dans la jubilation.
Alors commençaient des courses, des voyages, des visites de jour et de nuit, dès va-et-vient à droite et à gauche, des démarches de toutes sortes et des efforts sans fin pour organiser la translation de la fameuse frégate.
Il voulait une fête dans toutes les règles, une démonstration colossale.
Les deux paroisses venant au-devant l’une de l’autre, des parrains et des marraines, des Te Deum, des banquets, des discours, des drapeaux, des flambeaux, de la musique, des cavalcades, des troupes, le canon, et le reste.
M. le curé serait invité sans doute – on ne pouvait guère lui passer devant le nez sans injure – mais bien sûr qu’il n’y viendrait point; il avait assez de coeur pour cela.
Du reste, on se passerait de lui.
Et s’il n’était pas content, il se contenterait, voilà!
Après tout, Dominique ne lui devait rien. Et caetera.
Or cette pompe, que le brave homme voyait se déployer ainsi en imagination, tout en prenant des proportions de plus en plus héroïques, subissait graduellement, dans son pauvre cerveau, des transformations plus
ou moins singulières.
Les perspectives se faussaient si bien dans son esprit, que l’objet principal de la fête y perdait entièrement son caractère primitif.
Ce n’était plus une frégate-joujou qu’il fallait transporter d’une église dans une autre, c’était un véritable vaisseau de guerre de haut bord et de fort jaugeage, monté par un équipage en chair et en os, à bord duquel devaient prendre place tous les principaux invités, depuis le gouverneur-général jusqu’à l’archevêque de Québec.
Pour ces personnages éminents l’admission allait de soi. Mais c’était pour le choix des autres – le menu fretin – que cela devenait embarrassant.
Un tel et un tel en seraient-ils ou n’en seraient-ils pas? C’était là le chiendent.
Il y avait du pour, mais aussi il y avait très souvent du contre.
Quant à celui-ci, ça ne souffrait pas de difficultés, mais il y avait son beau-frère; et ici, dame, pour une raison ou pour une autre, surgissaient des inconvénients.
Quant à celui-là, c’était une autre affaire; il n’en voulait pas du tout; mais son exclusion mécontenterait son neveu; et il tenait au neveu.
Et puis il y avait Mme Pierre et Mme Jacques, qui ne pouvaient pas se sentir.
La petite Jean, dont le père et la mère avaient des titres incontestables, mais qui avait un peu fait parler d’elle au dernier « bazar de la paroisse ». Et patati, et patata!
Tout cela l’embrouillait et le jetait dans des perplexités inextricables.
– Vacarme! si je m’écoutais, j’enverrais toute la machine se promener! s’écriait-il parfois, tout découragé.
Et la fête se remettait forcément de semaine en semaine et d’un mois à l’autre, jusqu’à ce que, le printemps arrivé, à la première voile d’outre-mer faisant son apparition dans le port de Québec, le brave Dominique eût repris sa raison, sans conserver le moindre souvenir des longues tribulations qu’il venait de traverser.
IV
Mais, à l’automne, c’était à recommencer.
La « bordée » de la Sainte-Catherine voyait reparaître Dominique, son étendard à la main, allant de porte en porte recueillir des ornements et reprendre ses prédications.
Quelquefois, par exemple, les prédications assumaient un caractère un peu moins inoffensif que celles dont j’ai parlé plus haut.
Il s’y mêlait souvent des détails personnels assez coriaces à digérer pour ceux ou celles qui étaient concernés.
La chronique scandaleuse – il y en a partout, même chez les populations confites dans les bons principes – trouvait en Dominique un engin de publicité aussi intarissable que gratuite.
Racontars de commères, cancans de faubourgs, secrets de familles, il savait tout et défilait tout, sans gêne ni scrupules, en pleine rue, et d’une voix à ameuter tout un quartier.
Il s’attaquait à tout le monde, n’avait d’égards pour personne; et une fois parti, le conseil municipal tout entier, le maire en tête, n’aurait pu l’arrêter.
Il se campait devant la demeure de la victime, et, avec son emphase d'illuminé, il s'écriait:
- Chrétiens petits et grands, prêtez l'oreille à mes paroles. Ceci est pour vous faire assavoir à tous et à chacun d'entre vous, afin que personne n'en ignore, que Michel Sauviatte dit la Galette, le voleur de poules, va être poursuivi la semaine prochaine pour avoir embrassé la femme à Libère Castonguay, derrière le hangar au père Laurent Chabot!
Ou bien:
- Sachez tous, citoyens respectables et contribuables de la Pointe-Lévi, que Calixte Robichaud a fait banqueroute deux fois à Portneuf et une fois à Rimouski, avant de venir vous vendre, à faux poids et fausses mesures, de la cassonade dont il prend la moitié dans la coulée chez Tweedle!
Ou bien encore:
- Une récompense généreuse est offerte à tout bon devin et bon devineur qui pourra nous dire où la petite Justine à Ben Lamoureux, le mangeux de lait caillé, a perdu sa crinoline, la nuit qu'elle est rentrée à cinq heures du matin par la fenêtre de sa chambre à coucher, poursuivie par le gros terre-neuve à Batoche-la-Morue!
On s'imagine les rassemblements, les éclats de rire des badauds, de même que la colère des intéressés.
Il lui en cuisait souvent, cela va s'en dire.
Plus d'une fois, il faillit se faire ébouillanter par quelque mégère, dont la patience n'était pas à la hauteur de la susceptibilité.
Un jour surtout, il revint d'une de ses excursions plus zélés que philanthropiques, avec un oeil accommodé au beurre noir, dans toutes les règles de l'art culinaire le mieux perfectionné.
L'auteur du procédé était un Français de France auquel Dominique avait demandé combien d'années le nouveau venu avait passé au bagne avant de s'établir dans le pays.
Quand notre ami trouvait la soupe trop chaude, il abandonnait la prédication, et revenait à son ancienne idée: la translation de la petite frégate à Saint-Romuald.
V
En 1864, je venais d’obtenir mon diplôme d’avocat, et comme j’avais ouvert une étude à Lévis, Dominique Guénard – je ne sais trop pourquoi – m’avait pris en amitié, et – honneur que je partageais avec mon ami Johnny Lessard, le frère du distingué directeur de l’Académie du Mont-Saint-Louis, – j’étais devenu son confident.
Il ne passait guère à ma porte sans s’arrêter pour me parler de ses plans, me faire part de ses anxiétés et me demander mon avis.
La clientèle me laissant des loisirs, je ne le rebutais pas. Au contraire, ses divagations m’amusaient, et je faisais semblant de m’intéresser à ses lubies.
Un jour, il m’arrive avec une immense liste toute préparée, écrite par je ne sais qui, et qu’il étale triomphalement sur mon pupitre.
– Tiens, mon cher petit frère, dit-il (c’était son expression habituelle), voilà le nom de tous mes invités; il n’y a ni curé ni bedeau pour me la faire changer. Faut des limites à tout; tant pis pour ceux qui seront pas contents! je me suis déjà donné assez de trouble avec cette affaire-là. M. Saxe va me prendre pour un blagueur à la fin! Faut que ça finisse, ou j’envoie tout au diable. Vacarme! j’en ai par-dessus la tête. Serre la liste dans ton safe, et prends bien garde que personne la voie, Je viendrai la chercher pour faire imprimer les invitations, aussitôt que j’aurai fixé le jour. Je m’en vas justement à Saint-Romuald pour arranger ça.
– C’est très bien, Dominique, lui dis-je; mais je ne vois pas mon nom là-dedans. Est-ce que je ne serais pas invité par hasard?
– Vacarme! mon cher petit frère du bon Dieu, tu n’y penses pas. J’ai bien mieux que ça pour toi, et je viens t’en parler.
– Qu’est-ce que c’est?
– Il faut que tu sois parrain.
– Hein? parrain de quoi?
– Parrain de la frégate.
– Ah! tu la fais baptiser?
– Beau dommage!
– Mais...
– Ah! faut pas que ça t’embête, tu sais; il n’en manque pas qui voudraient bien la place, à commencer par le docteur Blanchet. Parce qu’il est membre du parlement, tu le connais, lui faudrait tout.
– Pourquoi ne le prends-tu pas? il ferait un bon parrain.
– Je ne dis pas le contraire, mais, vois-tu, il est marié; et j’aime mieux un garçon, vacarme! çà plus de jarnigoine.
– Tu crois?
– Sans compter qu’avec la marraine, des fois, ça peut faire une match. – En effet.
– Comme de raison. Toujours Dominique, hein! – Toujours Dominique.
– Ça prend pas lui pour oublier les amis, va!
– Ça, c’est vrai.
– Eh bien, ça y est-il?
– Mais la marraine?
– Ah! oui, la marraine; eh bien...
– Est-elle choisie?
– Non, ça dépend de toi, ça; mais j’en ai deux à te proposer. – Voyons ça.
– D’abord il y a mamzelle Girouard, du haut de la paroisse, qui est bien riche; mais aussi il y a mamzelle Labarre, de Saint-Joseph, qui est bougrement plus belle.
– Eh bien, allons-y pour la plus belle.
– Je le pensais. Je t’approuve pas, mon cher petit frère, mais je te comprends, c’est mieux!
– Alors, ça y est?
– C’est bon; quand j’aurai vu M. Saxe, j’irai inviter mamzelle Labarre... À moins que t’aimes mieux y aller toi-même?
– Non, non! toi...; c’est plus de... cérémonie.
– Tu penses?
– Sans doute.
– Alors, bonjour, mon petit frère; à demain!
Et voilà Dominique dans la neige jusqu’à la cheville, son étendard claquant au vent, en route pour Saint-Romuald, une distance de deux lieues.
VI
Dire ce que le pauvre homme faisait ainsi de courses aussi inutiles que pénibles, je ne l’entreprendrai pas.
Dans les plus rudes journées de l’hiver, dans les fontes du printemps, par les froids les plus mordants comme par les pluies les plus torrentielles, on le voyait passer haletant, courbé, harassé, blanc de givre ou ruisselant d’eau, le jour, la nuit, à toute heure.
Où prenait-il le temps de manger et de dormir? je ne sais.
Une fois, je l’ai entendu, à trois heures et demie du matin, qui haranguait comme un possédé, dans un chemin de traverse, presque à un mille de toute habitation.
Le malheureux avait une mission; il lui fallait marcher; il était commandé, prétendait-il.
Mon père lui dit un jour:
– Mais, mon pauvre Dominique, vous vous morfondez; allez donc vous sécher et vous reposer; à ce régime-là, vous prendrez quelque maladie mortelle.
– Eh!... mon cher petit frère, répondit-il, je ne demande pas mieux, si vous voulez prendre ma place!
La proposition n’était pas assez alléchante; mon père n’insista pas.
Mon brave père, il fut réveillé en sursaut, dans la nuit qui suivit le départ – dont je viens de parler – de Dominique pour Saint-Romuald. Quelqu’un carillonnait à la porte, à deux heures du matin.
Il alla ouvrir: c’était Dominique qui demandait à parler à « l’avocat ». Mon père n’était pas la patience incarnée, mais il avait la pitié de toutes les infortunes; il n’eut même pas la pensée de s’impatienter, et vint
m’éveiller en souriant.
J’étais un peu plus agacé que lui; mais il fallait nous débarrasser de l’importun, et je descendis.
Jour de ma vie! je n’oublierai jamais l’ahurissement de mon père quand il entendit Dominique me dire à brûle-pourpoint:
– Mon petit frère, faut pas t’occuper ni de la petite Labarre qu’a pas le sou, ni de la petite Girouard qu’est laide comme dix-neuf péchés capitaux.
J'ai ton affaire: mamzelle Maguire, de Tréchemin. C'est une Irlandaise, mais, vacarme! ça bat quatre as, sous tous les rapports. Le baptême d'abord, et le mariage ensuite!
J'eus toutes les peines du monde à faire comprendre à mon père ce dont il s'agissait.
La dernière phrase, surtout, l'avait abasourdi.
Ce que cette affaire de marraine donna de mal à Dominique, on s'en doute un peu.
Bref, de retard en retard, de désappointement en désappointement, le printemps arriva, et le pauvre détraqué oublia momentanément ses rêves, pour reprendre sa vie d'homme sensé avec ses occupations journalières de l'été.
VII
Des circonstances m'entraînèrent loin de ma ville natale; je ne le revis plus.
Mais il était survenu, dans l'intervalle, d'autres incidents que je veux raconter.
Mon bureau avait l'avantage de posséder un clerc-étudiant qui aurait pu rendre des points aux rapins d'Eugène Sue, non seulement pour agacer les pipelets de toute espèce, mais encore pour s'amuser du matin au soir aux dépens de n'importe qui lui semblait « une tête à ça ».
Tout ce qui résultait en fun, suivant son expression reçue et surtout pratiquée, lui semblait d'une légitimité incontestable.
Une fois, en mon absence - j'ose à peine dire que j'étais allé plaider une cause - un tapissier était en frais de donner à mon bureau une tournure d'élégance à laquelle celui-ci n'était pas habitué, et qui attestait le sérieux de mes ambitions professionnelles.
Tout à coup Dominique fait son entrée avec un air de satisfaction absolument inaccoutumé.
- Tout est décidé! s'écrie-t-il; tout est réglé! le grand jour est fixé; la fête aura lieu dans deux semaines... Hourra!...
Et l’étendard, brandi d’un bras trop enthousiaste, va s’écrabouiller au plafond.
Il fallait réparer le désastre.
Mon clerc et le tapissier s’y mirent en riant, et bientôt ça n’y parut plus. – Mais, j’y songe, dit mon clerc, quel rôle vous êtes-vous réservé pour vous-même dans la procession, Dominique?
– Moi? parbleu, je suis capitaine de la frégate. – Avez-vous un uniforme?
– Un uniforme?
– Oui.
– En faut-il un?
– Dame, un capitaine de frégate!
– Vous avez raison, vacarme! j’avais pas pensé à ça, moi. – En faudrait un.
– En faudrait un; mais, cher petit frère, ça coûte cher, ça!
– Bah! je connais quelqu’un qui vous en fera un avec plaisir, tenez! – Qui donc?
– Moi-même.
– Tout de bon?
– Parole d’honneur!
– Cher petit frère, vous me sauvez la vie.
– Et ça ne prendra pas grand temps, vous allez voir. Nous allons vous fabriquer des épaulettes d’abord.
– Des épaulettes?
– Certainement, des épaulettes; un capitaine de frégate doit avoir des épaulettes.
– C’est pourtant vrai!
– Soyez tranquille, en deux minutes, c’est fait.
Le papier dont mon tapissier se servait était de couleur rouge et or; c’était la mode du temps, et cela secondait admirablement les projets de mon loustic.
Vite, sans aucun autre souci que le fun, toujours, voilà mon garnement qui s’empare des rouleaux, taille les pièces, y découpe de larges banderoles qu’il frange à coups de ciseaux et frise avec un coupe-papier, en fait d’énormes masses touffues, rutilantes, grouillantes, qu’il attache aux épaules de Dominique campé et gourmé dans les attitudes les plus invraisemblables.
– Vacarme! disait-il, hourra pour Dominique! je vas faire honte au gouverneur.
– Ce n’est pas tout, attendez un peu, fit mon clerc. – Quoi encore?
– Mais le plumet! il faut un plumet; un capitaine de frégate doit avoir un plumet.
– Vous avez raison, vacarme! il faut un plumet!
Et voilà un panache monumental qui s’élève à triple étage sur la tête de Dominique pâmé d’aise.
Et puis les écharpes, les, bandoulières en sautoir, le fronteau, le ceinturon, les pendants, les brassards, les genouillères, que sais-je?
Bref, Dominique n’était plus un être humain, c’était une gigantesque papillote, pourpre et or, crêpelée, bouclée, frisottée, boudinée, tire-bouchonnée, dont les touffes massives et les longues mèches éparses, hérissées ou flottantes, crépitaient et crissaient, avec les mille flou-flou et cric-crac du papier empesé qu’on secoue et qu’on froisse.
On ne lui voyait plus que les yeux.
Lui-même ne se serait pas reconnu devant un miroir.
– Vacarme! s’écriait-il, M. le curé a encore jamais été doré d’un bout à l’autre comme ça. Monseigneur va avoir l’air d’un sauteux d’escalier, à côté de moi!
Mais la scène ne finit pas là.
Des jeunes gens avaient joué la comédie quelques jours auparavant; on leur emprunte une épée, une grande colichemarde de bois recouverte en papier de plomb, qu’on attache autour des reins de Dominique; et voilà mon homme se disposant à partir, marchant à pas carrés, secouant furieusement son étendard, et lançant mille vacarme triomphants, lorsque survint un nouveau personnage.
C’était un jeune marchand de l’endroit nommé Philémon Bazin – un autre farceur – qui arrivait à cheval, monté sur une petite jument fringante dont il avait peine à contenir les cabrioles et à prévenir les écarts.
Les deux fumistes se complétaient: une idée infernale leur passa tout naturellement par la tête. Il n’est pas possible de laisser un homme aller à pied dans un pareil accoutrement.
On eut bientôt fait de persuader la victime; et, après quelques précautions préliminaires sous forme d’un ou deux verres de whisky, on le hisse à force de bras sur le dos de la bête, qui se cabre, effrayée et chatouillée par le contact et le bruit de cette masse de papier frisé lui battant la croupe et les flancs.
On avait bien l’intention, je crois, de conduire l’animal par la bride; mais Dominique ayant trop fait projeter son étendard en avant, la petite jument, épeurée, d’un bond fait lâcher prise à celui qui la retenait; et, au moment même où je tournais le coin de la rue pour entrer à mon bureau, je la vois se précipiter ventre à terre et faisant feu des quatre pieds, Dominique attaché à sa crinière, secoué comme une mitaine et hurlant d’épouvante.
Un malheur paraissait imminent.
Heureusement, la scène avait lieu dans une montée assez raide, ce qui permit aux passants de barrer la route à la bête et de modérer son allure.
Dominique n’en roula pas moins à la renverse sur le macadam verglassé; mais tout le papier dont il était enveloppé ayant fait tampon, il se releva sans aucun mal.
– Vacarme! s’écria-t-il en reprenant son aplomb, ces gens-là sont fous. Si je suis capitaine de frégate, c’est pas pour courir les routes à cheval! Au diable la cavalerie! vive la marine!
Le soir, il y avait réunion triste chez un citoyen d’Hadlow-Cove.
On y veillait un mort; un vieillard trépassé du matin.
Vers onze heures, pendant qu’on était à dire le chapelet, voilà la porte qui s’ouvre et laisse passer d’abord la vaste machine que Dominique appelait son étendard, puis Dominique lui-même, en costume complet, auquel un autre farceur avait même ajouté trois plumes de paon fichées au centre de son panache.
Après s’être péniblement faufilé tant bien que mal à l’intérieur, le brave garçon alla s’agenouiller gravement aux pieds du corps.
D’abord il y eut stupéfaction; mais un enfant ayant eu le malheur d’éclater de rire, la solennité du lieu et de la circonstance n’y put rien. Ce fut une explosion et un sauve-qui-peut général.
Vous voyez d’ici Dominique, avec sa montagne de frisures, son épée et ses trois plumes de paon, seul auprès du cadavre, pendant que tout le monde se tient les côtes et pouffe à mort dans une chambre voisine!
VIII
On en parla longtemps.
Mais on pardonnait tout au pauvre garçon, qui, même lorsqu’il pratiquait d’impitoyables accrocs dans le voile de la vie privée, croyait obéir aux voix d’en haut, et n’avait pas l’ombre d’un sentiment malicieux.
Ces voix d’en haut – sa « mission », comme il disait – ne lui laissaient aucun repos.
Même lorsqu’il était le plus absorbé dans l’organisation de cette fête qui faisait la principale préoccupation de sa folie, il était parfois brusquement détourné de sa voie par je ne sais quelles aberrations mystiques où se noyaient les dernières lueurs de sa raison.
Un jour, au moment où j’allais fermer mon bureau, pour aller respirer une atmosphère plus en rapport avec mes goûts, Dominique entra. Il était pénible à voir.
C’était par une de ces journées d’avril où la neige boueuse change les routes en fondrières; et le malheureux, dont les genoux crevaient le pantalon délabré, suant et grelottant à la fois, flottait presque dans ses bottes où l’eau giclait par les déchirures.
Il était tellement fatigué qu’il avait peine à mettre un pied devant l’autre. C’était une pitié.
– Mon pauvre Dominique, lui dis-je, d’où viens-tu donc en cet état? Tu es à moitié mort. Oh! la la!...
– Mon cher petit frère, me répondit-il en s’affaissant sur une chaise, t’as raison de me plaindre, va! Je viens de subir ma passion. – Ta passion?
– Oui, et je te souhaite bien de jamais faire le même chemin. – Qu’est-ce que tu veux dire?
– Dame, ce que je veux dire, c’est que les Juifs m’ont pris, à mon tour; et, vacarme! y a pas eu à tortiller, il a bien fallu porter ma croix, comme l’autre.
– Où as-tu été comme ça?
– Jusqu’au Calvaire, donc!
– Est-ce bien loin?
– Au diable vert, derrière chez le bonhomme Baptiste Canne, à Arlaka. – Cristi! ça fait un non bout de chemin!
– J’te crois! et puis y avait mon pendard de Simon, là, qui me laissait tout faire.
– Quel Simon?
– Le Cyrénéen! Un véreux qui m’a pas aidé pour la peine. Un feignant numéro un, j’te le dis!
– Tu t’en es tiré tout de même?
– A bien fallu. Pour marcher, ça allait encore; mais c’est les chutes qui m’éreintaient. Trois chutes! à quatre pattes! dans la boitte! tu vois ça?... Vacarme! ris pas!.. j’aurais ben voulu te voir à ma place!...
Le fait est que mon sérieux m’échappait de temps en temps malgré tous mes efforts pour le garder.
– Mon petit frère, écoute! reprit Dominique; les Juifs je m’en fichais pas mal, tu comprends; mais c’étaient les boufresses de saintes femmes qui m’embêtaient.
– Vraiment?
– Comme de raison! des braillardes! Et puis, tu me connais, ça prend pas avec moi ces manières-là: Ils appellent ça des filles de Jérusalem. Eh bien, je leux ai dit: quand même vous seriez des filles de par chez nous, mêlez-vous de vos affaires! En voilà une conduite!...
– Et tu es arrivé enfin?
– Oui, comme j’ai pu.
– Et l’on t’a crucifié?
– Ils ont pas osé; mais, mon cher petit frère, j’ai autant souffert. Je te dis que le Ponce-Pilate aura un chien de ma chienne un de ces jours. C’est le dernier voyage qu’il me fait faire comme ça!...
Pauvre Dominique, il a été une des gaietés de ma jeunesse. Il m’a aimé... durant l’hiver, au moins. Je lui en sais gré.
Il ne s’imaginait pas que j’écrirais jamais son histoire. Ni moi non plus. Ainsi va le monde.
Quant à la petite frégate, subtilisée.
Où est-elle?
S’est-elle vendue cher?
Je ne sais; mais si je la revoyais, rien ne pourrait réveiller plus vivement mes souvenirs d’enfance.
Cela me rajeunirait de cinquante ans!
XI. Burns
I
Avais-je complètement oublié Burns, pendant mon séjour aux États-Unis – de 1866 à 1871 – ou bien ne l’avais-je jamais connu ?
C’est ce que je n’oserais sérieusement affirmer.
Il est assez probable que j’en avais seulement entendu parler, et que le souvenir m’en était resté très vaguement dans la mémoire.
Avez-vous remarqué que les individus les plus excentriques, de même que les événements les plus extraordinaires ne vous frappent guère et ne vous laissent aucune impression spéciale quand vous êtes enfant ?
Dans votre inexpérience de la vie, vous croyez ces choses-là d’occurrence journalière, et elles ne vous surprennent point.
Tout jeune bébé, je vis un homme du nom de Marceau, ayant à chaque main deux petits doigts qui semblaient avoir poussé comme des branches à la deuxième phalange de l’index et de l’annulaire.
Je jouai avec ces petits monstres, sans soupçonner un instant que j’étais en présence d’un phénomène.
Quand, en 1849, la fameuse « cage de la Corriveau » fut exhumée sous mes yeux, dans le cimetière de Saint-Joseph-de-Lévis, mes camarades et moi nous manipulâmes à notre gré la lugubre relique, sans l’ombre d’une émotion, et sans la moindre idée que c’était là une des curiosités de notre histoire.
On ne se rend bien compte de ces choses que plus tard.
Cela peut expliquer comment il se faisait que je n’eusse pas conservé la mémoire de Burns, si remarquable que fût le personnage.
Quoi qu’il en soit, voici en quelles circonstances j’eus l’avantage de faire sa connaissance définitive.
J’habitais Chicago, et j’étais en promenade dans mon pays – promenade qui dure encore, par parenthèse – et, pour ainsi dire mon sac de voyage à la main, j’avais posé ma candidature à Lévis, aux élections de 1871.
Pour avoir un pied-à-terre dans la circonscription, je m’étais installé à titre d’associé, dans l’étude d’un jeune avocat débutant, qui est décédé depuis.
Ma vieille enseigne – l’enseigne à lettres d’or, admirée, lorgnée et contemplée avec une si naïve satisfaction, durant les premiers mois d’exercice professionnel – ma vieille enseigne, retrouvée au fond d’un grenier, avait été clouée au-dessus de la porte extérieure, à l’endroit le plus apparent de la façade ; et, en moins de quinze jours, grâce aux discours de hustings, dont nos compatriotes sont si friands, la popularité, sinon la clientèle, commençait à me sourire.
Quand on arrive des Etats-Unis, et qu’on brigue ainsi à brûle-pourpoint le suffrage des électeurs pour un siège en parlement – dans une division électorale comme Lévis, surtout – on passe nécessairement pour riche.
Et les électeurs intéressés affluaient, chacun me vantant le plus éloquemment possible son dévouement à mes intérêts, mais surtout son influence dans sa localité.
Je les écoutais patiemment, ayant l’air de tout gober ; mais, au point de vue pratique, quand arrivait le quart d’heure de Rabelais, je me montrais quelque peu dur à la détente, et pour cause.
Cela désappointait un peu certains chauds partisans des amis dévoués que je n’avais encore ni vus ni connus ; mais j’en entendais d’autres – plus malins évidemment – qui murmuraient, une fois passé le seuil de la porte:
– Laissons-le faire ; c’est un fin merle ; il garde ça pour les derniers jours ; nous reviendrons.
Et je me disais:
– Dans quel guêpier suis-je donc venu me fourrer sans la moindre nécessité, mon Dieu !...
II
Un matin, je vis une voiture de place s’arrêter à ma porte, et un personnage plein de gravité et d’importance descendre du marchepied, en faisant signe à son cocher de l’attendre.
C’était un grand gaillard à moustaches brunes, avec des favoris en côtelettes et un monocle solidement encadré dans l’arcade sourcillière.
Il portait un pantalon gris, une redingote noire et un chapeau de soie haut de forme.
La tête en l’air, la canne à la main, il marchait d’un pas dégagé, avec l’aplomb d’un homme sûr de lui-même et de l’effet qu’il ne peut manquer de produire.
À certaine distance, on pouvait facilement le prendre pour un homme distingué ; et, ma foi, j’allais tomber dans le panneau, lorsqu’à certains indices qui ne trompent guère – coudes râpés, taches au gilet, chapeau plus ou moins éraflé, bordure terre de Sienne fondue autour du col et des manchettes – j’eus bientôt deviné à quelle couche sociale appartenait le nouveau venu.
Certain résidu d’un jaune noirâtre mal essuyé aux coins de la bouche, et quelques petits courants rouges faisant réseau dans la cornée de l’œil achevèrent de me fixer.
J’avais affaire à l’un de ces déclassés, réfractaires à la discipline sociale, qui, bien que nés dans un monde quelconque, ont laissé tout orgueil au fond du verre, pour ne vivre que d’expédients, en véritables escrocs, ou tout au moins en parasites avérés.
Le nouvel arrivé s’approcha ou plutôt se précipita vers moi, la main tendue et la figure épanouie, en s’écriant :
– Allons, allons, allons, ce cher Louis ! comment ça va-t-il !
– Mais... très bien, fis-je en hésitant devant cette effusion inattendue.
– On vient justement de m’apprendre que tu étais de retour au pays, reprit le nouveau venu ; et j’accours de Québec exprès pour te serrer la main.
– Merci !
– Le vieux pays, n’est-ce pas ? on aime toujours à y revenir ; c’est bien naturel.
– En effet.
– Ne parle pas, tiens ! laisse-moi te regarder ! C’est épatant, toujours le même, pas changé du tout !... Ce cher ami, dire qu’il y a si longtemps que nous nous sommes rencontrés !
– Quelques années au moins, n’est-ce pas ?
– Eh oui, plusieurs années même ; ma parole ! tu ne te figures pas le plaisir que j’ai de revoir un vieux de la vieille comme toi. J’étais littéralement abasourdi.
– Te souviens-tu, ajouta mon homme, des vingt piastres que je t’ai prêtées quand tu es parti ?
– Ma foi...
Et j’hésitais, de plus en plus interloqué.
– Non, n’est-ce pas ?... C’est bien possible. On avait pris quelques petits verres ensemble... pas surprenant. Du reste, ça ne fait rien, va ! Pas la peine d’en parler, et je ne suis pas venu pour ça.
– Ah ! fis-je un peu rassuré.
– Non, non, c’est inutile, ne parlons pas de ces cinq sous là. Tu me connais, tu sais bien que je ne m’occupe pas de semblables bagatelles, voyons... Ce cher Louis !
– Mais...
– Y a-t-il longtemps que tu as vu la petite Lucette ? – La petite Lucette, dame...
– Toujours la même, elle aussi, tu sais ; grosse et grasse, meilleure musicienne que jamais, et pas encore mariée ! C’est toi qui lui as fait joliment du tort à cette enfant-là.
– Comment cela ? fis-je un peu flatté tout de même.
– Tu le sais bien, hypocrite ! s’écria mon inconnu avec un geste qui chatouilla agréablement ma fatuité, je l’avoue. Nous irons la voir ensemble, si tu veux, continua-t-il. Ça lui fera bien plaisir.
– Mais...
– La bonne petite Lucette !... Moi, c’était la mère que je cultivais, à cette époque-là. Comme le temps passe vite, hein !... Allons, viens à l’hôtel avec moi, je te paie le champagne !
Et mon singulier interlocuteur parlait, parlait, sans attendre de réponses, sans prendre haleine, intarissable, me tapant sur l’épaule et me serrant les deux mains avec une effusion délirante.
Je vous l’ai dit au commencement, je ne sais si j’avais jamais vu Burns avant cette rencontre – car c’était Burns, je l’appris plus tard – mais une chose bien certaine, c’est que nous n’avions jamais été ensemble, non seulement sur un pareil pied d’intimité, mais encore sur un pied commun quelconque.
Encore moins avais-je jamais eu l’occasion de lui emprunter cent francs. Il me faisait, en tout cas, l’effet d’un parfait étranger.
Pas la moindre réminiscence d’avoir vu ce type-là ni à Québec ni ailleurs !
D’abord, cette familiarité m’intrigua.
Puis, je me demandai si j’avais affaire à un maniaque, et enfin, si je n’étais pas le jouet de quelque fumiste qui s’amusait à me faire poser.
Son assurance avait été telle, au premier abord, que je m’étais prêté passivement, mais assez volontiers, à ses accolades, me défiant de ma mémoire, et craignant – en temps d’élection, voyez-vous... – d’offenser un homme qui avait l’air de me porter un si vif intérêt, une affection si débordante.
Et puis, une fois compromis par un semblant de reconnaissance, je ne pouvais plus guère reculer et décemment lui demander son nom.
Les vingt dollars me mettaient bien un peu la puce à l’oreille ; mais il pouvait y avoir méprise d’identité.
D’un autre côté, je me rappelais fort bien la petite Lucette, ce qui ne me permettait pas de m’arrêter à cette hypothèse.
En somme, j’étais on ne peut plus perplexe, et je me battais les flancs pour trouver quelque chose à dire, ne sachant quel parti prendre, lorsque, feignant de s’apercevoir de mon embarras, l’ami Burns s’écria sur le ton de la plus extrême surprise :
– Mais, nom d’un petit bonhomme ! tu me regardes curieusement ; est-ce que tu ne me reconnaîtrais pas par hasard ?
Alors j’eus une lâcheté que la politique seule pouvait faire excuser :
– Si, si ! dis-je ; comment donc ! Je suis un peu distrait, voilà tout.
– Ah ! je comprends, ton élection ! Eh bien, est-ce que ça va, ton élection ?
– Dame, oui, je ne me plains pas ; le parti se forme ; il y a de l’enthousiasme.
– Eh bien, mon cher Louis, autant te le dire tout de suite, c’est là une des raisons qui m’amènent auprès de toi.
– Vraiment ?
Je commençais à voir venir.
– Oui, mon vieux ; je te disais tout à l’heure que j’avais fait le voyage de Lévis pour te serrer la main, c’était vrai; mais il y avait autre chose. – Quoi donc ?
– Une affaire de femme.
– Quelle femme ?
– Ah ! ça, tu en demandes trop ; en gentilhomme, tu comprends... – Oui, mais enfin...
– Enfin, voici : il s’agit d’une des femmes les plus haut placées de Québec. Suppose que c’est la femme d’un ministre ; en tout cas, une bigre de jolie femme, mon gaillard, je ne t’en dis pas plus long. Elle prétend détester à mort ton adversaire le docteur Blanchet ; mais je sais mieux que ça, moi, tu comprends. Elle t’a entendu parler en public dimanche, et elle est folle de toi, c’est tout clair. De sorte qu’elle veut te faire gagner ton élection à tout prix, et c’est elle qui m’envoie ici pour cela.
– Ah !
– Oui, il y a quelque chose qui peut te faire gagner ton élection infailliblement.
– Qu’est-ce donc ?
– Sapristi, comme tu y vas ! ça ne se dit pas comme ça. – Pourquoi ?
– Parce qu’il faut d’abord le savoir.
– Vous ne le savez pas ?
– Eh non ! c’est un secret qu’il me faut acheter. Je voyais venir de plus en plus.
– Oui, qu’il faut acheter, continua Burns. Mais ça ne coûtera pas cher, une bagatelle seulement. Je connais très bien l’individu ; il ne sera pas exigeant, une vingtaine de piastres tout au plus. Aboule-moi vingt piastres, et ça y est !
Je savais enfin à quoi m’en tenir.
Ayant du temps à perdre ce matin-là, je me payai le luxe d’étudier un peu ce caractère digne de Molière.
Je le fis rabattre de vingt à quinze piastres, de quinze à dix, de dix à cinq, de cinq à une, et enfin à vingt-cinq sous, « seulement pour payer son cocher », disait-il, car, étant parti à l’improviste, il avait malheureusement oublié – tout préoccupé qu’il était – son porte-monnaie sur sa table de toilette.
Il en était même très inquiet, car ce porte-monnaie contenait certains chèques payables au porteur, et puis... enfin !
– Voyons, Louis, penses-y donc ! s’écria-t-il en désespoir de cause ; une élection sûre pour vingt-cinq cents, c’est pour rien, avoue-le !
– Je sais, je sais, fis-je en m’arc-boutant ; mais je suis à cheval sur les principes, voyez-vous. Je ne veux devoir mon succès qu’à la justice de ma cause !
Une phrase, entre parenthèse, qui me fit plaisir.
– Eh bien, tu vas perdre ! déclara Burns en prenant congé ; franchement ça me fait de la peine. Voyons, pas dix cents seulement ! – Non !
Et Burns, après un haussement d’épaules des plus significatifs, remonta en voiture, et je l’entendis qui disait au cocher :
– Chez le docteur Blanchet !
III
Ce Burns était un type véritablement étonnant.
Durant plus de trente ans il a vécu d’emprunts, – et quand je dis d’emprunts, c’est pour me servir de son expression, car ses emprunts auraient pu quelquefois mériter un terme beaucoup plus sévère.
Pour effectuer ces emprunts, qui d’abord variaient de cinq à un dollar, puis d’un dollar à un écu, et enfin, sur les dernières années, de cinq à vingt-cinq sous, cet individu – on peut l’affirmer hardiment – a dépensé plus d’ingéniosité et de persévérance que Vanderbilt ou Astor pour amasser leurs millions.
Il avait fait un cours d’études assez complet au séminaire de Québec, je crois.
Puis il avait commencé à faire son droit.
Malheureusement, une paresse à triple pression, de même que des tendances toutes spéciales à faire la noce, entravèrent sérieusement sa carrière légale.
Quelques années après, on le retrouve occupant un emploi quelconque – celui de grossoyeur probablement, car il était doué d’un singulier talent de calligraphe – au palais de justice de Québec.
Cet emploi il ne l’occupa que très peu de temps, les mêmes causes qui avaient fait échouer ses ambitions professionnelles étant venues s’opposer de nouveau aux succès qui l’attendaient sans doute dans sa nouvelle position.
Bref, de désappointement en dégringolade et de dégringolade en désappointement, notre Jérôme Paturot, ayant vu toutes les carrières plus lucratives se fermer devant lui, avait tourné ses aspirations vers l’emprunt ; et tous les moments que lui laissait libres sa fidélité inébranlable au culte du dieu de la treille, il les consacrait, avec la plus consciencieuse assiduité, à l’étude et à la pratique de cette nouvelle industrie.
Ce culte de Bacchus et cette industrie de l’emprunt se partagèrent son existence.
Si bien, qu’ils avaient fini par lui mériter un double sobriquet bien caractéristique : Trente-sous Burns et Whisky Burns !
Laissons Whisky Burns de côté, pour ne nous occuper que de Trente-sous Burns.
Aussi bien, le premier avait-il à cette époque et possède-t-il encore, autant ailleurs qu’à Québec, trop de rivaux, et des plus marquants, pour qu’on puisse le considérer comme un type digne d’une monographie spéciale.
Quand à Trente-sous Burns, par exemple, celui-là n’a jamais eu et probablement n’aura jamais de compétiteur sérieux.
Ce fut l’Alexandre le Grand et l’Homère de l’emprunt. Le sommet classique au-delà duquel il n’y a plus rien.
Le nombre de dupes que son inénarrable aplomb a faites dans Québec et dans tout le district est incalculable.
Et, chose encore plus extraordinaire que son aplomb, c’était la variété de ses ressources.
Chez lui point de lieux communs.
Il tenait à sa réputation d’habileté, mais aussi d’homme à moyens. Il se piquait d’originalité.
Il travaillait par intérêt sans doute, mais il semblait aussi travailler pour l’honneur du nom.
IV
La formule ordinaire : « Veuillez donc me prêter un écu » lui semblait d’une vulgarité tout à fait indigne d’un virtuose de son envergure.
De la variété dans les procédés, des combinaisons savantes, voilà ce qu’il lui fallait.
Il avait cependant un truc préféré, auquel il revenait quelquefois, quand il se sentait à court d’imagination.
Les plus grands génies ont – chacun le sait – de ces moments de pénurie intellectuelle.
C’est ce qui s’appelle en termes de journalisme moderne « être vidé ».
Dans ces moments-là, Burns visait une maison où il se présumait inconnu, recueillait du voisinage toutes les informations possibles relatives à ses habitants ; puis, muni de renseignements détaillés, il guettait l’instant où le chef de la famille était sorti, se présentait à la porte, la canne à la main et le chapeau haut de forme au bout du bras, se faisait introduire, et s’adressant à la maîtresse de la maison:
– Je vous demande bien pardon, Madame, disait-il ; je sais qu’Eugène est absent ; mais, si vous voulez bien me le permettre, je vais l’attendre une minute. C’est lui-même qui m’a dit d’agir avec vous sans cérémonie.
– Mais certainement, Monsieur, répondait la bonne dame, vous êtes chez vous ; ayez la complaisance de vous asseoir.
Alors Burns prenait un siège, et la conversation s’engageait.
Il était un des grands amis du mari, disait-il ; mais comme il avait voyagé depuis plusieurs années, rien d’étonnant qu’il n’eût pas l’honneur de connaître madame.
Et il entrait dans tant de détails intimes, que son histoire paraissait on ne peut plus vraisemblable.
Tout à coup il feignait de s’être oublié, et regardait à sa montre.
– Mais, sapristi ! s’écriait-il, ce diable d’Eugène n’arrive toujours pas... – Êtes-vous sûr qu’il va rentrer ?
– Mais sans doute. Je le quitte à l’instant. Il m’a dit : « Entre en passant chez moi ; j’y serai dans deux minutes ; le temps de faire changer ; je te paierai ça là. » Il devrait se presser un peu plus ; ce n’est pas la peine de faire attendre un homme pour une bagatelle pareille.
Et il faisait semblant de prendre patience.
Enfin, après encore une dizaine de minutes d’attente, il se levait avec des airs de mauvaise humeur marquée, en disant :
– Ah ! par exemple, c’est trop fort. Ce gaillard-là va me faire manquer mon train. Je regrette réellement, Madame, de me laisser aller à l’impatience devant vous, mais si Eugène a voulu me mystifier, je ne l’en remercie point !
– De quoi s’agit-il donc, Monsieur ?
– Eh ! Madame, j’ai honte d’en parler ; un rien du tout ; un simple écu. Cela vaut-il la peine de faire poser un ami comme moi ? Qu’il le garde, son écu, s’il est assez indélicat pour user de pareils procédés envers ceux qui lui prêtent de l’argent.
Et il faisait mine de s’en aller très mécontent.
– Mais, Monsieur, s’écriait la femme du malheureux Eugène, s’il ne s’agit que de cela, je vous demande pardon de vous avoir fait attendre ; le voici, votre écu ! Il y a malentendu sans doute.
– Merci, Madame, disait Burns ; je ne refuse pas de profiter de votre obligeance, car je suis pressé. Mais Eugène ne devrait pas exposer ses amis à des humiliations de ce genre. Non, vrai, ça n’est pas de bonne compagnie !
Et, après avoir salué avec des airs de dignité offensée, Burns filait en glissant l’écu dans sa poche.
Mais, si souvent que lui servît ce truc, c’était là seulement le thème. Il fallait voir les variations !
Elles se multipliaient à l’infini.
Quand au chiffre de l’emprunt, il variait aussi – depuis cinq jusqu’à soixante-quinze sous – suivant la fortune des gens, et selon qu’ils paraissaient plus ou moins susceptibles d’exploitation.
Ce stratagème lui réussissait presque toujours ; mais, je le répète, Burns avait dans sa profession une conscience d’artiste, et préférait quelque chose de plus ingénieux.
V
Une fois – c’était à l’époque où j’étais député de Lévis – il aperçoit, sur le pont du Québec, mon père qui s’embarquait pour Montréal.
Il saute sur la passerelle, l’air très affairé, et tout à fait pressé. – Fréchette est-il à bord ? demande-t-il à l’homme de quart. – M. Fréchette père ?
– Non, le député.
– Je ne l’ai pas vu.
– Il m’avait pourtant promis d’être ici avant moi, fit-il avec un geste d’impatience.
Et il attendit.
Tout à coup :
– Sapristi ! s’écrie-t-il, il y a des gens bien ennuyeux ! En voilà des tours à jouer, par exemple. Il devait venir rencontrer son père au départ du bateau, et je vois bien que c’est de la blague... S’il m’y reprend...
– Pardon, Monsieur, vous attendez mon fils ? fit mon père en s’approchant.
– C’est votre fils, Louis Fréchette, le député ? – Oui, Monsieur.
– Alors, Monsieur, je vous demande pardon pour ce que je viens de dire. Il y a au moins un peu de vrai dans ce qu’il m’a raconté.
– Au fait, de quoi s’agit-il ? demanda mon père, que ces manières commençaient à agacer.
– Vraiment, je ne sais, Monsieur, si je dois...
– Allez, ne vous gênez pas.
– Eh bien, voici, Monsieur. Lui et moi, nous avons passé l’après-midi ensemble chez le notaire Guay, dans le faubourg Saint-Roch, par affaires. En revenant, il s’arrête chez M. Garneau, le marchand de la rue Saint-Pierre, et me dit : « File avec la voiture, porte la valise au Mountain Hill, et viens me rejoindre au steamboat, je paierai le cocher là. » Je l’ai cru naturellement, et me voilà dans de beaux draps : la voiture sur les bras, et pas un sou dans ma poche ! Quand à ce que je lui ai prêté, je n’en suis pas inquiet ; je sais bien qu’il me le rendra. Mais qui va payer le cocher, en attendant ?
– Il sera sans doute ici dans un instant, fit mon père.
– Bigre d’instant ! s’écria Burns. Voilà près d’une demi-heure que je l’attends sur le quai avec la voiture. Le cocher s’impatiente, et de mon côté je n’ai pas que ça à faire. Le farceur n’est pas près de m’embêter de cette façon, je n’ai que ça à vous dire !
– Qu’est-ce qu’il réclame donc, ce cocher ?
– Ah ! une bagatelle seulement : soixante-quinze sous. Si c’était une somme au moins... mais quand on ne l’a point, n’est-ce pas... Qu’il y revienne, le satané blagueur !...
– Mais, mon cher monsieur, dit mon père, Louis est un honnête homme. S’il vous a trompé, c’est involontairement, j’en suis certain. Du reste, voici les soixante-quinze sous, allez payer votre cocher.
– Ma foi, Monsieur, j’accepte parce que c’est vous, fit maître Burns ; mais si Louis arrive après mon départ, vous pouvez lui dire qu’on ne me joue pas deux fois de cette manière-là.
Vous vous imaginez si j’eus beau à taquiner mon pauvre père, quand il me parla des soixante-quinze sous qu’il avait ainsi donnés pour moi.
Je n’avais appris sa courte apparition à Québec que le lendemain de son départ.
Cette course chez un notaire de Saint-Roch, cette station chez M. Garneau, cette valise, ce cocher, est-il besoin de dire que tout cela était de l’invention de Burns ?
Quelques instants lui avaient suffi pour combiner toute cette histoire !
VI
Un jour, il entre dans le magasin de M. Renaud, au Palais, va tout droit à la fenêtre du fond, qui donnait sur le port, et l’ouvre en disant :
– Monsieur Renaud, venez voir ce hareng-là !
M. Renaud s’approche.
– C’est du hareng, ça, monsieur Renaud ! continue Burns, en indiquant des barils qu’on est en train de rouler sur la jetée. Du hareng comme vous en avez pas vu à Québec depuis longtemps, monsieur Renaud, prenez ma parole ! Pour la première fois que je vous sers, je veux que vous soyez satisfait comme vous l’avez jamais été. Vous voyez ma goélette ? Pleine, Monsieur, pleine !... Y a longtemps que je veux vous vendre... Mon ami Vincent Gagné, des Éboulements, et Pierre Godbout, de Matane, m’ont souvent parlé de votre manière de faire les affaires, et je veux en faire avec vous, monsieur Renaud. Je suis un honnête homme ; vous aussi ; on s’entendra. Voyons, prenez-vous ma cargaison ? Un et demi pour cent meilleur marché que tous les autres pour vous ! Je tiens à être un de de vos fournisseurs, monsieur Renaud ; ça y est-il ?
– Combien de minots ?
– Tant.
– À combien ?
– À tant.
– De combien est la cargaison ?
– De tant.
– Je prends tout, dit le marchand, qui était rond en affaires. Déchargez !
– Monsieur Renaud, vous regretterez pas ce marché-là, fit Burns, en tendant la main à l’acheteur. Croyez-en un homme qui s’y connaît ! Si seulement je pouvais payer la traite à ces gaillards-là... vous verriez rentrer ça, les quarts ! Deux heures dans une ! Pour faire travailler le Canayen, vous savez, y a pas comme un petit coup.
– Eh bien, va pour une piastre et demie. Tenez !
– C’est ce que j’ai coutume de faire, mais j’ai pas le sou, ce matin, monsieur Renaud. À sec comme un chaland à marée basse. C’est pour ça que je suis si pressé de vendre.
– Combien faut-il pour les mettre sur le ton ?
– Dame, ma foi, avec une piastre et demie, monsieur Renaud, on fait bien du chemin, allez !
– Eh bien, va pour une piastre et demie. Tenez ! payez-leur la traite. Et Burns partit avec l’argent.
Et M. Renaud... attendit son poisson...
VII
Écoutons Burns dans un autre rôle.
C’était vers 1863 ou 1864.
Il n’y avait pas longtemps que François Langelier était entré au barreau ; mais son titre de professeur à l’université Laval et ses hautes capacités bien connues lui avaient déjà fait la réputation d’un avocat éminent.
À sa demeure privée, un soir, on vint lui dire qu’un monsieur désirait lui parler.
– Introduisez ! dit François Langelier.
Et bientôt l’avocat se trouve en présence d’un gentleman bien mis et aux manières distinguées, qui lui demande pardon de venir l’entretenir d’affaires à pareille heure, et...
Mais il est forcé de partir pour voyage le lendemain matin, et... C’était Burns.
– Vous êtes le bienvenu, Monsieur, lui dit François Langelier, qui ne le connaissait pas, et qui, comme on sait, est la condescendance même. Exposez-moi votre affaire.
– Je vais tâcher d’être bref, Monsieur, afin de ne pas trop abuser de votre indulgence et de votre temps. Il s’agit d’une question bien délicate, de même que tous les différends de famille, du reste. Et comme votre nom, depuis un certain temps déjà, s’impose à la confiance publique, les parties dont les intérêts sont en litige ont décidé de s’en rapporter à vous – à votre honnêteté et à vos connaissances légales – pour régler la question, si cela se peut, sans publicité et sans trop de frais.
– Je suis bien flatté de ce témoignage, Monsieur, fit Langelier. J’essaierai de m’en montrer digne en vous donnant satisfaction. Exposez-moi le cas dont il s’agit.
– Ce ne sera pas long, Monsieur, dit Burns. D’abord, nous sommes trois intéressés ; mais au fond, je suis seul.
– Comment cela ?
– Voici, Monsieur. Un peu de patience, s’il vous plaît, et vous allez me comprendre. Mon aïeule a donné tous ses biens à ma mère ; c’est-à-dire qu’en réalité elle ne lui a rien donné du tout ; et c’est un peu ce qui est la cause de mon embarras.
– Je conçois.
– De sorte que ma mère n’a rien eu, et que les propriétaires véritables sont mes frères ; je veux dire moi avec mes frères, ou plutôt moi tout seul, parce que, au point de vue légal, je ne fais qu’un avec mes deux frères, dans la succession, vous comprenez...
– J’écoute, marchez ! Ou plutôt allez droit à la difficulté. Où est-elle ?
– La difficulté ? Elle est claire comme deux et deux font quatre : mes frères voudraient avoir l’argent et moi aussi.
– Où se trouve cet argent ? demanda l’avocat, et quel en est le montant ?
– À dire le vrai, Monsieur, nous ne savons pas où est l’argent ; et quand au montant ce sera à vous de faire les calculs. Nous avons pleine confiance en votre habileté.
Langelier, s’apercevant qu’il avait affaire à un homme un peu engagé dans les vignes du Seigneur, et voulant s’en débarrasser, sans toutefois manquer une affaire avantageuse peut-être, lui dit :
– Je vois ce que c’est, il s’agit d’une substitution. – Exactement ! c’est le mot que je cherchais.
– Tout à votre service alors ; mais cela vous coûtera quelque argent.
– Combien vous faudra-t-il, Monsieur ? Je suis prêt à dépenser jusqu’à mon dernier sou pour avoir justice.
– Il vous faudra débourser au moins une centaine de dollars. Burns regarda froidement l’avocat.
– Croyez-vous, demanda-t-il, que vous puissiez entamer une affaire de cette importance avec si peu d’argent ?
– Dame...
– Non, vous êtes trop modeste ; je pensais que cela me coûterait au moins cinq cents piastres pour commencer. En tout cas, ajouta Burns, veuillez me faire un reçu pour deux cents piastres.
Et il mit la main à son gousset avec un geste de grand seigneur, comme pour en tirer un porte-monnaie.
Tout à coup il s’arrêta en se frappant le front d’un air ennuyé.
– Non, non, dit-il, arrêtez, pas de reçu ! Sapristi, a-t-on jamais vu un étourdi comme moi ?... Il faut attendre à demain, Monsieur. Si je ne craignais d’être ridicule, je vous conterais la vieille histoire du porte-monnaie oublié... vieille histoire qui est pourtant vraie quelquefois, j’en fais la désagréable expérience. À demain donc, Monsieur ; il me faudra trouver le moyen de vous voir avant mon départ. Bien fâché de vous avoir dérangé !
Et Burns prit congé avec un si grand air, que François Langelier crut devoir le reconduire jusque dans l’antichambre.
– Au revoir, Monsieur ! dit Burns.
Mais comme il mettait la main sur le bouton de la porte :
– Sapristi ! dit-il en hésitant un peu ; j’y pense, puisque vous avez été témoin de mon humiliation, et que vous savez, du reste, que ce ne sera que vingt-cinq sous à ajouter demain à mes deux cents piastres, prêtez-moi ces vingt-cinq sous, pour me débarrasser de mon cocher ; sans cela, j’aurais à le garder des heures, et sans nécessité ! Je ne me gêne point, vous le voyez. Un homme comme vous sait comprendre ces situations... si bêtes qu’elles soient. Au fait, puisque je vous ai pris pour mon homme de confiance...
Abrégeons en disant tout simplement que François Langelier prêta les vingt-cinq sous.
Il s’en défend bien un peu aujourd’hui ; mais je sais qu’il les prêta.
VIII
En passant, un jour, sur la rue des Fossés, Burns entend le son d’un violon.
Un nommé Lapointe tuait le temps à sa fenêtre en raclant un crin-crin infect, qu’il avait payé un dollar et demi.
Burns entre.
– Monsieur, dit-il, en affectant un accent européen très prononcé, je viens d’entendre le son d’un instrument qui ne me paraît pas ordinaire. Auriez-vous la complaisance de me le laisser voir ?
– Comment donc, Monsieur ; le voici.
Burns prend le violon d’un air grave, le tâte, le soupèse, l’ausculte, l’examine sur tous les côtés, le fait sonner, souffle dedans d’un air entendu, fait mille simagrées pour en imposer à Lapointe, qui le regarde tout intrigué.
Après une longue et minutieuse inspection, Burns se retire dans un coin, marmotte entre ses dents, compte sur ses doigts, regarde en l’air... Enfin, il s’écrie:
– Qui ne risque rien n’a rien ! Et s’adressant à Lapointe :
– Monsieur, lui dit-il, je suis belge, et je voyage pour la maison Lieber et compagnie, les célèbres luthiers de Bruxelles. Combien accepteriez-vous pour votre violon ?
– Mon violon n’est pas à vendre, répond Lapointe, qui flaire une bonne affaire.
– Écoutez, fait Burns, je sais que votre violon n’est pas à vendre ; mais si l’on vous en offrait un bon prix... Je n’ai pas la certitude que ce soit un stradivarius, mais je suis prêt à en courir les risques. Prenez-vous deux cents dollars pour votre instrument ?
En entendant parler de deux cents dollars, Lapointe faillit tomber à la renverse.
– Vous m’offrez deux cents piastres ?
– Oui.
– Pour mon violon ?
– Pour votre violon.
– Tout de suite ?
– Sans doute ; c’est-à-dire demain matin, car je ne puis pas aller à la banque cet après-midi. Il est près de trois heures ; je n’aurais pas le temps de m’y rendre à pied ; et, par une étourderie dont je suis coutumier, j’ai laissé mon porte-monnaie à l’hôtel, dans la poche d’un pantalon que j’ai ôté tout à l’heure. Il faut attendre à demain par conséquent. Au revoir, Monsieur !
– Arrêtez ! s’écrie Lapointe, qui songe que la nuit porte conseil, et qui craint de voir son acheteur changer d’avis, s’il ne s’agit que de payer votre cocher, je puis vous avancer un écu.
– En ce cas, c’est autre chose, reprend Burns. Dans une demi-heure je suis ici avec mes deux cents piastres.
Lapointe les attend encore, naturellement. Il s’en console sans doute en jouant du violon.
IX
En 1855, lors du séjour à Québec de la Capricieuse, le premier vaisseau de guerre français qui ait mouillé dans les eaux du Saint-Laurent après la cession du pays à l’Angleterre, Burns exécuta l’un des plus beaux exploits de sa vie.
Un coup de maître à illustrer un homme.
Il y avait alors à Québec une veuve et sa fille ; des gens d’une respectabilité parfaite, mais que la société québecquoise, beaucoup plus exclusive que de nos jours, tenait un peu en quarantaine, à leur grand désespoir, car ces dames étaient fort ambitieuses, et n’appréciaient rien tant que les relations mondaines.
Grande surprise pour elles, un dimanche après-midi.
Un des officiers supérieurs de la Capricieuse les attendait au salon.
Elles accourent, tout naturellement, le sourire aux lèvres.
L’officier les salue avec une grâce parfaite, et entame la conversation sur le ton d’un homme très répandu dans le monde, et avec un accent que n’aurait pas renié un natif du faubourg Saint-Germain.
Il avait entendu parler de ces dames ; il connaissait leur position sociale ; et pour preuve qu’il savait reconnaître et leur rang et leur mérite, il venait avec empressement les inviter à visiter la corvette française, où le commandant de Belvèse et son état-major seraient enchantés de les recevoir.
– Pouvons-nous compter bientôt sur l’honneur de votre visite, Mesdames ? interrogea le galant officier sous forme de conclusion. Je me permets cette question afin de pouvoir, sachant que vous n’avez ni mari ni frères pour vous présenter à bord, saisir l’occasion de mettre un de nos canots à vos ordres.
– Mais, Monsieur, vous nous faites bien trop d’honneur, à ma fille et à moi... Est-ce que demain... ?
– Demain ? c’est parfait. Dans l’avant-midi ?
– Entre dix ou onze heures, si cela vous convient.
– Très bien, Mesdames. Alors c’est entendu. Demain, à dix heures, une embarcation sera toute à votre service, au quai du Marché. Ne vous pressez pas, l’on vous attendra. Et si vous voulez bien ne pas dédaigner mon escorte, c’est moi qui aurai l’honneur de vous conduire à bord.
Il ne faut pas demander si les deux dames se gourmaient et se confondaient en remerciements.
Leur amour-propre se gonflait d’avance quand elles songeaient à leurs nombreuses rivales de la haute, qu’un pareil succès allait bien sûr faire sécher de jalousie durant six mois au moins.
Elles reconduisirent le courtois officier jusque sur le trottoir presque, l’invitant à dîner, à déjeuner, que sais-je ?
Le marin français répondait par les phrases les plus choisies de son répertoire.
C’était une effusion !
Enfin, l’on ne comptait plus les poignées de main échangées, lorsque, au moment de franchir le seuil, l’élégant officier s’arrêta en tâtant son gousset d’un air contrarié.
– En voilà bien une autre ! s’écrie-t-il, vous allez me trouver impoli ; je désirais donner un franc à votre bonne, et je m’aperçois que j’ai eu la gaucherie d’oublier mon porte-monnaie à bord. Allons, ce sera pour une autre fois.
– Mais, Monsieur, ce n’est pas la peine, je vous assure.
– Si si ! j’y tiens... Ah ! mais c’est que, pour comble d’ennui, j’avais quelques visites à faire, et voilà qu’il me faut retourner à bord pour chercher de l’argent. Un après-midi flambé tout simplement... À savoir, en outre, si le cocher voudra bien se fier à moi... Diable ! diable ! que c’est donc ennuyeux ! A-t-on jamais vu avoir si peu de tête ?
– Mais, Monsieur, si nous osions...
– Ah ! c’est impossible, vous comprenez ! Emprunter d’une dame, ça se fait pas.
– Mais si nous insistions...
– N’insistez pas, je vous en prie !
– Pour nous faire plaisir !
– Il est vrai que... Ah ! mon Dieu, quel ennui, quel ennui !... Je n’en fais jamais d’autres.
La dame s’était éclipsée un instant, et revenait avec un billet de dix dollars.
– Tenez, Monsieur, tenez ! disait-elle. Prenez ces quelques sous ; vous rendrez cela demain.
– Vous me confondez, Madame, disait l’officier d’un ton humilié et confus ; vraiment, je ne saurai jamais comment vous remercier... Au fait, je vous l’avouerai, ce léger service m’est d’autant plus précieux venant de vous ; et je réussirais à m’acquitter que je n’en perdrais le souvenir.
Et sur cette phrase de madrigal, mon Burns – on a deviné que c’était lui – remontait en voiture en envoyant des mamours du bout des doigts, et en répétant :
– À demain ! à demain, Mesdames !
Est-il besoin de se demander qui attendit sous l’orme, le lendemain ? Jamais le marché Finlay n’avait vu un pareil déploiement de toilette, et surtout un plus singulier allongement de figures succéder, au fur et à mesure
que l’heure avançait, à une expression de physionomie plus triomphante. On en parle encore.
Sur ses vieux jours, Burns, trop connu à Québec, dut étendre le cercle de ses opérations à la campagne.
Il exerçait à Lévis, à Beauport, à Lorette, et poussait quelquefois jusqu’à Portneuf.
Maintenant l’on me demandera peut-être comment un ivrogne vivant d’emprunts de ce genre pouvait se vêtir de façon à jouer ainsi le rôle d’un gentleman à un moment donné.
Je répondrai que Burns appartenait à une famille honorable et à l’aise, et que ses soeurs – qui l’aimaient malgré tout – le fournissaient assez régulièrement de linge et d’habits.
Quand il empruntait, c’était pour boire ; car – rendons ce témoignage à de braves gens – il avait toujours un couvert mis chez quelqu’un des siens.
Ce qui ne l’a pas empêché de mourir, comme un vulgaire poète, à l’hôpital.
Quelques instants avant sa mort – je tiens le fait du docteur Vallée qui l’assista dans sa dernière maladie – on le vit palper son oreiller, tâter ses couvertures, fureter dans ses draps.
– Que cherchez-vous donc ? demanda le docteur. – Mon porte-monnaie, balbutia-t-il.
Et il expira.
Si le bon saint Pierre est susceptible de se laisser entortiller, il a dû rencontrer son homme cette fois-là !
XII. George Lévesque
I
– Cré baguette ! l’eau z’est claire à ce matin... t’entends bien, écoute, mon ami !... ma foi de gueux, que c’est une vraie philomène. On dirait, Shakespeare ! que la mer va virer en cristal, potence !...
À la rigueur, ce qui précède peut s’écrire tant bien que mal. Mais ce que la meilleure plume du monde ne saurait rendre, c’est l’accent, les intonations, l’emphase toute particulière avec lesquels ces paroles étaient prononcées.
Si je pouvais le faire, je n’aurais pas besoin de me creuser la tête pour chercher un sujet de poème, il serait tout trouvé.
Nous étions sur le quai de Saint-Denis – un quai qui porte le nom de Saint-Denis, parce qu’il a fallu le construire dans la paroisse voisine, c’està-dire à la Rivière-Ouelle, – et nous attendions le bateau de Kamouraska, qui devait nous transporter à Québec.
Celui qui parlait était un homme de quarante-cinq à cinquante ans, l’air important, rasé de frais, en chapeau de paille, veston, gilet et pantalon de toile blanche, avec une grosse chaîne d’or passée à la boutonnière, les deux mains dans les poches, dans l’attitude d’un homme tout à fait chez lui.
C’est qu’en effet, si le quai de Saint-Denis n’était pas à sa place à la Rivière-Ouelle, George Lévesque, au contraire, était bien chez lui sur le quai de Saint-Denis.
Il en avait fait son domaine privé.
C’était sa promenade du matin, du midi et du soir. C’était son cadre, presque son piédestal.
Il faut ajouter que c’était aussi son gagne-pain.
Quand le gouvernement – en 1854 – avait construit cette jetée de douze cents pieds sur la pointe déserte qui s’avance dans le fleuve au nord-est de la Rivière-Ouelle, et qu’on appelle la Pointe-aux-Orignaux, George Lévesque était venu y établir un hôtel, qu’il appelait sa chaumière, et où, s’il n’a point précisément fait fortune, il a du moins trouvé moyen de vivre à son aise jusqu’à l’année dernière.
Il est bon de constater qu’il était célibataire, ce qui lui permettait de simplifier considérablement son budget.
George Lévesque – les deux noms n’allaient jamais l’un sans l’autre – était célèbre dans tout le bas du fleuve.
T’entends bien, écoute, mon ami... torrieux ! George Lévesque était connu comme un honnête homme, batêche ! depuis le cap Chatte, alorsse ! jusque... enfin ! jusqu’à Québec, indubitablement !
Le fait est que pour les habitants des « paroisses d’en bas », George Lévesque se confondait avec la Pointe de la Rivière-Ouelle elle-même.
C’étaient deux choses inséparables.
On ne concevait pas plus la Rivière-Ouelle sans George Lévesque que George Lévesque sans la Rivière-Ouelle.
Un évêque ordinaire peut s’absenter, faire un voyage, quitter son siège épiscopal ; il est remplacé par un grand vicaire.
George Lévesque, lui, n’ayant point de grand vicaire, t’entends bien, écoute !... quand il partait, il ne restait plus rien.
La Pointe de la Rivière-Ouelle n’existait plus.
Aussi n’ai-je jamais connu un homme pour se multiplier comme lui.
Il était dans tous les coins, voyait tout, savait tout, avait l’air de tout conduire.
Il est bon d’ajouter qu’il ne faisait jamais rien, absolument rien !
On ne lui a jamais vu lever une paille, mais nul ministre d’État, nul patron d’usine, nul chef d’atelier n’a jamais paru plus affairé que lui.
C’était la mouche du coche faite homme, sans cesser de voltiger et de bourdonner. Seulement le bourdonnement se traduisait d’ordinaire comme ceci ou à peu près :
– Bateau de gueux, alorsse !... Voyez donc, voyez donc ! Peut-on être si négligent... Hélas ! t’entends bien, écoute ! faut que j’y sois, batêche !... Faut que George Lévesque soit là !... Tout le temps, mardi !
À quatre heures du matin, on le voyait sur le quai, à inspecter le fleuve, nonobstant.
Il connaissait le nom de toutes les goélettes du golfe, vainqueur ! de tous les remorqueurs de Lévis, tord-nom ! de tous les caboteurs du Saguenay, enfin !
Il comptait tous les voiliers, et signalait tous les steamers.
On aurait dit que ces derniers lui devaient un droit de passage ; qu’ils n’étaient pas en règle tant que George Lévesque ne les avait pas tenus un instant au moins au bout de sa longue-vue.
La Sardinienne, disait-il ; ces Allan, t’entends bien, écoute ! Des requins, blasphème !... indubitablement.
Ou bien :
– C’est l’Ontario, cré démons !... Écoute, mon ami ! la compagnie du Dominion ; des crève-faim ! Je les maudis quatre-vingt-dix-neuf fois, t’entends bien, jusqu’à la septième génération... alorsse!
Il disait cela sans emportement, sans colère, sans mécontentement même. Seulement pour parler.
Dieu seul compterait les milliers de jurons que j’ai entendus tomber de la bouche de George Lévesque.
Il en saupoudrait sa conversation ; il en bourrait ses phrases ; son langage en était farci.
T’entends bien, écoute, enfin, alorsse, nonobstant, indubitablement étaient les seules expressions qui pouvaient faire concurrence à ses batêche, ses bateau de gueux, ses batiscan, ses crime, ses vice, ses mardi et ses torrieux.
Et cependant, je ne l’ai jamais vu seulement de mauvaise humeur.
Ses jurements n’étaient là que pour la sonorité de la phraséologie, pour la couleur.
C’était comme des fleurs de rhétorique dont il aurait parsemé son style. Il lançait ses imprécations sans plus s’exciter que s’il vous eût dit bonsoir.
Il anathématisait les gens avec autant de calme, et avec le même sourire aux lèvres, que s’il leur eût souhaité la bonne année.
– Les Letellier ! disait-il, tord-sacre !... les Chapais, victimes !... les Caron, les Cimon, les Têtu, tas de crasses ! je les envoie, t’entends bien, au fin fond... enfin... des enfers, mardi !... indubitablement !
Et cependant il aimait tous ces gens-là ; et bien loin de leur vouloir du mal, il s’honorait de leur connaissance, et aurait tout fait pour leur être agréable.
Eux le savaient parfaitement, et quand ces propos leur étaient rapportés, ils en riaient de bon cœur et n’en gardaient aucune rancune à notre original.
II
Une fois, George Lévesque racontait une de ses prouesses d’élections :
– J’étais là, disait-il, torrieux ! avec ma petite jument noire, vingt vices ! une bête, chrysostome ! un peu dépareillée, comme on dit. J’avais emporté dans ma poche un réserveur, écoute ! à six coups, diable emporte !... J’étais alorsse ! décidé, malheur ! à tuer, t’entends bien... Oui, mille démons, j’aurais tué ! J’avais-t-un poignard dans le coffre de ma carriole, virginis !... un poignard, mardi !... un poignard,... enfin... que j’aurais enfoncé, millions de crimes !... dans le cœur, écoute, mon ami !.... de ma mère, pochetée de sacres !... C’était pas une rage, t’entends bien... c’était un désespoir de possédé !
Il débitait tout cela, moins par bravache, par forfanterie, que par habitude.
Aussi personne ne s’y trompait ; chacun savait que toute cette férocité de commande n’était qu’à la surface.
Il est des gens naturellement violents qui font des efforts constants pour garder leur sang-froid et paraître calmes et doux.
George Lévesque, au contraire, qui était la brebis du bon Dieu, aurait voulu passer pour un matamore.
Sa suprême ambition aurait été qu’on dît de lui : « Il faut prendre garde, oui ! ce diable d’homme serait capable de tout, s’il se fâchait ! »
Mais il ne se fâchait jamais ; et même lorsqu’il aurait voulu simuler l’exaspération ou la méchanceté, son expression de physionomie le trahissait.
Dans les élections pas plus que dans d’autres circonstances, George Lévesque n’a jamais eu de poignard sous le siège de son traîneau, et, s’il a jamais vu de révolver à six coups, il s’est bien donné garde d’y toucher, et surtout de s’en armer pour courir les assemblées politiques.
J’admets bien qu’il peut avoir, assez souvent même, assommé quelqu’un de ses semblables avec ses discours, mais jamais avec aucune arme plus meurtrière.
À l’entendre aussi, il était d’autant plus dangereux que sa méchanceté était servie par une bravoure à ne reculer devant rien. Il était aussi hardi que redoutable
:
– La paroisse de Saint-Simon, écoute ! je leur z’ai dit, victime !... ma façon de penser, batêche !... Je leur z’ai dit, t’entends bien, à la porte de l’église, torrieux ! Écoute ! vous êtes tous de la crasse, vice !... de la canaille, crime !... des bouts de corde, nom d’un choléra !... Alorsse, qu’ils m’ont pas fait gros comme ça, t’entends bien ! Même que le curé, bateau !... m’a invité à dîner, ma foi de gueux !... indubitablement !
III
Un jour – il y a de cela trente-cinq ans passés – le hasard nous avait amenés, mon frère et moi, à la Pointe-aux-Orignaux.
Naturellement, nous logions à l’hôtel de George Lévesque.
Il y avait joyeuse compagnie, et nous passâmes une assez agréable soirée, à écouter les histoires merveilleuses et les périodes ronflantes de notre amphytrion.
Il en résulta pour nous une nuit fort courte ; car, comme on nous avait dit que la marée du matin serait bonne pour la pêche à l’éperlan, dès l’aube nous étions sur la jetée, la ligne à la main.
Quelle pêche, mes amis !
Des éperlans longs de dix pouces, par centaines, par milliers.
Nous en tirions trois, quatre, cinq à la fois, – quelquefois deux accrochés au même hameçon.
Le même appât servait pour dix, vingt, trente. Il n’y avait qu’à lancer la ligne à l’eau. C’était une rage, une poussée, une pléthore, une foison ! Enfin, une pêche miraculeuse.
En une heure, nous avions rempli jusqu’au bord un grand baquet d’une masse grouillante, luisante et frétillante de petits poissons argentés dont la fraîcheur savoureuse faisait plaisir à voir.
Or nous commencions à nous sentir fatigués, et nous songions à abandonner la partie, lorsque George Lévesque apparut, tout blanc comme à l’ordinaire, avec son panama et son costume de coutil immaculé.
– Tiens, M. Lévesque !
– Eh ! vinguienne ! c’est vous autres, ça !... Déjà debout, torrieux !... Comment ça va-t-il, sac-à-papier, à ce matin ?...
– Pas mal, et vous, monsieur Lévesque ?
– Ah ! moi, je me porte toujours comme le quai de la Rivière-Ouelle, mardi !
– En effet, vous paraissez frais comme une alose.
– T’entends bien, George Lévesque et puis le quai de la Rivière-Ouelle, ça fait pas deux, ça, tonnerre de Kamouraska !... Ça fait rien qu’un, cré baguette ! Qu’est-ce que vous faites donc là, tas de crimes ? – Nous pêchons.
– Vous pêchez, vice !... Pas du poisson toujours, torrieux !
– Pas du poisson !... qu’est-ce que c’est donc ça ?
Et, pendant que j’indiquais du doigt le baquet regorgeant d’éperlans, mon frère en tirait quatre autres d’un même coup de ligne.
– Ça, reprit George Lévesque, avec un air de suprême dédain ; ça du
poisson, massacre !...
– Dame, ce ne sont pas des marsouins, mais c’est du poisson tout de même.
– Écoute, mon ami ; vous connaissez pas ça le poisson, vacarme !... C’est, t’entends bien, George Lévesque qui connaît ça !... indubitablement. – Ah !
– Oui ! vous parlez d’éplans, tord-vice !... C’est pas de l’éplan, ça, bondance ! c’est de la farce, batêche ! c’est pour rire... C’est moi, t’entends bien, écoute ! c’est George Lévesque qui en a vu de l’éplan. Y a dix ans de ça, malheur !... Dans le printemps, comme aujourd’hui, cré virgule !... une marée, vainqueur !... une marée, enfin... au ras du quai, bout de corde !... Avec un banc d’éplans, torrieux !... qu’on voyait pas l’eau, alorsse !... Comme de raison, pas capable de faire, t’entends bien, le tour du quai.
Nonobstant, fallait sauter par-dessus... Écoute, t’entends bien, mardi !... trois pieds d’épais... haut comme ça, vice !... un débord, victime !... Quelque chose d’impudique, t’entends bien !... J’étais là, écoute ! avec des seines, avec des retz, avec des lignes, avec des câbles, virginis ! avec des grappins, des crow-bars, des guindeaux et des palans, vacarme ! Et on envoyait fort, torrieux ! alorsse !... je vous en parle !... Ça, c’était une pêche, blasse ! De l’éplan, j’en z’ai eu, c’te fois-là... enfin... pour fumer toute ma terre, cré virgule ! ma terre et toutes celles de mes voisins, tonnerre de la Baie-SaintPaul !... Dites pas, nom d’un chien ! que vous prenez du poisson, blasphème ! c’est de la bouillie pour les chats, c’te pincée de frémilles-là, pochetée de crimes !...
Nous l’écoutions bouche bée, mon frère et moi, entièrement subjugués par un pareil débordement.
Dieu sait jusqu’où il aurait poussé les choses si nous avions eu l’imprudence de le contredire.
Il aurait pu endiguer la Rivière-Ouelle et le Saint-Laurent par-dessus le marché...
IV
Après avoir aussi scrupuleusement donné le texte de quelques-uns de ses discours, il serait superflu d’ajouter que George Lévesque n’avait pas suivi un cours d’études classiques ni à Sainte-Anne-de-la-Pocatière – la paroisse voisine – ni dans aucun autre collège de la Province.
Son instruction se bornait à certaines notions de lecture et d’écriture très rudimentaires.
L’orthographe avait pour lui des mystères inapprofondis, des secrets qu’il n’avait même pas essayé de pénétrer.
Et comme il était beau parleur – les échantillons d’éloquence qui précèdent en font foi – il ne manquait pas d’émailler sa conversation de ces agréments aussi pittoresques qu’illicites, qu’on appelle, dans le langage ordinaire, des velours et des cuirs, et qu’il avait le don de glisser par-ci parlà, dans les intervalles que pouvaient laisser les jurons.
Il disait assez irrévérencieusement :
– J’ai z’eu, nom d’un chien, une migraine du diable. Ou assez drôlatiquement :
– J’ai-t-été en ville toute la semaine dernière, alorsse !...
Mais pas besoin de faire remarquer qu’il n’y entendait pas la moindre malice.
Une fois, il avait pour interlocuteur ce pauvre Lucien Taché, un autre type sur qui il y aurait bien des choses à raconter.
– Écoute, mon ami, lui disait-il, j’ai-t-acheté du velours, torrieux ! pour me faire...
– Tu veux dire du cuir, interrompit Lucien.
– Non, du velours.
– Du velours, tord-nom ! je sais ce que je dis.
– George Lévesque, tais-toi ! tu as-t-acheté, c’est du cuir. – Du velours, tempête !
– Du cuir, cristi !
– Je te dis, Lucien, ma foi de gueux ! que c’est du velours. Je sais ce que c’est du cuir ; j’en ai z’eu !
– Ça c’est du velours.
– Je te parle de cuir !
– Je te parle de velours !
– Je te dis que j’ai z’eu du cuir, batêche !
– Et je te dis que quand on a z’eu du cuir, c’est du velours, animal ! moi aussi je sais ce que je dis !
– Tiens, Lucien, écoute, mon ami... alorsse... je te comprends plus. Cré virgule ! viens prendre un coup !... indubitablement.
Notre ami aimait le petit verre de temps en temps.
Ce n’était pas un ivrogne, mais il aimait le petit verre – surtout quand ses affaires l’amenaient à Québec.
À la haute ville chez Laforce, et à la basse ville chez Boisvert, chez Dion, chez Pitre Bourassa, chez Marc Lapointe, il s’attablait, et durant de longues heures il racontait ses tribulations avec les autorités municipales de sa paroisse, ses exploits de pêche et de chasse, et en particulier ses voyages.
Car il avait voyagé.
V
Il avait – en 1848 – poussé une pointe jusqu’en Europe ; et c’est là principalement ce qu’il aimait à se rappeler et à rappeler à ceux qui l’écoutaient.
Il avait vu des tempêtes, t’entends bien, écoute ! là y’oùs que la mer, mardi ! changeait de place avec le ciel, torrieux !
Des moussaillons qui grimpaient, nom d’un chien ! dans les mâts, cré virgule ! comme des maringouins, tas de sacres !
Il avait visité la tour de Londres, là y’oùs que chaque pierre était marquée de sang, virginis !... Anne de Boleyn, Jeanne Darc, Marie Stuart, Henri IV, torrieux !... Pas de cérémonies, chrysostome ! on badinait pas, dans ce temps-là, t’entends bien, je te le dis !
Un de ses plus intéressants souvenirs de Londres, c’était d’avoir passé par-dessous l’Arthémise, un chemin, nonobstant, creusé sous la rivière... enfin... comme qui dirait entre la Malbaie et Kamouraska, massacre !... par un Français, batêche ! un nommé Brunelle, alorsse !
Ce M. Brunelle voulait, t’entends bien, comme de raison, donner son nom à son invention, cré démon ! c’est tout naturel, c’pas ? Mais les Anglais aimaient pas ça, torrieux ! c’est tout naturel aussi, t’entends bien !
Alorsse, pour lorsse, écoute, qu’il y avait un nommé Patton... enfin... nonobstant... un Écossais, vice !... qui avait fourni le ciment, mardi !
T’entends bien, alorsse... on prit, crime ! la fin des deux noms, batêche !... la fin de Patton et la fin de Brunelle... ton, nelle ; ce qui fait en anglais tunnell, nom d’un chien ! Le tunnell de l’Arthémise, torrieux !
– C’est toujours comme ça avec les Anglais, blasse !... s’écriait-il sous forme de conclusion ; quand ils nous lâchent par un bout, t’entends bien, c’est pour nous rattraper par l’autre, mardi !
Il avait aussi visité la France.
– En France, disait-il, j’ai-t-été à Paris, j’ai-t-été à Lyon, j’ai-t-été à Bordeaux, vainqueur ! à Marseille, batiscan !... alorsse, t’entends bien, que j’ai vu la mer du Terranée, tonnerre de Chicoutimi !... La Basse-Bretagne, la Haute-Bretagne, la Suisse, la Bastille... enfin... George Lévesque a tout vu ça, mardi ! indubitablement... alorsse !
– Vous êtes allé bien loin ? lui demandai-je un jour.
– J’étais parti, t’entends bien, dit-il, pour la ville de Rome, nom d’un serpent à sonnette !... Mais, ma foi de gueux ! a fallu revirer, nonobstant. Pas d’argent, massacre !... Une bande de requins, vlime !... qui vous font payer, écoute, jusqu’à la chandelle, diable emporte, parce qu’ils appellent ça, alorsse,... de la bougie... enfin !
Naturellement il avait vu des choses bien extraordinaires dans ce voyage-là.
Oui, Shakespeare, il en avait vu !
Il avait vu Louis-Philippe, vinguienne !... sur les barricanes, alorsse, à côté de lui, vice ! au milieu d’une grêle de balles, que le ciel en était, nonobstant, obscurci. Pas un brin de mal ni l’un ni l’autre, bondance ! Une permission du bon Dieu, alorsse !... indubitablement, t’entends bien !
Il avait vu des régiments de soldors, chrysostome ! au grand galop, avec la queue de leurs chevaux sur la tête, batiscan !
Des clochers, virginis ! de deux, trois cents pieds de haut !
Des estatues, t’entends bien, qu’on n’aurait jamais dit, alorsse... que c’était fait à la main.
Des bâtisses... enfin, qu’il s’était laissé dire que c’était là depuis plus de deux cents ans, potence !...
À Liverpool, virginis !... il avait vu des petits garçons hauts comme ça, vice !... qui parlaient anglais, nonobstant, comme des grand’personnes, torrieux !
– Alorsse, t’entends bien, concluait-il, écoute, que c’en était, ma foi de gueux, ridicule !
Une fois qu’il était en train de dépecer un jambon piqué de clous de girofle, il s’écriait :
– C’est en voyageant, écoute, mon ami, qu’on s’instruit, tord-sacre !... C’est pas dans les séminaires. Ainsi, pour lorsse, t’entends bien, il en manque pas, dans ce pays-ci, des ignorants, mardi ! qu’appellent ces choseslà des clous de girofle. Ils savent pas que c’est cous de girafe, torrieux ! qu’il faut dire, alorsse !... Nonobstant que j’en ai vu un vrai, moi, George Lévesque, un cou de girafe, batêche ! au jardin des Plantes, cré virgule !... Je sais ce que je dis, t’entends bien. À preuve qu’il avait, indubitablement, au moins quinze pieds de long, alorsse !... Des clous de girofle !... Si ça fait pas... enfin... suer, t’entends bien, un homme qui sait quelque chose, crime !...
VI
On l’a probablement remarqué, le chapelet de jurons que George Lévesque égrenait dans sa conversation n’allait jamais jusqu’au blasphème. Ses sentiments de bon chrétien s’y opposaient.
Il n’y mettaient même jamais – je l’ai dit – l’accent énergique que comportait la rudesse des mots.
Aussi personne ne s’étonnait de l’entendre.
On ne concevait pas que George Lévesque sans cet intarissable flux d’interjections sous lequel se noyait tout ce qu’il voulait dire.
Avec cela, qu’on n’aurait pu trouver un plus honnête homme et un meilleur garçon, sur toute la côte du sud, depuis Québec jusqu’à la Baiedes-Chaleurs.
Toujours le gousset au service des amis ; jamais l’oreille fermée à l’appel du malheureux !
Il commençait toujours par refuser, par exemple :
Bande de bêtes qui se laissaient fourrer dedans, mardi !... Tas de crèvefaim, torrieux !... Paquet de feignants qu’il fallait nourrir, cré virgule ! pour encourager le vice, potence !... Non, batêche ! c’est pas George Lévesque, mardi ! qu’était assez bête, t’entends bien, pour se laisser tondre, nom d’un sabot ! par les imbéciles et la canaille, alorsse !
Mais cette brusquerie n’imposait à personne.
Du reste, il mâchonnait encore ses batêche et ses torrieux, qu’il avait déjà à la main la somme demandée par l’ami, ou le morceau de lard ou la miche de pain réclamée par le pauvre.
Il y avait un crédit ouvert à son hôtel pour tous les passants décavés.
Il y avait toujours une bonne assiettée de soupe et une tranche de jambon à la cuisine pour toute cette vermine de vagabonds sous la cope, cré nom !... qui viennent embêter le monde respectable, t’entends bien, pour vivre, alorsse... aux dépends du public, mardi !... et qu’on devrait, écoute, mon ami !... chasser, batêche ! à coups de fusil, torrieux !... indubitablement.
Puis, quand l’individu était bien rassasié, George Lévesque ajoutait le pousse-café, t’entends bien, alorsse, quand il n’avait pas offert le petit coup d’appétit en commençant, nom d’un Juif !
C’est un peu, sans doute, grâce à cette générosité intarissable que George Lévesque est mort pauvre.
Mais, s’il n’a pas légué de grands biens à ses héritiers, on peut dire en revanche qu’il les a un peu comblés de son vivant, et qu’il laisse au moins derrière lui une réputation sans tache, un nom sympathique, et des souvenirs dont la gaieté n’altère en rien le côté cordial et quelquefois même attendrissant. |
|
 |
|
|
 |
|
|
|
 |
 |
 |
 | Autres documents associés au dossier Inaptitude |
 |  |
|
 |
|
|
|
| | L'autiste show de Blainville |
| | L'autiste show | | | Difficile de passer sous silence cette joyeuse initiative: les Autiste Show, qui ont lieu dans diverses régions du Québec, entre autres, Ville Lorraine et Repentigny, au printemps. Nous présentons celui qui a eu lieu le 22 mai 2010 au manège du Parc équestre de Blainville, à l'initiative de la ,
|  | | | Régime enregristré d'épargne invalidité |
| | Assouplissement de l'admissibilité au REEI | | | Pour être admis au REEI, il faut déjà être admis au régime de crédit d'impôt, ce qui suppose qu'on ait de l'argent dans un compte en banque. Jusqu'à ce jour, il n'était pas possible d'en appeler de cette règle. La procédure ayant récemment été simplifiée, les plus pauvres auront plus facilement droit au REEI. |  | | | Ce 3 décembre 2010, Journée Internationale des personnes handicapées |
| | Vivre, peindre et écrire avec le syndrome de Down | | | La video est en anglais, mais comme d'une part le son n'y est pas très clair et comme d'autre part le langage de la personne en cause est la peinture, vous ne perdrez rien si vous vous limitez à regarder attentivement les visages et les tableaux. Elisabeth Etmanski, née il y a trente-deux ans avec le syndrome de Down, mène une vie autonome depuis longtemps. Ne soyez pas étonnés, si jamais vous la rencontrez, qu'elle vous salue en écrivant ou en disant un poème à votre sujet. Votre sensibilité est peut-être reléguée à l'arrière plan de votre être, la sienne imprègne tout sa personne y compris la surface. Vous comprendrez à son contact comment le réenchantement du monde peut s'opérer. Quelles sont ses aspirations en tant que peintre? On lui pose la question à la fin de la video. Sa réponse est à l'image de sa personne, naïve: «Je veux être la prochaine Emily Carr.» |  |
|
 |
|
|
 |
 |
 |
|
 |  |
|